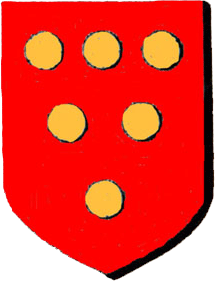 |
Personnes remarquables |  |
Sur cette page :
|
Sur les autres pages du site :
|
Hyacinthe Joseph Jacques de Tinténiac et sa famille
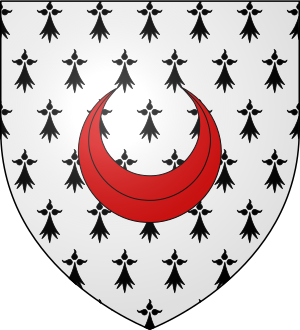 Tinténiac |
En mariant sa fille aînée, le marquis de Kersauson voulut stipuler que son gendre prendrait toujours pour lui et ses hoirs le nom de Kersauson. Pour éluder cet engagement le Marquis de Tinteniac flatta tellement l'amour de son beau-père en composant 3 boûts rimés que celui-ci n'exigea pas l'exécution de la promesse : "n'est noble de nom, qui ne porte au ceinturon, la boucle de Kersauson". - nobiliaire et armorial de Brezal - la Révolution de 1789 à Pont-Christ |
 Kersauson |
Famille de Tinténiac
Le combat des Trente est un épisode de la guerre de Succession de Bretagne qui se déroula sur le territoire actuel de la commune de Guillac (Morbihan), entre Josselin et Ploërmel, près du « chêne de la lande de Mi-Voie ».
À la suite d'un défi lancé par Jean IV de Beaumanoir, un combat est organisé entre trente partisans franco-blésistes de Charles de Blois, dont Beaumanoir, et trente partisans anglo-bretons de Jean de Montfort.
D’après la légende, Beaumanoir, épuisé par la chaleur, le combat et le jeûne, aurait réclamé à boire, ce à quoi son compagnon Geoffroy du Boüays lui aurait répondu « Bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera ».
Marié le 9/10/1747, Pluguffan, avec Anne Antoinette Françoise de KERSULGUEN, née le 9/2/1731, Pluguffan, décédée le 25/7/1793, Quimper (à 62 ans), dont
- Anne Josèphe de TINTENIAC, née le 9/11/1749, St-Julien, Quimper, décédée le 6/5/1812, Londres (à 62 ans).
Mariée le 15/6/1772, Pluguffan, avec Guillaume Bonnaventure du BREIL de RAYS, né le 6/5/1747, Tréguier (22), décédé le 18/4/1807, Treguier (à 59 ans), dont- Marie Charlotte du BREIL de RAYS, née le 10 mars 1774, St-Mathieu, Quimper, décédée le 28 février 1776, St-Mathieu, Quimper (à 23 mois).
- Hyacinthe Joseph Jacques de TINTENIAC, né le 8/10/1753, St-Julien, Quimper, décédé le 16/6/1822, N° 7 rue de la Perle dans le Marais, Paris (à 68 ans), marquis de Quimerc'h.
Marié le 23/3/1775, Chapelle de Brezal, Plouneventer, avec Marie Yvonne Guillemette Xaverine de KERSAUSON, née le 29/10/1751, Plougonven, décédée le 16/9/1812, Pont-Audemer (à 60 ans), dont- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).
Mariée le 28/8/1810 avec Alexandre Jacques de SERRE de SAINT-ROMAN, né le 13/5/1770, décédé le 25/4/1843 (à 72 ans).
- Marie-Josèphe Hyacinthe de TINTENIAC, née le 3/7/1777, Brezal, baptisée le 6/2/1779, Chapelle de Brezal, décédée vers avril 1847, N° 7 rue des Trois Pavillons, Paris (à 69 ans).
Mariée avec Guillaume Marie René de GUISCHARDY, né le 25 janvier 1742, Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine).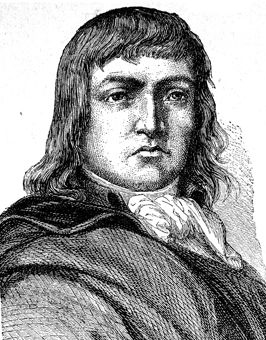
Vincent de Tinténiac,
dit "Loup-Blanc". - Jacques-Gabriel de TINTENIAC, né le 26 février 1779, Brezal, baptisé le 27 février 1779, Chapelle de Brezal, décédé vers août 1832, N° 7 rue de la Perle dans le Marais, Paris (à 53 ans).
- Bonaventure Marie Ange de TINTENIAC, né le 18/9/1780, Brezal, baptisé le 26/9/1780, Plouneventer, décédé le 29/3/1857, Lorient (à 76 ans).
Marié le 8/8/1821, Paris, avec Françoise Désirée BINARD, née vers 1791, Annebault (Seine Inférieure), décédée le 3/2/1870, Lorient (à 79 ans). - Maclovie Marie Jeanne de TINTENIAC, née le 24/5/1782, Brezal, décédée le 1/11/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs (à 67 ans).
Mariée le 17/6/1807, Rouen, avec Joseph LE BIHAN de PENNELE, né le 7/11/1779, décédé le 29/10/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs (à 69 ans). - Augustine de TINTENIAC, née le 25 février 1784, Brezal, Plouneventer.
- Marie Gabrielle Agathe de TINTENIAC, née le 10 mai 1786, Brezal, Plouneventer.
Mariée avec Urbain Auguste Jacques de QUELEN, né le 4 juillet 1785, St-Martin, Morlaix. - Marie Marguerite Eugénie de TINTENIAC, née le 16 juin 1789, Brezal, Plouneventer.
Mariée avec Claude Louis de MOYRIA.
- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).
- Vincent de TINTENIAC, né le 13/11/1756, St-Julien, Quimper, décédé le 18/7/1795, Château de Coëtlogon (22), à 38 ans.

Vincent de Tinténiac, né à Bannalec (ou plus exactement à Quimper pour l'état-civil), tué au château de Coëtlogon le 18 juillet 1795, était un soldat qui s’est illustré pendant la chouannerie. Avant la Révolution française, il avait servi comme lieutenant dans la Marine royale mais avait démissionné. En 1791, il rejoignit l’Association bretonne de Armand Tuffin de La Rouërie, où il servit comme agent de liaison entre la Bretagne et Jersey. La chute de l’association ne mit pas fin à ses activités, en 1793, lors de la guerre de Vendée, il transmit aux Vendéens les dépêches qui proposaient l’aide britannique aux Vendéens si ceux-ci parvenaient à prendre un port. En 1794, Tinténiac aida Joseph de Puisaye à prendre la tête de la chouannerie. Il participa activement au Débarquement des émigrés à Quiberon 1 et fut nommé pour l’occasion maréchal de camp, et prit la tête d’une division de chouans. Chargé lors de la bataille de prendre les républicains à revers, il dut se détourner, sur ordre, vers Saint-Brieuc. Ce fut lors de ce trajet que Tinténiac fut tué lors d’une escarmouche au château de Coëtlogon, le 18 juillet 1795. Car Tinténiac qui, dès les premiers coups fusils était sortit prendre la tête de ses hommes, fut frappé au cœur par une balle républicaine et tué sur le coup.
1 L'expédition de Quiberon ou débarquement des émigrés à Quiberon est une opération militaire de contre-révolution qui commença le 23 juin 1795 et qui fut définitivement repoussée le 21 juillet 1795. Organisée par l'Angleterre afin de prêter main-forte à la Chouannerie et à l'armée catholique et royale en Vendée, elle devait soulever tout l'Ouest de la France afin de mettre fin à la Révolution française et permettre le retour de la monarchie. Mais son échec eut un grand retentissement et porta un coup funeste au parti royaliste.
Famille de Kersauson
Biographie par Adolphe Le Goaziou (ADQ 219 J 31) 1
Maréchal de Tinténiac - Hyacinthe-Joseph-Jacques, chevalier, marquis de Quimerc'h en Bannalec, maréchal de camp, mais non maréchal de France.
De son mariage, en 1775, avec demoiselle Marie-Yvonne-Xavérine-Guillemette de Kersauson, fille du marquis Jean-Jacques-Claude de Kersauson, seigneur de Brézal en Plouneventer, naquirent huit enfants, 2 garçons et 6 filles, qui tous furent baptisés dans la chapelle du château de Brezal.
M. et Mme de Tinténiac émigrèrent en 1792. Brézal fut déclaré bien national, et le Directoire de Lesneven fit procéder à l'inventaire du mobilier qui fut mis sous séquestre. D'après l'inventaire, fait par le citoyen Brichet de Lesneven, il y avait 52 chambres portant chacune son nom : chambre du marquis, bleue, rouge, verte, chambre des demoiselles, chambre des nourrices, etc... Le personnel de la maison, y compris les 9 domestiques, se montait à 32 personnes. On voit figurer, dans l'énumération, des lits "quarrés" ou à tombeau, garnis de couettes de plumes, piano en bois des îles, fauteuils rembourrés, billard... 34 casseroles à la cuisine, argenterie ; 2 girandoles d'argent ; 8 bougeoirs avec bobèches en argent ; 4 chandeliers ayant 4 bougeoirs argentés et dorés... 84 douzaines de serviettes ; 50 nappes ; 96 draps de toile ; 6 barriques de vin rouge ; 3 de vin blanc ; 80 bouteilles de vin rouge d'entremets ; 17 pintes et 13 bouteilles d'eau de vie... 4 chevaux de carrosse, 1 étalon, 1 jument, 1 pouliche, 5 vaches, 2 boeufs, 1 porc, 1 truie ; une meute de 29 chiens de chasse. Le mobilier fut vendu - ainsi que les bois-taillis - en 1793 et rapporta 29.044 livres. Le château et le pourpris furent vendus le 11 thermidor an IV à Radiguet Etienne et à Valentin Dominique, qui le revendirent le 15 prairial an VI à un Le Tom, de Paris...
M. et Mme de Tinténiac ayant émigré précipitamment, avaitent laissé après eux la plus jeune de leurs filles, la petite Marie-Eugénie, qui n'avait encore que 3 ans. Une lettre de 1795, an III de la République, lettre anonyme et sans date, adressée à Ursin Le Gall, prêtre défroqué, agent national du district de Lesneven, porte : "Citoyen, j'ai de grandes obligations à la maison de Brésal ; j'ai été autrefois témoin des ventes de ces Dames et je leur ai voué une estime et une affection éternelles. Je sais que la petite Eugénie Tinténiac, enfant de 6 ans, vit aujourd'hui dans le sein de la misère. Cette idée me pénètre de tristesse. Il y a 3 ans qu'elle est à St-Paul-de-Léon à la charge de la femme qui l'a sevrée, qui elle-même a plusieurs enfants et est bien pauvre et obligée même souvent d'emprunter pour subsister ; le métier de son mari est celui de pêcheur, à ce que je crois... Peut-être cette petite a-t-elle encore quelque parent qu'on pourrait obliger à s'en charger... Je prends donc le parti, Monsieur, de m'adresser à vous-même, sur ce que j'ai entendu dire que votre coeur était bon, généreux, et que vous aimiez à essuyer les larmes de l'innocence affligée..."
Cet Ursin Le Gall, en 1789, au moment de la Révolution, était vicaire à Pont-Christ, petite paroisse toute proche du château de Brézal et sans doute avait-il fréquenté la famille de Tinténiac 2. Dans son post-scriptum à la lettre ci-dessus, il dit avoir fait les démarches, mais n'avoir point réussi.
M. et mme de Tinténiac revinrent d'émigration en 1801. Après leur promesse de fidélité à la Constitution, Fouché, ministre de la police générale signe leur radiation de la liste des émigrés et leur accorde main-levée de tous séquestres, établis sur deux de leurs biens qui étaient restés invendus. Leur fortune jadis opulente était considérablement réduite, et ils étaient criblés de dettes contractées pendant l'émigration. Ils ne rentrèrent pas à Brezal, qui était vendu, et s'établirent à Conteville près de Rouen.
Madame de Tinténiac mourut à Pont-Audemer le 16 septembre 1812 et Monsieur de Tinténiac vint habiter Paris. Il y vécut dans un état voisin de la misère, accablé d'infirmités : "Ma santé, écrivait-il, est devenue tellement mauvaise qu'elle ne me permet de sortir que très rarement et seulement en voiture. Il m'est impossible de suivre aucune affaire, étant presque toujours confiné dans mon appartement, surtout pendant l'hiver..." Par acte de juin 1815, il fit cession à ses enfants de tous les immeubles dont il était possesseur à la date de 1er janvier 1813, moyennant une rente de 6.000 francs que ses enfants devaient lui verser annuellement. Rente qui ne lui sera versée que d'une façon très irrégulière, et jamais entièrement, les enfants étant eux-mêmes très souvent à court d'argent.
D'ailleurs, ses immeubles dont il avait fait cession étaient presque tous grevés d'hypothèques et de charges diverses. Le 12 janvier 1818, il écrivait au régisseur 3 de ses biens : "Il me reste à renouveler, Monsieur, toute ma reconnaissance pour le zèle affectueux avec lequel vous vous occupez de soigner les débris de la fortune de mes malheureux enfants..."
Quelques jours plus tard, nouvelle lettre : "Il n'y a véritablement qu'une bienveillance particulière de votre part, et dont nous ne saurions être trop reconnaissants, qui a pu vous engager à vous charger d'une besogne aussi ingrate que celle du débrouillement de la fortune de mes pauvres enfants. On peut dire que ce sont les écuries d'Augias, et pour peu qu'elles eussent encore demeuré sous la direction de l'aimable et entendu Jozon, j'aurais défié Hercule lui-même de s'en tirer à son honneur... En acceptant la direction de notre fortune, vous vous êtes engagé dans un labyrinthe inextricable, et je vous avoue que pour ma part je vous en ai d'autant plus d'obligation qu'étant à peu près du même âge que vous, en me supposant la capacité que vous avez et que je n'ai pas, je trouverais cette charge tellement pesante que j'enverrais le tout au diable. Je vous prie, cependant, en mon nom et celui de la famille, de n'en rien faire..."
Sous la Restauration, la situation de M. de Tinténiac s'améliora un peu. Le Roi lui accorda une pension de lieutenant général et de Grand-Croix de l'Ordre Royal et Militaire de St-Louis, laquelle pension s'ajoutant aux 6.000 francs que devaient lui verser ses enfants pouvait lui permettre de vivre plus honorablement.
Mais la politique menée par les ministres du Roi ne lui plaisait guère. Il écrivait à son agent d'affaires : "Je ne vous parle pas de nouvelles politiques ; je ne pourrais que vous répéter ce qui est dans les journaux, que vous avez sans doute à Lesneven. Je trouve que nous sommes en 91, et et que nous allons en poste vers 92 et 93. Les lieux publics retentissent des mêmes propos qui se tenaient à ces époques désastreuses et d'odieuse mémoire, et l'aveuglement des personnes intéressées paraît être le même. Il n'y a qu'un miracle qui puisse tire la France de la position où elle se trouve... Tous les honnêtes gens gémissent de ce qui se passe, mais les gémissements ne mènent malheureusement à rien et le mal va toujours bon train...".
M. de Tinténiac mourut à Paris le 18 juin 1822. Recevant le faire-part de cette mort, M. de Kersauson - Vieux-Chastel écrit : "J'apprends avec peine la mort de M. le marquis de Tinténiac. Quoiqu'il ne fût pas encore, à ce que je crois, d'un âge très avancé, je ne croyais pas qu'il pût prolonger autant sa carrière, d'après le triste état dans lequel je l'ai vu pendant l'émigration."
1 Adolphe Le Goaziou (1887-1953), libraire à Quimper, a été l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue de Bretagne.
Cette revue, d'existence éphémère (de 1947 à 1953), avait pour objectif de faire connaître la matière bretonne.
2 Effectivement, il fréquentait les résidents du château de Brezal, M. et Mme de Tinténiac, et également M. et Mme de Montbourcher qui y résidaient aussi à l'époque où Ursin Le Gall était vicaire de Pont-Christ. Mme de Montbourcher, née de Kersauson, était la soeur de Mme de Tinténiac.
Les châtelains de Brezal étaient très proches de l'évêque de Léon, Mgr de La Marche, et lui transmettaient toutes les réflexions du vicaire à propos du serment à la Constitution civile du clergé, qui lui était imposé par la Révolution (décret adopté par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790). Le vicaire était donc sous contrôle. Finalement, il prêta serment à la grande déception de son évêque. (source Mémoire d'Ursin Le Gall - ADQ 14 J 1).
3 M. Miorcec de Kerdanet. Le père, Daniel Nicolas (1752-1836) car "étant à peu près du même âge" (voir plus haut) que le marquis de Tinténiac, né en 1753.
Marie Jeanne Françoise de Tinténiac
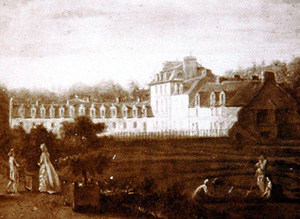 |
|
Parents et famille
- Hyacinthe Joseph de TINTENIAC, né le 8 octobre 1753, St-Julien, Quimper, décédé le 16 juin 1822, N° 7 rue de la perle dans le Marais, Paris (à 68 ans).
- Marie Yvonne Guillemette Xaverine de KERSAUSON, née le 29 octobre 1751, Plougonven, décédée le 16 septembre 1812, Pont-Audemer (à 60 ans).
- Mariés le 23 mars 1775, Chapelle de Brezal, Plouneventer.
- Famille : cf descendance de Brezal.
Mariage
Mariée le 28 août 1810 avec Alexandre Jacques de SERRE de SAINT-ROMAN, né le 13 mai 1770, décédé le 25 avril 1843 (à 72 ans) ![]() ,
,
veuf de Marie-Mélanie Le Rebours.
Fils unique de Jacques de Serre de Saint-Roman, comte de Fréjeville, conseiller de grand-chambre au parlement de Paris, mort sur l'échafaud révolutionnaire le jour même de la chute de Robespierre, le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), et d'Hélène-Françoise de Murard de Bulon.
Il est né le 13 mai 1770. Emigré en 1792, il a servi à l'armée des princes et au corps de Condé. Rentré en France en 1801, il ne remplit aucunes fonctions sous les gouvernements consulaire et impérial. Louis XVIII, à son retour en 1814, créa le comte de Saint-Roman officier dans les mousquetaires gris, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Il a été retraité chef d'escadron au licenciement des mousquetaires. Nommé après les cents-jours, pour présider le collège électoral du département de l'Allier, le 26 juillet 1815, le roi l'a créé pair de France le 17 août suivant, il est devenu colonel de la 8è légion de la garde nationale de Paris, puis officier de la Légion d'Honneur le 19 août 1823. Après sa nomination à la pairie, le comte de Saint-Roman n'a cessé de prendre une part active aux délibérations de la haute chambre. Il a publié de nombreux livres.
Il a épousé : 1° à Wandsbeck, près Hambourg, le 20 août 1795, Marie-Mélanie Le Rebours, ... 2° à Rouen, par contrat du 28 août 1810, Marie-Jeanne-Françoise de Tinténiac. Du premier mariage sont issus :
- Auguste-Jacques-Albéric de Serre de Saint-Roman, né le 15 avril 1804, mort en bas âge ;
- Sidonie-Susanne de Serre de Saint-Roman, mariée avec Anatole-Joseph-Philippe, comte de Reilhac, officier de dragons, décédée le 16 juin 1823 ;
- Marie-Geneviève de Serre de Saint-Roman, né le 11 juillet 1802, mariée avec Léon-Formose, comte de Barbançois, chef d'escadron de cuirassiers ;
- Marie-Amicie de Serre de Saint-Roman, née le 23 mai 1805, mariée le 13 juin 1831, avec Jacques-Raimond de Serre, vicomte de Saint-Roman.
(source Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, Vol. 8, 1827. par Jean B. Courcelles).FERMER X
Le fabuleux destin de Marie Jeanne Françoise de Tinténiac
G. Lenotre a conté (Vieilles maisons, vieux papiers, 1è série, 1914, p. 91 et seq.) l'histoire de Mlle Marie Jeanne Françoise de Tinténiac, fille du marquis de Tinténiac qui, en 1792, en cette période troublée par la Révolution, s'embarqua à Saint-Malo, sous la conduite d'un vieux serviteur nommé Robin, pour émigrer. Son père, retenu à Brézal par la santé de sa femme, sur le point d'être mère, lui avait fait prendre les devants.
Ils s'embarquèrent pour Plymouth sur le même bateau que M. Savalette de Langes, frère ou cousin d'un banquier du Trésor Royal, qui avait, aux premiers jours de la Révolution, prêté 7 millions aux frères de Louis XVI. Il était veuf et avait une fille Jenny, alors âgée de 12 à 14 ans. Avec eux s'embarqua aussi un certain B... dont ils avaient fait connaissance en route, "jeune homme de manières élégantes, d'esprit vif, cherchant fortune et très désireux d'aventures lucratives", et qui les avait conduits et pilotés en Bretagne.
Après 48 heures de traversée, le patron du bateau leur avoua qu'il était impossible d'atterrir en Angleterre et qu'il faisait voile pour Hambourg. Les passagers en prirent leur parti, sauf Robin, qui terrifié de la responsabilité qu'il encourait, voulut obliger le capitaine à tenir ses engagements, lui fit une scène terrible, eut un accès de rage qui dégénéra en fièvre chaude, laquelle l'emporta trois jours après leur débarquement dans une auberge d'Altoria.
Mlle de Tinténiac resta donc seule avec B... et les Savalette. Elle écrivit à ses parents, sans avoir réponse. La misère ne tarda pas à venir, quand leurs ressources furent épuisées. Ils durent habiter dans une cave, couchant sur des chiffons entassés. M. Savalette, atteint d'une fièvre putride, mourut faute de soins. Les deux jeunes filles furent aussi malades et Jenny succomba, répétant dans son délire à son amie : "N'oublie jamais que le comte d'Artois m'a laissée périr de misère et qu'il doit sept millions à ma famille".
B..., homme d'expédients, imagina qu'il lui serait possible, bien que Jenny n'exista plus, d'obtenir quelques recours de la famille royale, qu'il accabla de lettres et de suppliques en les signant du nom de Jenny et en faisant passer celle-ci pour la fille même de l'ancien garde du Trésor Royal. Cela demeura sans effet. Mlle de Tinténiac, restée seule avec lui, devient sa maîtresse (indolence, promiscuité) et l'on prétend qu'il poussa l'infâmie jusqu'à faire de la pauvre fille son gagne-pain.
Enfin, après Brumaire, sa famille la retrouva et une dame de X... la ramena en France. B... avait disparu. Les années s'écoulèrent, le cauchemar s'effaça, elle oublia son temps d'émigration et de misère et finit par épouser, en 1810, le comte de Saint-Roman.
"La nouvelle comtesse de Saint-Roman était citée comme un modèle achevé de toutes les vertus ; ce qu'on savait de ses malheurs passés, sa piété, l'espèce de résignation inquiète qu'elle apportait à la pratique de la vie, sa haute situation de fortune, lui attirait d'unanimes hommages : elle consacrait la plus grande partie de son temps aux oeuvres charitables et son renom de sainteté grandissait chaque jour". Sous la Restauration, la fréquentation des personnes en vue et "son intimité avec la duchesse d'Angoulême, la classait parmi les hautes personnalités de la société royaliste de Paris où elle habitait, avec son mari et une partie de sa famille, un vaste hôtel rue de la Perle, dans le quartier du Marais."
Un jour, c'était à la fin de 1815, une visiteuse la demanda. Quand elle eut soulevé son voile, Mme de Saint-Roman reconnut B..., travesti en femme, qui tout de suite posa son rôle. " Je suis ta vieille amie d'émigration, Jenny Savalette de Langes, te rappelles-tu ? ". Il lui exposa son plan : tirer parti des allusions de Jenny aux millions empruntés et pour cela se présenter aux princes comme la descendante directe de leur créancier. Le succès était certain, si une personne autorisée et bien en cour comme l'était Mme de Saint-Roman consentait à attester son identité et à l'appuyer de son influence.
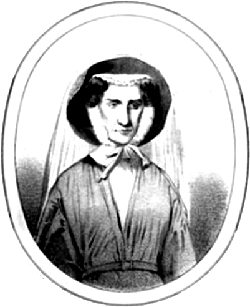 L'homme-femme qui se faisait passer
L'homme-femme qui se faisait passer pour Jenny Savalette de Langes
Sous son déguisement, il était "une femme grande et sèche, portant un tour de cheveux et des brides de chapeau très garnies qui dissimulaient les contours de son visage".
Du reste, il n'avait rien à ménager et, en cas de refus, il n'hésiterait pas à faire naître un épouvantable scandale en révélant le passé de la comtesse. La malheureuse femme se sentit perdue : elle courba le front pour sauver l'honneur du nom qu'elle portait, elle promit !
C'était horrible ; de ce jour commença pour l'infortunée comtesse un supplice dont chaque heure avivait la cruauté : elle était désormais condamnée à voir toujours rôder autour d'elle le fantôme de ce passé sinistre qu'elle avait cru mort depuis tant d'années. Ce passé si soigneusement caché à tous, se redressait vivant à ses côtés, il prenait corps jusque chez elle et se mêlait à sa vie.
Son existence devait être désormais un mensonge de tous les instants. Il lui fallait refouler ses larmes, cacher ses douleurs, tromper tous ceux qu'elle aimait. Elle dut se présenter en souriant à l'odieux personnage, vanter ses vertus, le recommander, faire valoir ses titres à la reconnaissance et à l'affection des siens, tremblant sans cesse qu'un hasard fatal vint dévoiler l'imposture dont elle se rendait complice.
L'intrus paraissait plus calme et moins troublé ; il jouait son rôle avec une habileté déconcertante. Il avait pris de la femme les allures, les manières, la tournure, et aussi les habitudes et les occupations : il façonnait, non sans art, des bonnets de dentelle et des menus ouvrages de broderie ; il parlait savamment de cuisine et ses recettes d'entremets étaient très demandées. Chaque jour, il courait les bureaux de placement, cherchant des bonnes, procurant aux personnes pieuses de ses relations, des servantes sûres, qu'il dressait au service. Il s'était instruit de généalogie et parlait en personne experte des familles nobles.
L'entourage de Mme de Saint-Roman traitait Jenny Savalette de Langes (puisque c'est le nom qu'il avait usurpé) en parente quelque peu susceptible, mais pleine d'indulgence. Comme son visage piquait un peu, les enfants l'appelaient Tante Barbe. Grâce au soutien de Mme de Saint-Roman, elle obtint diverses pensions du roi et du comte d'Artois et un appartement à Versailles.
Et l'aventurier soutint à merveille ce rôle sans une faute, sans une défaillance pendant des années ; années de torture pour la malheureuse comtesse. Elle se trouvait en présence de ce dramatique dilemne : Révéler le secret qui l'étouffait et sacrifier par cette révélation l'honneur et le repos de tous les siens, ou se dégrader elle-même, à ses propres yeux, en secondant par son silence le misérable qui l'exploitait avec un si audacieux cynisme.
Il paraît vraisemblable qu'au bout d'un certain temps ce supplice se trouva au-dessus de ses forces. Epuisée, n'en pouvant plus, elle dut prendre le parti de révéler son martyre à son mari qui l'aimait tendrement et connaissait toutes ses vertus.
Et donc, Mme de Saint-Roman et son entourage éliminèrent peu à peu le misérable qui passa ses dernières années dans une existence d'inquiétudes continuelles et de déménagements hâtifs. Il mourut en 1858 à Versailles et son sexe fut reconnu par les personnes chargées de l'ensevelir.
Cette histoire intrigua fort le public et l'on crut voir en ce personnage mystérieux, soit Louis XVII, soit un personnage politique compromis dans quelque sombre intrigue, soit un grand criminel qui avait adopté ce moyen pour échapper au châtiment. La réalité était moins passionnante et au lieu du héros lamentable ou tragique, il ne reste plus qu'un assez banal gredin. Qui était-ce ? c'est une question à laquelle on ne devrait jamais répondre : somme toute, il vaut mieux ne pas savoir.
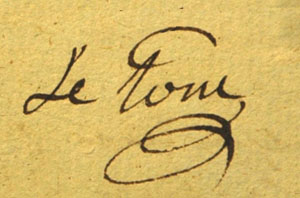 |
|
Parents
- Joseph LE TOM, né le 2 octobre 1699 à Kereobret, St-Fregant, de Rolland et de Jeanne Favé, décédé le 29 novembre 1781, à St-Pol (à 82 ans).
- Marie LE DUFF
- Mariés le 05/06/1752 à St-Pol. Joseph était veuf de Françoise Coat.
Mariage et enfants
Marié le 1er mai 1787 à Paris, avec Victoire Honorine GILLES, née le 18 décembre 1754 à Paris, dont- Josèphe Rose Honorine LE TOM, née le 23 février 1790, St-Jean, Paris, décédée le 10 février 1805 (à l'âge de 14 ans).
- Aglaé Julie Perrine LE TOM, née le 1er juillet 1791, St-Eustache.
- Marie Zénobie LE TOM, née le 7 novembre 1792, St-Sauveur, Paris, décédée le 13 février 1818, Paris (à l'âge de 25 ans).
Mariée le 6 juin 1816, Paris, avec François Elie MATERRE, dont- Honoré Jean Hubert MATERRE.
Relations
- Parrain : Rolland MONCUS
- Marraine : Marie LE TOM
- Filleule : Jeanne-Jacquette TANGUY 1786- Keradoret, Plouneventer -
- Filleul : Rolland Marie GUIVARCH 1798-1831 Château de Brezal, Plouneventer - Rue Neuve, Landivisiau
Frère et soeur
- Joseph LE TOM, né le 10 octobre 1753, St-Pol. Marié le 10 novembre 1773, St-Pol, avec Marie CHARLES. Marié le 30 juin 1783, St-Pol, avec Louise LE LAY,
- Catherine LE TOM, née le 24 janvier 1760, St-Pol, décédée le 19 décembre 1795, St-Pol (à 35 ans).
Mariée le 31 mai 1786, St-Pol, avec François GUIVARCH, né vers 1760, Plouenan, décédé le 3 novembre 1824, Rue Neuve, Landivisiau (à 64 ans), aubergiste à St-Pol, économe de Brezal, cabaretier, commerçant.
Biographie
- Rolland Le Tom est connu pour avoir été l'un des propriétaires du château de Brezal et de ses dépendances, dont le moulin et les fermes faisant partie du domaine.
Au moment de la Révolution, lors de la vente des biens nationaux confisqués aux nobles émigrés, "le manoir et pourpris de Brezal ont d'abord été acquis par les sieurs Aubertin, Debry et Radiguet suivant contrat émané de l'administration centrale du Finistère le 11 thermidor an 4 (29/7/1796)". Ils furent ensuite "revendus au sieur Rolland Le Tom, propriétaire à Paris, suivant contrat du 29 vendémiaire an 5 (20/10/1796) au rapport de Vallet, notaire à Guingamp".
Le notaire "agissait au nom de M. Le Tom, ancien serviteur de M. de Tinténiac, croyant que Le Tom, de son côté, acquérait au nom de M. de Tinténiac. Mais Le Tom acquérait pour lui-même, et eut même l'audace de venir habiter le château", c'est ce que nous apprend une note écrite par l'abbé Jean-Marie Gueguen . Pas très honnête notre Le Tom ?
Cf un article publié dans "Le Progrès de Cornouaille" des 1er et 23/6/1957, par l'abbé Jean-Marie Gueguen :
. Pas très honnête notre Le Tom ?
Cf un article publié dans "Le Progrès de Cornouaille" des 1er et 23/6/1957, par l'abbé Jean-Marie Gueguen :
Echos de la Révolution en Finistère : Ce que fut le déclin du château de Brézal.
"... Puis ce fut le tour du château et son pourpris, parc, jardins et toutes autres appartenances et dépendances, le tout acheté, le 11 thermidor an 4 (31 juillet 1795) par Radiguet Etienne et Valentin Dominique, de Landerneau qui les revendirent, le 15 prairial an 6 (4 juin 1797) à un nommé Le Tom, de Paris, par l'entremise de Me Ollivier, notaire à Landerneau. Me Ollivier agissait au nom de M. Le Tom, ancien serviteur de de M. de Tinténiac, croyant que Le Tom, de son côté, acquérait au nom de M. de Tinténiac. Mais Le Tom acquérait pour lui-même, et eut même l'audace de venir habiter le château. Honni de tous, et conspué par tous les habitants du voisinage, il revendit Brézal le 27 ventôse an 10 (17 mars 1799)".
On remarquera quelques différences de dates et de notaires avec mes sources.
Jean-Marie Gueguen, né en 1877 à Guipavas, fut ordonné prêtre en 1902 et nommé recteur du Folgoët en 1925. Avant il fut nommé prof. de 5è à St-Yves de Quimper en 1906 (ordo 1910), vicaire de Port-Launay en 1912 (ordo 1914), recteur de Lanneuffret en 1919 (ordo 1920). Il s'est sans doute interessé à Brezal quand il était à Lanneuffret.
Naissance - 17/10/1877 - Guipavas (Bourg) GUEGUEN Jean Marie, fils de Yves François, Cultivateur, âgé de 34 ans et de Marie Antoinette JESTIN, Cultivatrice Témoins : Jean Marie GUEGUEN, cultivateur, 66 ans, aïeul paternel, et Henri JOHNSTON, médecin, 45 ans, tous deux de Guipavas Mentions marginales : décédé à Saint Pol de Léon le 16/01/1960.
Décès (SRQL 1960 vue 23 : Chanoine honoraire, ancien recteur de N.-D. du Folgoet, décédé le 16 janvier à la maison St-Joseph à St-Pol, à 82 ans. X
Rolland Le Tom acquiert aussi :
- la Grande Métairie de Brezal par contrat émané de l'administration centrale du Finistère le 15 prairial an 6 (3/6/1798),
et plus tard il racheta :
- le moulin de Brezal à Michel le Lann par acte du 21 thermidor an 6 (8/8/1798),
- le lieu de Brezalou à François Marie et Yves Marie Derrien, demeurant à Landivisiau, qui l'avaient acheté à l'administration.
- L'abbé Gueguen indique que Le Tom était le serviteur du marquis de Tinténiac, quelques indices viennent effectivement renforcer cette affirmation.
D'abord, le 18/6/1786 on le voit parrain, à Pont-Christ, de la petite Jeanne-Jacquette Tanguy, née de Guillaume et de Thérèse Reguer, à Keradoret en Plouneventer. Il était donc très probablement installé au château de Brezal, tout près de Keradoret.
De plus, en 1787, le marquis François-Hyacinthe de Tinténiac, le père du propriétaire de Brezal est présent à la signature de son contrat de mariage avec Victoire Honorine Gilles (voit plus bas).
est présent à la signature de son contrat de mariage avec Victoire Honorine Gilles (voit plus bas).
François-Hyacinthe de TINTENIAC, né le 8/3/1726, St-Mathieu, Quimper, décédé le 22/12/1805, Botiguery, Gouesnac'h (à 79 ans).
Marié le 9/10/1747, Pluguffan, avec Antoinette-Françoise de KERSULGUEN, née à Pluguffan, dont- Anne Josèphe de TINTENIAC, née le 9/11/1749, St-Julien, Quimper.
Mariée le 15/6/1772, Pluguffan, avec Guillaume Bonnaventure du BREUIL de RAYS, né le 6/5/1747, Tréguier (Côtes-d'Armor). - Hyacinthe Joseph de TINTENIAC, né le 8/10/1753, St-Julien, Quimper, décédé le 16/6/1822, n°7 rue de la perle dans le Marais, Paris (à 68 ans).
Marié le 23/3/1775, Chapelle de Brezal, Plouneventer, avec Marie Yvonne Guillemette Xaverine de KERSAUSON, née le 29/10/1751, Plougonven, décédée le 16/9/1812, Pont-Audemer (à 60 ans), dont- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, Plouneventer, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).
Mariée le 28/8/1810 avec Alexandre Jacques de SERRE de SAINT-ROMAN, né le 13/5/1770, décédé le 25/4/1843 (à 72 ans). - Marie-Josephe Hyacinthe de TINTENIAC, née le 3/7/1777, Brezal, Plouneventer, baptisée le 6/2/1779, Chapelle de Brezal, décédée vers avril 1847, n°7 rue des Trois Pavillons, Paris (à peut-être 69 ans).
Mariée avec Guillaume Marie René de GUISCHARDY, né le 25/1/1742, Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine). - Jacques-Gabriel de TINTENIAC, né le 26/2/1779, Brezal, Plouneventer, baptisé le 27/2/1779, Chapelle de Brezal, décédé vers août 1832, n°7 rue de la perle dans le Marais, Paris (à peut-être 53 ans).
- Bonaventure Marie Ange de TINTENIAC, né le 18/9/1780, Brezal, Plouneventer, baptisé le 26/9/1780, Plouneventer, décédé le 29/3/1857, Lorient (à 76 ans).
Marié le 8/8/1821, Paris, avec Françoise Désirée BINARD, née vers 1791, Annebault (Seine Inférieure), décédée le 3/2/1870, Lorient (à 79 ans). - Maclovie Marie Jeanne de TINTENIAC, née le 24/5/1782, Brezal, Plouneventer, décédée le 1/11/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs
(à 67 ans).
Mariée le 17/6/1807, Rouen, avec Joseph LE BIHAN de PENNELE, né le 7/11/1779, décédé le 29/10/1849, Pennelé, St-Martin-des-Champs (à 69 ans). - Augustine de TINTENIAC, née le 25/2/1784, Brezal, Plouneventer.
- Marie Gabrielle Agathe de TINTENIAC, née le 10/5/1786, Brezal, Plouneventer.
Mariée avec Urbain Auguste Jacques de QUELEN, né le 4/7/1785, St-Martin, Morlaix. - Marie Marguerite Eugénie de TINTENIAC, née le 16/6/1789, Brezal, Plouneventer.
Mariée avec Claude Louis de MOYRIA.
- Marie Jeanne Françoise de TINTENIAC, née le 31/1/1776, Brezal, Plouneventer, décédée le 3/10/1855, Paris (à 79 ans).
- Vincent de TINTENIAC, né le 13/11/1756, St-Julien, Quimper, décédé en 1795, Château de Coëtlogon (à 39 ans).
- Anne Josèphe de TINTENIAC, née le 9/11/1749, St-Julien, Quimper.
- Quand Le Tom quitta-t-il Brezal et l'évêché de Léon pour se rendre à Paris, y habiter et y réaliser ses affaires parisiennes ? Dans la gestion de ces affaires, il a fréquenté les notaires de Paris, et l'on peut retrouver aujourd'hui les actes qu'il a signé. Quelques dates vont nous permettre de le suivre :
 Pour ce faire, nous nous appuyons sur le minutier central des notaires de Paris, conservé aux archives nationales. Heureusement qu'il est là, car sinon depuis l'incendie de l'hôtel de ville de Paris, le 24 mai 1871, et la disparition, en conséquence, des archives de l'état-civil et des registres paroissiaux antérieurs, il ne nous resterait plus que l'état-civil "reconstitué", très pauvre en informations. D'ailleurs, l'existence des enfants de Le Tom nous est connue par ce dernier : à prendre avec précautions, donc !
Pour ce faire, nous nous appuyons sur le minutier central des notaires de Paris, conservé aux archives nationales. Heureusement qu'il est là, car sinon depuis l'incendie de l'hôtel de ville de Paris, le 24 mai 1871, et la disparition, en conséquence, des archives de l'état-civil et des registres paroissiaux antérieurs, il ne nous resterait plus que l'état-civil "reconstitué", très pauvre en informations. D'ailleurs, l'existence des enfants de Le Tom nous est connue par ce dernier : à prendre avec précautions, donc !
La piste des notaires de Paris m'a été indiquée par un acte de la justice de paix de Landivisiau, qui cite une procuration faite par Rolland Le Tom chez le notaire "Chaudron" à Paris. Procuration qui concernait une affaire de coupe de bois par un scieur de long de Runpoulzic.
Tous ces éléments permettent, bien sûr, de valider la piste suivie. X -
------------- Période bretonne ------------- - 1786 : le 31 mai, il est témoin à St-Pol-de-Léon au mariage de sa soeur, Catherine, avec François Guivarch. Catherine est dite domiciliée à Plouneventer, ce qui semble montrer un lien supplémentaire de la famille Le Tom avec la famille Tinteniac de Brezal.
- 1786 : le 18 juin, il est parrain à Pont-Christ de Jeanne-Jacquette Tanguy de Keradoret.
- ------------ Période parisienne -------------
- 1787 : il habite à Paris, rue Bourbon Villeneuve, paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
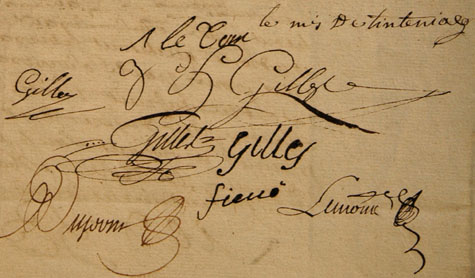
Toussaint GILLES, décédé le 18/4/1783 à Paris, maître écrivain.
La famille de Victoire Honorine :
Marié avec Marie-Thérèse LEMAITRE, décédée le 15/3/1787, Rue de Paradis, St-Jean-en-Grève, Paris, dont- Thérèse GILLES.
- Marguerite Rose GILLES, née le 14/7/1747 à St-Germain-l'Auxerrois, Paris, décédée le 20/5/1835, Paris, marchande de mode.
- Jeanne Louise GILLES, décédée en 1786.
Mariée en 1785 à Paris avec Jean Théodore HUGUET, maitre orfèvre joailler, dont- François Jean HUGUET.
- Toussaint François GILLES, baptisé le 27/8/1752 à St-Germain-l'Auxerrois, Paris, décédé le 11/21802 à Lons-le-Saunier (à 49 ans), employé à la porte aux chevaux.
Marié le 23/4/1782 avec Fortunée Françoise SYBILLE, dont- Alexandre François GILLES dit SELLIGUE, ingénieur mécanicien.
Marié le 30/5/1829, St-Sauveur, Paris, avec Félicité Raison QUINCY. - Marie Anne Fortunée GILLES.
Mariée avec Alexandre CABRYT, fabricant de verres de montres.
- Alexandre François GILLES dit SELLIGUE, ingénieur mécanicien.
- Victoire Honorine GILLES, née le 18 décembre 1754 à Paris.
Mariée le 1/5/1787 avec Rolland LE TOM.
- 1787 : le 30 avril à Paris, contrat de mariage entre Roland Le Tom et demoiselle Victoire Honorine Gilles, notaire Athanase Lemoine (AN MC/ET/III/1183) dont voici le début de l'acte :
"Furent présents S. Roland Letom, bourgeois de Paris, y demeurant rue Bourbon Villeneuve, paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, fils majeur de déffunt S. Joseph Letom Me d??? à St-Paul de Léon et de Dlle Marie Le Duff, son épouse, aujourd'huy sa veuve et de laquelle il déclare avoir le consentement à l'effet du mariage dont sera cy-après parlé, d'une part ;
Et Dlle Victoire Honorine Gilles, fille majeure de deffunt S. Toussaint Gilles, maître écrivain à Paris et de Dlle Marie-Thérèse Lemaitre, son épouse décédée sa veuve, demeurante à Paris, rue de Paradis, paroisse St-Jean en Grève, d'autre part.
Lesquels dans la vue du mariage proposé entre eux et dont la célébration sera incessamment faite en face d'église avons fait et arrêté les conditions civilles ainsy qu'il suit
en présence de Mre François Hyacinthe, marquis de Tinteniac, baron de Quimerc'h, capitaine de la noblesse de Cornouailles, demeurant à Paris, rue Ste Avoye, paroisse de St-Merry et des parents et amis qui signeront le présent contrat.
Seront les futurs époux uns et communs en tous biens, meubles et les acquets d'immeubles suivant la coutume de Paris au desir de laquelle leur future communauté sera régie, gouvernée et partagée encore que par la suite ils veuillent faire ... etc..."
Les signatures sont reproduites ici. On remarquera celles du marquis de Tinténiac et de Le Tom, ainsi que la belle signature de la mariée.
- 1790 : Naissance de son premier enfant à St-Jean, Paris.
- 1791 : Naissance de son deuxième enfant à St-Eustache, Paris.
- 1792 : Naissance de son troisième enfant à St-Sauveur, Paris
- 1795 : Procuration Le Tom le 25 brum. IV (16/11/1795) chez le notaire Claude
Chodron, rue de Bourbon à Paris. - 1796 : Achat du manoir de Brezal, le 20 octobre
-
------------- Période bretonne ------------- - 1798 : Achat de la Grande Métairie de Brezal, le 6 juin
- 1798 : Achat du moulin de Brezal, le 8 août
- 1798 : Parrain à Brezal, le 14 août :
- Il fut témoin lors de la naissance du fils de son secrétaire et économe du château de Brezal, cf les registres de Plouneventer : "Aujourd'hui 29 thermidor l'an six de la République française (14/8/1798) ... ont comparu à la Maison commune François Guivarch de Brezal, âgé de 38 ans, profession d'économe dudit Brezal, originaire de Plouenan département du Finistère, accompagné de Rolland Le Tom, demeurant ordinairement à Brezal ...". Ce François Guivarch n'était autre que le gendre de Le Tom et veuf de sa fille, Catherine. Après le décès de celle-ci, il avait épousé Jeanne Menez, d'où l'enfant Rolland Marie Guivarch, né à Brezal.
- Il apparaît que Rolland Le Tom ne resta pas longtemps à Brezal. Après avoir joué le mauvais tour d'acheter le domaine de son maître, le marquis de Tinteniac, contraint à l'émigration, il eut même, nous dit l'abbé Gueguen, "l'audace de venir habiter le château". Cependant il fut "honni de tous, et conspué par tous les habitants du voisinage".
Il jugea donc sans doute préférable de regagner Paris, et revendre son domaine dès qu'il le put. -
------------- Période parisienne ------------- - 1799 : Procuration Le Tom à sa femme - minute - 3/7/1799 (AN MC ET/XV/1128), toujours chez le notaire Claude Chodron.
Rolland Le Tom et sa famille habitent rue Neuve Egalité, division de Bonne-Nouvelle. - 1801 : Cautionnement Le Tom - minute - 27/9/1801 (AN MC ET/XV/1142)
- 1801 : Obligation Le Tom, demeurant à Paris rue Neuve Egalité, à Langlais - 27/9/1801 (AN MC ET/XV/1142)
- 1801 : Procuration Rolland Le Tom, demeurant à Paris Rue Neuve Egalité - 23 frim. IX (AN MC REP/XV/15)
- 1801 : Procuration Rolland Le Tom, demeurant à Paris Rue Neuve Egalité - 12 frim. X (AN MC REP/XV/15)
- 1802 : Vente de Brezal à Jean-Maurice Pouliquen et Louis Madiec, le 27 ventôse an 10, 18/3/1802 au rappport de Me Ollivier, notaire à Landerneau.
- 1802 : Dépôt Perier, Le Tom et Le Payen - 6/4/1802 (AN MC ET/XV/1146)
- 1802 : Compte et délégation de Rolland Le Tom à JP. Thierry - 17/4/1802 (AN MC ET/XV/1146)
- 1804 : Procuration de Rolland Le Tom demeurant rue Neuve Egalité - 10 pluviose 12 - 31/1/1804 (AN MC/REP/XV/16)
- 1804 : Bail de Rolland Le Tom, demeurant rue Neuve Egalité, à Christophe Frais, demeurant rue des Citoyennes - 20 messidor 12 - 9/7/1804 (AN MC/REP/XV/16)
- 1804 : Procuration de Rolland Le Tom et Victoire Honorine Gilles, demeurant rue Neuve Egalité - 14 vendemiaire 13 - 6/10/1804 (AN MC/REP/XV/16)
- 1818 : Rolland le Tom participe à l'inventaire après décès de sa fille de Marie-Zénobie - 25/2/1818 (AN MC/ET/LXVI/875)
On apprend qu'il habite rue St-Jean au Gros Caillou, n° 12 et qu'il a été nommé subrogé tuteur de son petit-fils, Honoré Jean Hubert MATERRE. - 18xx : ...
- 1831 : Rolland Le Tom touche une pension de 600 f. pour services rendus à la cause royale.
- 18xx : Décès de Rolland Le Tom
- 1835 : Victoire Honorine Gilles est veuve et elle habite à St-Germain-en-Laye. On l'apprend par l'inventaire après décès de sa soeur Marguerite-Rose, qui se fait par le notaire Guillaume Bouclier (Etude LXVI) le 4 août 1835.
... à suivre...
C'était une première approche dans la découverte du personnage de Roland Le Tom. Mais bien des questions se posent encore :
1 - quelles étaient ses relations réelles avec la famille de Tinteniac à Brezal ? à Paris ?
2 - d'où provenait la fortune de Le Tom pour acheter tout Brezal ? propriétaire à Paris ? Oui, mais de quoi et comment ? quelle était la fortune de ses parents ?
3 - quelles étaient ses occupations parisiennes ? gérant de biens ?
4 - quel service a-t-il rendu à la cause royale pour mériter une pension ?
Dès que nous découvirons une réponse ou deux à ce sujet, nous ne manquerons pas de mettre à jour cette page. A suivre...
Chose promise, chose due, voici quelques réponses :
- Nous avons noté les liens de Rolland Le Tom avec le lieu de Brezal avant la Révolution et donc ses liens avec du marquis Hyacinthe-Joseph de Tinteniac. Nous avons remarqué la présence de François-Hyacinthe de Tinteniac, le père du précédent, lors de la signature du son contrat de mariage à Paris. Ce même contrat nous précise que Le Tom reçoit "200 livres de pension viagère que luy fait M. le Comte de Tinteniac", certainement pour les services qu'il rendait à celui-ci.
Il était donc aussi le serviteur de Francois-Hyacinthe et c'est probablement lui qui l'a conduit à Paris. On sait, ne serait-ce que par la lecture des archives notariales de Paris, que les nobles du Léon et de Cornouaille fréquentaient beaucoup la capitale au 18è siècle... et parfois la famille royale.
- Quant à la fortune nécessaire pour acheter Brezal, elle devait être importante. En effet, voici, dans l'encadré à droite, les prix de vente au moment de la révolution (je n'ai pas les prix de rachat par Le Tom, mais ils devaient être assez proches) :
Par rapport à ce prix, le contrat de mariage précise la fortune du couple, dix ans environ plus tôt :- Le manoir et pourpris de Brezal ... 33.883 livres - la Grande Métairie de Brezal (*) 141.000 livres - le moulin de Brezal 7.200 livres - le lieu de Brezalou 2.700 livres Total 184.783 livres
(*) Elle fut adjugée à Le Tom pour 141.000 livres !!!
alors que sa mise à prix n'était que de 5.830 livres.
"Les futurs époux se marient avec les biens et droits à chacun d'eux appartenant.
Ceux du futur époux consistent
1° en une somme de 6.000 livres en deniers comptants
2° en ses habits, linges, hardes, bijoux et meubles qu'il évalue être de la somme de 3.000 livres
3° en trois maisons scises à St-Paul-de-Léon : une rue du Four, une autre Grande Rue et la 3è au Porsemeur
4° et en 200 livres de pension viagère que luy fait M. le Comte de Tinteniac.
Le tout provenant de ses gains et épargnes et dont il a donné à connoitre à ladite future épouse.
Ceux de la future épouse consistent
1° en une somme de 6.500 livres en deniers comptants
2° en ses habits, linges, hardes et bijoux à son usage qui sont de la valeur de la somme de 5.300 livres
3° en un billet de la loterie royalle établi par arrêt du conseil du 5 avril 1783 Nté 34126 et garni de ses coupons d'intérêts à compter de la présente année,
le tout provenant de ses gains et épargnes.
4° en ses droits en la succession de ses père et mère dont elle est héritière pour un cinquième et constatés par l'inventaire fait après le décès de ladite dame sa mère par Me Lemoine, l'un des notaires soussignés le 20 mars dernier et qui ne sont pas encore liquidés,
5° et en une somme de 1.500 livres à elle due par la succession de la dame sa mère pour le montant du legs de pareille somme à elle fait par S. Charles Lemaître par son testament reçu par ledit Me Lemoine le 22 novembre 1783,
dont du tout elle a donné à connoitre audit S. futur époux qui consent de demeurer chargé des deniers comptants, habits, linges, hardes et bijoux cy-dessus énoncés ainsy que dudit billet de loterie susnommé par la seule célébration dudit futur mariage."
Un peu juste pour acheter Brezal, non ? En 10 ans, leur fortune se serait-elle considérablement accrue ?
- Question à traiter
- Question à traiter

L'ancien château de Brezal, tel que l'acheta Rolland Le Tom.
Sylvain Gabriel Ferrand de Saligny
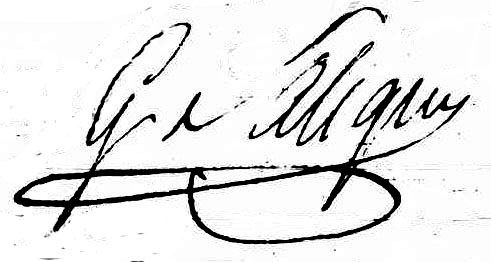 |
|
Famille
Jean FERRAND, fermier de la seigneurie de Bengy, marié avec Espérance BARDET, dont- Jean Robert FERRAND, né vers 1703, décédé le 25 novembre 1760, Bengy-sur-Craon (Cher) (à 57 ans).
Marié le 10 juillet 1725 avec Gabrielle LESELLIER, dont- Catherine Espérance FERRAND, née le 13 août 1726, Bengy-sur-Craon (Cher).
- Marie FERRAND.
- Jacques Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 27 mai 1740, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 29 juin 1814, Bourges (à 74 ans), fermier de la seigneurie de Bengy, commissaire du roi à l'administration provinciale de Berry, propriétaire.
Marié le 7 mai 1767, Bannegon (Cher), avec Catherine LE BLANC de la MORLIERE, née vers 1744, décédée le 26 janvier 1772, Bengy-sur-Craon (Cher) (à 28 ans), dont- Sylvain Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 17 mars 1768, Bourges, décédé le 17 mai 1831, Corbeil (à 63 ans), directeur des contributions indirectes.
Marié le 17 octobre 1803, Paris, avec Adélaïde Thérèse Louise GAU des VOVES, née le 9 octobre 1781, Villeneuve-sur-Yonne (89), dont- Charles Gustave Adolphe Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 14 avril 1806, Beauvais, décédé le 16 mars 1849, Paris (à 42 ans), colonel, chevalier de l'Empire. Marié le 7 novembre 1831 avec Louise Antoinette Zoé TERREYRE.
- Scholastique FERRAND de SALIGNY, née le 28 mai 1777, Bengy-sur-Craon (Cher), décédée le 5 octobre 1864, Bengy-sur-Craon (à 87 ans).
Mariée le 22 septembre 1795, Bourges, avec Mathieu LASNE des VAREILLES. - Espérance-Louise FERRAND de SALIGNY, née le 28 mai 1777, Bengy-sur-Craon (Cher), décédée le 19 janvier 1877, Bourges (à 99 ans).
Mariée le 3 février 1794, Bourges, avec Gilbert DANIE de GUILLY, né le 26 juillet 1772, St-Pierre-Le-Marché, Bourges. - François-Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 29 novembre 1781, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 12 octobre 1844, Foëcy (Cher) (à 62 ans), militaire, chevalier de l'Empire. Marié avec Marie Virginie FIOT.
- Fulgence-Maurice FERRAND de SALIGNY, né le 25 septembre 1787, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 24 avril 1853, Paris (à 65 ans), militaire.
- Sylvain Gabriel FERRAND de SALIGNY, né le 17 mars 1768, Bourges, décédé le 17 mai 1831, Corbeil (à 63 ans), directeur des contributions indirectes.
- Jean FERRAND, né le 20 mars 1742, Bengy-sur-Craon (Cher), décédé le 16 octobre 1745, Bengy-sur-Craon (à 3 ans).
La famille est originaire de Bengy-sur-Craon, département du Cher, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Bourges. Le village de Saligny-le-Vif se trouve à cinq kilomètres de Bengy.
Notes
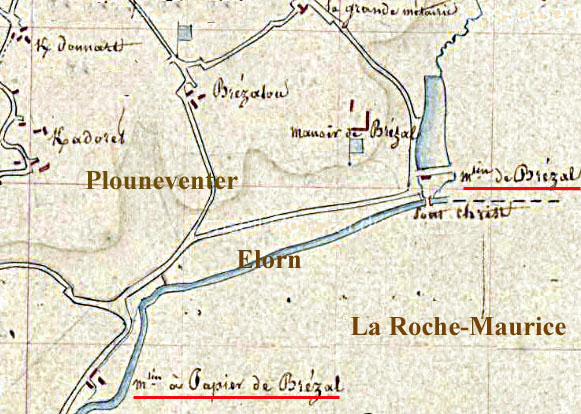
Sylvain Gabriel Ferrand de Saligny nous intéresse particulièrement car il fut l'acquéreur du moulin à papier de Brezal, quand celui-ci fut vendu comme bien national le 6 floréal an VI, c'est-à-dire le 25 avril 1798.
Mais le moulin à papier de Brezal ne fut pas le seul bien national qui l'intéressa : il acheta, dans le Finistère, tous les biens qui suivent dans le tableau ci-dessous.
Cette liste a déjà le mérite de nous préciser que son nom complet était "Sylvain Gabriel Ferrand de Saligny" et qu'il était négociant à Paris. Heureusement car sur certains documents il est nommé simplement "Saligni" ou "Ferrand Saligni" ou "Silvain Gabriel Saligny".
Le moulin à farine, près de l'étang de Brezal, fut lui acheté par Michel Le Lann pour le compte de Rolland Le Tom.
| Paroisse | Bien | Propriétaire précédent | Nom de l'acheteur | Date de l'achat | Prix |
| Guiler | Kerboroue | D. R. | Saligny | 1 floreal an VI | |
| Kerlouan |
|
Evêché de Saint-Pol | Ferrand Saligny | 5 thermidor an VI | |
| Kerlouan | Quatre pièces de terre sablonneuse au terroir de Pors Huet | Evêché de Saint-Pol | Ferrand Saligny | 5 thermidor an VI | |
| Kerlouan | Pièce de terre sablonneuse au terroir de Quellenec | Evêché de Saint-Pol | Ferrand Saligny | 5 thermidor an VI | |
| Kersaint-Plabennec | Parc an ortil ou parc ar sant à Keroulach | Fabrique de Ploudaniel | Silvain Saligny | 4 germinal an VI | |
| Lampaul-Guimiliau | Parc Santes Anna au terroir de Guernopic | Fabrique de Sainte-Anne | Silvain Saligny | 21 floréal an VI | |
| Lampaul-Guimiliau | Le terroir de Guernospic | Fabrique de Sainte-Anne | Silvain Saligny | 21 floréal an VI | |
| Lampaul-Guimiliau | Le parc Foennec | Fabrique de Sainte-Anne | Silvain Saligny | 24 floréal an VI | |
| Loperhet | Kerandraon | Laval Montmorency | Silvain Gabriel Saligni, négociant, demeurant ordinairement à Paris | 4 germinal an VI | 32.100 F |
| Loperhet | Kerlaouen | Laval Montmorency | Silvain Gabriel Saligni, négociant, demeurant ordinairement à Paris | 4 germinal an VI | 13.200 F |
| Loperhet | Autre lieu de Kerlaouen | Laval Montmorency | Silvain Gabriel Saligni, négociant, demeurant ordinairement à Paris | 4 germinal an VI | 19.000 F |
| Ploudaniel | Autre lieu de Languilly | Barbier de Lescoet | Guillaume Le Gennie, Gabriel Saligny Ferrand | 5 fructidor an VI | |
| Plouneventer | Moulin à papier de Brezal | Tinteniac | Silvain Gabriel Saligny, demeurant à Paris | 6 floreal an VI | 14.300 F |
Autres biens convoités par Saligny, mais qui ont été acquis par de meilleurs enchérisseurs :
- le moulin à papier de Penn-ar-Fers en Ploudiry, produisant le revenu de 216 francs sera acheté par Salomon Piton, demeurant audit moulin, pour 42.100 francs
- le moulin de Lansolot en Plouneventer, produisant un revenu de 275 fr. sera acheté par Jean Peron, demeurant au moulin, pour 24.100 fr.
- le lieu de Brezalou et dépendances sera acheté par François Marie et Yves Marie Derrien, de Landivisiau, pour 52.400 francs
On constate une grande dispersion des biens achetés.
2 - Quelques jalons dans la vie de Saligny :
- 1768 : naissance le 17 mars 1768 à Bourges (Cher)
- 1787 : à Paris, le 30 août il signe devant Abraham Silly et Auguste Alleaume, notaires au Châtelet de Paris, une procuration pour que le curé de Bengy-sur-Cher le représente comme parrain de son demi-frère Fulgence-Maurice. Le baptême est prévu le 29 septembre.
- 1798 et avant : négociant à Paris
- 1798 : en Finistère, il achète des biens nationaux du 20/4/1798 au 23/7/1798.
- 1803 : à Paris, le 17 octobre 1803, il épouse Adélaïde Thérèse Louise Gau des Voves.
- 1806 : à Beauvais, le 14 avril 1806 c'est la naissance de son fils Charles. Le père est dit "inspecteur de l'administration des droits réunis". La signature présentée plus haut est extraite de l'acte de baptême.
- 1831 : décès à Corbeil, alors qu'il est "directeur des contributions indirectes".
3 - La fortune du père, Jacques Gabriel Ferrand de Saligny :
Les activités de négociant de Sylvain Gabriel lui fournirent-elles les revenus nécessaires pour acheter tous ces biens nationaux dans le Finistère ? On peut en douter car il délaissa ces activités pour consacrer la majeure partie de sa vie professionnelle au service de l'état comme fonctionnaire de l'administration fiscale. Par contre, la fortune de son père a pu rendre possible toutes ces acquisitions.
Jacques Gabriel Ferrand de Saligny fut l'un des grands notables du département du Cher à son époque. L'apparence nobiliaire que lui confère le port de la particule n'a aucun autre fondement que l'ascension sociale de sa lignée, articulée sur le passage du service seigneurial au service de l'état. Son aïeul Jean Ferrand, époux d'Espérance Bardet, était fermier de la seigneurie de Bengy. Son père, Jean Robert Ferrand, uni à Gabrielle Lesellier, adjoignit à cette lucrative activité la fonction de subdélégué de l'intendant à Bengy.
Jacques Gabriel, devenu avocat en parlement, fonction qu'il n'exerça pas, et sieur de Saligny, se consacra à la mise en valeur de ses domaines fonciers. La stature familiale et personnelle de Ferrand de Saligny a déjà suffisamment de relief à la fin de l'Ancien Régime pour qu'il soit appelé comme député du tiers au sein de l'assemblée provinciale du Berry dès sa création.
Son opulence est déjà considérable sous l'Ancien Régime. Son second contrat de mariage, dressé par Me Colinet à Nérondes le 14 novembre 1775, chiffre la valeur de ses apports à 71.000 livres en immeubles, bestiaux, grains, argent et effets. Ceux de sa conjointe montent à 23.268 livres en biens fonciers et bestiaux à Nérondes, Les Aix et Parassy, outre des promesses successorales diverses de quelques milliers de livres. Les revenus de notre notable sont évalués à 8.000 F en 1793 de même qu'en 1809, ce qui correspond à un patrimoine (minoré par rapport à la réalité) de 160.000 F.
Possédant déjà très aisé avant 1789, comme on l'a vu, il accroît encore son patrimoine à la faveur du grand marché des biens nationaux. Le 10 mai 1791, il fait emplette d'une maison du cloître Saint-Etienne pour 15.000 livres. Le 4 juin suivant, il acquiert pour 83.000 livres la maison seigneuriale et la réserve de Bengy, ainsi que, moyennant 27.100 livres, l'ancien moulin de Bengy et ses dépendances. Les conditions de paiement de ces biens provenant de l'église de Bourges en font des acquisitions particulièrement avantageuses : en effet, leur règlement, échelonné en quinze termes pour le premier et onze pour le second jusqu'en 1795, s'effectue exclusivement en assignats. Enfin, Ferrand de Saligny complète ses achats par une parcelle de douze boisselées de terres venant de la fabrique de Bengy le 29 thermidor en II (16 août 1794) pour 605 F.
Les termes des règlements de ses acquisitions dans le Cher s'achevant en 1795, Ferrand de Saligny put sans doute retrouver quelques ressources pour des achats supplémentaires en Finistère en 1798.
Suspecté d'être contre la Révolution, il fut emprisonné temporairement, mais redevenu un homme d'influence avec la stabilisation consulaire, l'ancien suspect dresse à la demande du préfet la liste des prétendants potentiels aux mairies rurales environnantes en l'an VIII. Lui-même fait partie de la première série de maires nommés par l'arrêté du 9 floréal an VIII (29 avril 1800), qui lui confère la municipalité de Bengy-sur-Craon. Répertorié parmi les notables départementaux du Cher le 26 nivôse an X (16 janvier 1802) et membre du collège électoral du département, il est classé parmi les Soixante propriétaires les plus distingués du Cher en 1806. Renouant avec son ancienne participation à l'assemblée provinciale du Berry, il est nommé conseiller général du Cher le 3 mai 1807.
Notable riche et respecté, Ferrand de Saligny est jugé "très estimé et très attaché au gouvernement" par l'administration préfectorale en mai 1809. Il meurt trop tôt, le 29 juin 1814 à Bourges (à 74 ans), pour pouvoir démentir cette appréciation en faisant allégeance à la Restauration.
L'heureux possédant pointe au 18è rang des trente principaux contribuables du Cher de l'an XIII avec 2.721,40 F de cote d'imposition, et progresse au 13è rang du même classement en 1811. Son bilan successoral approche les 250.000 F. La déclaration faite au bureau de Bourges le 10 décembre 1814 se monte à 58.909 F. Les biens de la communauté y incluent les effets mobiliers et la maison familiale de la rue Moyenne (d'une valeur de 24.000 F), mais la maison du cloître de Saint-Etienne (pour 14.000 F) et 5.408,50 F de capitaux de rentes sont des propres du défunt. La part de succession relevant du bureau de Baugy est majoritairement composée des biens propres. Le total qui y est déclaré le 14 décembre est de 4.000 F de mobilier et de 182.936 F d'avoirs immobiliers, réunissant la maison du maître de Bengy et ses dépendances, cinq domaines agricoles (Les Prugnes, Crevolles, Argenton, Saligny et la Croix Blanche), une dizaine de locatures, huit prés, six bois, un taillis, une chenevière et diverse parcelles de terres, ainsi que de nombreux lots de bestiaux affermés en baux à cheptel.
Rédigé avec des extraits de l'ouvrage Les grands notables impériaux - département du Cher - vol. 29
4 - Pourquoi des achats dans le Finistère si loin de Bourges ?
La question reste à étudier.
Guillaume Le Roux, acquéreur de Brezal en 1847
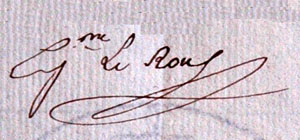 |
|
Parents
- Guillaume LE ROUX, né le 27 août 1766 à Kerjézéquel, Pleyber-Christ, décédé le 22 mai 1794 à Brest à l'âge de 27 ans
- Marguerite LE BRAS, née le 4 mai 1768 à Guimiliau, décédée le 15 mai 1844 à Landivisiau à l'âge de 76 ans
- Mariés le 23 octobre 1785 à Landivisiau.
Guillaume Le Roux, père, était l'un des 26 administrateurs du Finistère, guillotinés le 22 mai 1794, pour cause de libéralisme. Il fut exécuté l'année même de la naissance de son fils Guillaume, dont nous parlons ici.
Le mariage de Guillaume et de Marguerite "rassembla de nombreux marchands de toile dont Guy Le Guen de Kerangal et Jacques Queinnec, futur Conventionnel et cousin du marié. Les épousailles sont endeuillées par le décès de Louis-François Le Roux, âgé de 54 ans, qui meurt le lendemain du mariage de son fils. L'inventaire effectué après le décès de ce marchand de toile est tout à fait exceptionnel : le défunt laisse, en biens meubles, une valeur de 111.333 L., dont près de 100.000 L. en fil et en toiles. C'est l'inventaire le plus important qui soit connu dans le groupe social des Juloded. Jean Tanguy estime que ce marchand de toile faisait travailler quelques 200 tisserands" (source L. Elegoet).

Sur ce cliché de 1868, Guillaume Le Roux, peu de temps avant son décès, avec à sa droite son gendre Charles Huon de Penanster (1832-1901), à sa gauche ses fils Albert (1839-1912) et Léon (1837-1912). Assises, la femme d'Albert, Zoé Puyo (1848-1879), et celle de Charles, Claire Le Roux (1849-1927) avec son 1er enfant (source vhdp).
Mariage et enfants
Marié le 2 février 1835, St-Segal, avec Clara BAZIL (Marie Gabrielle Clara à l'état-civil), née le 3 octobre 1810, Port-Launay, décédée le 25 septembre 1891, Lourdes, inhumée dans la chapelle de Brezal (à 80 ans), dont- François Guillaume LE ROUX, né le 31 mars 1836, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 3 juin 1838, Landivisiau (à 2 ans).
- Léon Guillaume LE ROUX (Ernest Guillaume Marie Léon à l'état-civil), né le 9 septembre 1837, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 23 septembre 1912, Sarzeau, enterré le 26 septembre 1912, Chapelle de Brezal, Plouneventer (à 75 ans), associé, consul de France.
Marié le 22 novembre 1887, Comté de Lancastre, Grande-Bretagne, avec Julia Adèle HERMAN, née en 1860, Bahia, décédée en 1948, Vannes (à 88 ans). - Albert LE ROUX (Pierre Edouard Guillaume Albert à l'état-civil), né le 22 mai 1839, Rue de l'église, Landivisiau, décédé le 11 septembre 1912, Château de Brezal, Plouneventer, enterré à Morlaix (à 73 ans), banquier, dirigeant de la Société linière.
Marié le 18 juin 1866, Morlaix, avec Zoé PUYO, née le 26 décembre 1848, Rennes, décédée le 4 mars 1879, Rue de la Villeneuve, Morlaix (à 30 ans). - Anonyme LE ROUX, née le 12 janvier 1841, Landivisiau, décédée le 12 janvier 1841, Landivisiau.
- Marie Herminie Clara LE ROUX, née le 14 janvier 1845, Rue de l'église, Landivisiau, décédée le 21 janvier 1845, Rue de l'église, Landivisiau.
- Claire LE ROUX (Marie Anne Léonie Claire à l'état-civil), née le 25 avril 1849, Rue de l'église, Landivisiau, décédée le 9 juin 1927, Paris (à 78 ans).
Mariée le 17 juin 1867, Plouneventer, avec Charles HUON de PENANSTER, né le 11 août 1832, Lannion, Côtes-d'Armor, décédé le 31 mai 1901, Runfao, Ploubezre, Côtes-d'Armor, enterré à Runfao, Ploubezre, Côtes-d'Armor (à 68 ans), propriétaire, sénateur des Côtes-du-Nord.
Clara Bazil est fille de Jean (né à Landunvez en 1775, décédé à St-Segal le 16/1/1829), capitaine au long cours et de Marie-Anne Le Marchadour, négociante. En 1835, Ildut-Marie Bazil, oncle paternel de la mariée, est négociant à Brest, alors que l'oncle maternel Gabriel Le Marchadour est notaire à Châteaulin.
Biographie
- Guillaume Le Roux réunit les conditions pour devenir négociant et industriel : il est riche, il réside à Landivisiau et, surtout, il ne manque pas d'esprit d'initiative. En 1836, les époux Le Roux emploient quatre domestiques. En 1845, ils font fonctionner une blanchisserie et un important atelier de tissage à Landivisiau.
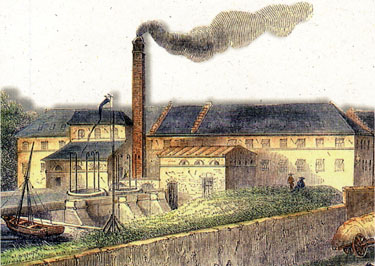 En septembre 1845, Guillaume Le Roux s'associe avec des fabricants de Landerneau (Poisson, Heuzé, Goury, Radiguet), qui avaient déjà créé un atelier de tissage en 1820, et leurs collègues de Morlaix (Charles Homon et Joseph Desloges) pour créer la Société linière. Outre, les importants bâtiments construits à Traon-Elorn à Landerneau, la Société linière se compose des apports des associés. Les Landernéens y apportent la blanchisserie du Lech, l'ancien couvent des Capucins et quatre ateliers de tissage : ceux de Landerneau, Sizun, Commana et Ploudiry. Charles Homon apporte deux blanchisseries situées à Plourin, près de Morlaix, de même que deux ateliers de tissage : l'un, à Landivisiau, contient 70 métiers ; l'autre, à Saint-Sauveur, en renferme 60. De son côté, Guillaume Le Roux apporte une blanchisserie et un atelier de tissage pourvu de 60 métiers. Ces établissements sont à Landivisiau.
En septembre 1845, Guillaume Le Roux s'associe avec des fabricants de Landerneau (Poisson, Heuzé, Goury, Radiguet), qui avaient déjà créé un atelier de tissage en 1820, et leurs collègues de Morlaix (Charles Homon et Joseph Desloges) pour créer la Société linière. Outre, les importants bâtiments construits à Traon-Elorn à Landerneau, la Société linière se compose des apports des associés. Les Landernéens y apportent la blanchisserie du Lech, l'ancien couvent des Capucins et quatre ateliers de tissage : ceux de Landerneau, Sizun, Commana et Ploudiry. Charles Homon apporte deux blanchisseries situées à Plourin, près de Morlaix, de même que deux ateliers de tissage : l'un, à Landivisiau, contient 70 métiers ; l'autre, à Saint-Sauveur, en renferme 60. De son côté, Guillaume Le Roux apporte une blanchisserie et un atelier de tissage pourvu de 60 métiers. Ces établissements sont à Landivisiau.
Le directeur de la société, F.-M. Heuzé, émet 2.000 actions, dont la moitié est acquise par les associés. Elles permettent d'équiper les bâtiments de Traon-Elorn en machines relativement modernes. Le nouvel établissement industriel vend des fils et des toiles. Dès les années 1850, la production y est de l'ordre de 1.200.000 mètres. Le personnel de la Société linière oscille entre 1.200 et 2.500 employés tous établissements confondus. (source L. Elegoët / Y. Blavier)
- En 1847, Guillaume Le Roux achète le domaine de Brezal, et de nombreuses fermes qui en dépendaient, à Louis Désiré Véron. On notera que le moulin à papier de Brezal ne faisait plus partie du domaine depuis longtemps, car il avait fait l'objet d'un lot à part lors de la vente des biens nationaux.
- Autour de 1861, il fait démolir l'ancien manoir de Brezal et ses dépendances immédiates dont l'antique chapelle. Il cèdera le clocheton de celle-ci à son ami Bourles de Kerizella en Guimiliau. Et il fait construire le château actuel et la nouvelle chapelle dédiée à sainte Claire et saint Guillaume, les saints patrons des deux époux de Brezal.
Il s'installe donc à Brezal où il s'écarte de plus en plus des affaires, en menant une vie de propriétaire terrien à l'écart de ses collègues. Il consacre, en revanche, du temps à la politique puisqu'il est conseiller général de 1833 à 1852. A cette dernière date, il est largement battu par Jacques Abgrall, de Roc'haouren en Lampaul-Guimiliau. (Notons que ce Jacques Abgrall possède aussi des terrains à Pont-Christ).
- La Société linière permet à Guillaume Le Roux, déjà riche, de s'enrichir bien davantage. En 1868, elle lui procure des bénéfices qui s'élèvent à 46.928 F. En 1869, ils sont de 62.991 F. A ces gains s'ajoutent les dividendes de ses actions et les revenus de ses terres. (source L. Elegoet / Y. Blavier)
- En ce qui concerne le moulin de Brezal, en 1856, il fait bâtir tout à côté une distillerie de betteraves. Elle sera remplacée en 1876, donc après sa mort par une station de haras, probablement sous l'influence et avec la participation de son fils Léon-Guillaume.
- Il ne manquait pas d'idées, car en 1858 il utilise la force motrice du moulin de Brezal pour faire tourner une batteuse.
- Il était soucieux de la bonne irrigation de ses prairies : en 1864, il fait construire un aqueduc afin qu'une partie des eaux de fuites du moulin de Brezal atteigne la prairie située en face de l'église de Pont-Christ. Cet aqueduc traversait le chemin qui montait sur la chaussée de l'étang et la RN12 (aujourd'hui D712).
- Là ce n'est pasSon portrait par Yves Blavier : " Guillaume Le Roux, conseiller général, mène presque une vie d'ermite à Brezal. D'opinion politique, il semble proche des Légitimistes et aussi du catholicisme social. Paternaliste, il distribue nombre d'aumônes à ses métayers et paye les vêtements de première communion. Sa famille est d'ailleurs intime avec le Comte Albert de Mun, théoricien du Christianisme social. Cette opinion l'oppose à ses collègues [de la Société linière] qui lui reprochent sa réticence à licencier dans les périodes difficiles ".
Guillaume
mais Albert
Blavier écrit encore, à propos du budget des ouvriers lors de la flambée des prix en 1855 : " Guillaume Le Roux plus philantrophe que ses collègues, donne de la soupe à ses ouvriers de Landivisiau. Ses associés comprennent qu'il est nécessaire d'aider leur personnel pour les conserver : ... à la soupe, s'ajoute la distribution de pain à prix réduit ".
Léon-Guillaume Le Roux, fils de Guillaume et frère d'Albert
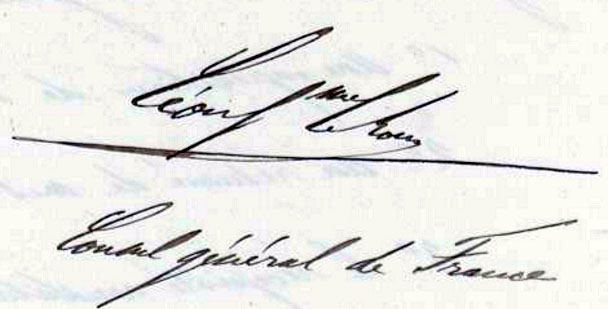 |
|
Parents
- Guillaume LE ROUX, né le 1er janvier 1794 à Landivisiau, décédé le 9 octobre 1868 au Château de Brezal, Plouneventer (à l'âge de 74 ans)
- Clara BAZIL (Marie Gabrielle Clara à l'état-civil), née le 3 octobre 1810 à Port-Launay, décédée le 25 septembre 1891 (à l'âge de 80 ans)
- Mariés le 2 février 1835 à St-Segal
Mariage et enfants
Marié le 22 novembre 1887, Comté de Lancastre, Grande-Bretagne, avec Julia Adèle HERMAN, née en 1860, Bahia, décédée en 1948, Vannes (à l'âge de 88 ans), dont- Albert LE ROUX, né le 26 août 1888, Manchester, décédé le 17 avril 1916, Bras (Meuse) (à l'âge de 27 ans).
- Marguerite LE ROUX, née le 9 juin 1890, Manchester, décédée en 1970, enterrée à Vannes (à l'âge de 80 ans).
- Léon LE ROUX, né le 8 mai 1893, Manchester, décédé le 17 septembre 1909, Gâvres, Morbihan (à l'âge de 16 ans).
Biographie
- Léon-Guillaume Le Roux participe aux activités de la Société linière
- Dès 1866 au moins, car cette année-là il est recensé à Brezal, avec ses parents et sa soeur Clara, et il est dit "associé"
- Il possède des actions de la Société (80 actions d'une valeur de 80.000 F).
- De 1870 à 1872, il est responsable du dépôt de fils de Landivisiau, situé dans le quartier de la gare.
En 1872 il est recensé à Landivisiau, "négociant, 34 ans", avec un commis, Joseph Derrien. Bien sûr, ce seul nom n'est pas limitatif du personnel qu'il emploie .
. - Il rachète à la Société la fabrique de Saint-Sauveur pour la diriger lui-même en 1872.
La Société linière par Yves Blavier p. 192 :Dans les années 1870, la Société linière possède au moins trois grands dépôts de fils, un à Landivisiau, un autre à Loudéac et le troisième à Amiens (Somme). Le dépositaire de Loudéac, Le Verger, est aussi fabricant de toile et blanchisseur.
Le dépôt de Landivisiau fonctionne comme une annexe de la Société linière. Son responsable, Léon-Guillaume Le Roux, est d'ailleurs le neveu d'un des gérants (non, ce n'était pas le neveu mais le fils de Guillaume Le Roux). Il possède des actions de la Société (80 actions d'une valeur de 80.000 F). Enfin, Le Roux rachète à la Société la fabrique de Saint-Sauveur pour la diriger lui-même en 1872.
Le jeune homme dirige ce dépôt en qualité de négociant-commissionnaire, c'est-à-dire d'intermédiaire, il a ses propres employés comme le charretier qui transporte les fils de Landerneau à Landivisiau et il doit équilibrer ses comptes sans espérer l'aide de ses parents. C'est pourquoi il renvoie sans sourciller la marchandise qui lui semble de mauvaise qualité !
Le compte de ses ventes pour un semestre de 1872 (AML - Fonds de Penanster 14 août 1872 - Dossier G.L. Le Roux) nous permet de déterminer la commission de Le Roux. De janvier à juin 1872, la Société linière reçoit les sommes suivantes pour la vente des fils :
Janvier 30.754,50 F Avril 18.353,50 F Fevrier 27.325,25 F Mai 22.873,00 F Mars 28.875,25 F Juin 22.505,75 F Pour le premier semestre 1872, on obtient un total de 151.687,25 F sur lequel Le Roux prélève une commission de 1,1/4 % à laquelle s'ajoute ses frais généraux. Il reçoit ainsi 2.121 F soit 1,4 % du chiffre d'affaires (ce sont les bénéfices bruts sur lesquels sont prélevés les frais généraux). Cette commission peut sembler peu importante en comparaison des 5 ou 8 % de certains dépositaires de toiles. Ce parent d'un des dirigeants de la Société se contente peut-être d'un bénéfice moindre pour faire son apprentissage du négoce ! Mais la vraie explication se trouve sans doute dans la localisation de ce dépôt. En effet, implanté en milieu rural, Le Roux fournit du fil aux tisserands appauvris des campagnes bretonnes alors que la vente de toiles dans les ports est beaucoup plus rentable. Fermer X

Etalon Corlay, rouan, 1 m 57
Père : Flying Cloud, norfolk - Mère : Thérésine, fille de Festival, pur-sang
Record : 1 m. 45 s.
C'est à Flying-Cloud, norfolk, né en 1856 et arrivé à Lamballe en 1864 que l'on doit la naissance de Corlay, né en 1872, chez M. Poézevara, de Canihuel (Côtes-d'Armor), il était sorti d'une petite jument de galop Thérésine, ayant trois croisements connus de sang pur, Festival, Craven et Lally.
Après les victoires qu'il remporta sous la houlette de Léon-Guillaume Le Roux, il fut acheté par les haras et fit pendant 20 ans, entre 1876 et 1897, la monte dans la Montagne bretonne à la station de la commune dont il portait le nom. Il y servit aussi d'étalon reproducteur et comme les grands sires en général il fut prolifique, sans que l'on ait pu accuser son chef de station de le ménager outre mesure.
De taille plutôt petite, 1 m 56, il était d'un modèle très plaisant. Son succès fut considérable avec des mères d'origine très diverses, filles de pur sang surtout (Gouvieux, Brandy face, Marin, Chassenon, etc.) ; filles de demi-sang normands (Emeutier, Pactole, Lancastre, Quiddany, Parthénon, Patrocle), ayant tous le pur-sang très près ; et enfin Bacchus, par Eperon, pur sang anglais, et fille de Ramsay, pur sang anglais. Avec Mina, fille de cet étalon, il donna Voltaire qui trottait en 1883 le kilomètre en 1 m. 40 s., ce qui était exceptionnel alors en Normadie. Avec une fille du trotteur russe Kristoffsky, il donna les trotteurs Glazard, Hercule et Martial. ...
Ces produits de Corlay étaient bons à tout : on en a vu (témoin Gladi, à M. le comte Le Gualès de Mézaubran, en 1889, au concours de Paris), qui étaient primés comme chevaux d'attelage, comme chevaux de selle, et qui se classaient dans les sauts d'obstacle, tout cela dans le même concours !
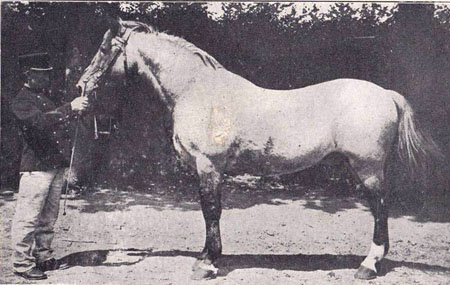
Photo : Atao, trotteur breton, rouan, né en 1878, 1,55 m, par Corlay, trotteur breton, et une fille d'Emeutier. Faisait partie de l'effectif du dépôt d'étalons de Lamballe. A été réformé en 1904. (Supplément à la Bretagne Hippique du 8 octobre 1910). - Il apparaît que la passion de Léon-Guillaume a été le cheval : tant pour son plaisir personnel, que par sa volonté de donner les moyens de développer l'élevage local et d'améliorer la race (voir l'article nécrologique plus bas).
- Il possédait une écurie de trotteurs à Brezal.
Elle a été créée vers 1866, l'année où un jockey apparaît dans le recensement de Plouneventer, "au manoir de Brezal, Gabriel Manach, 15 ans, jockey". Avant les années 1860, l'entraînement des trotteurs était à peu près inconnu en Bretagne. Le premier qui s'en occupa fut Guillaume Bastard du Ponthou. Puis M. le vicomte de Kertanguy, entra bientôt en ligne avec le fameux jockey Fercoq. Coeur de Lion, l'un des trotteurs de Pen Lan, débuta par un coup de maître en remportant, à Caen, le prix de la Plaine, avec 7 minutes 30 secondes sur 4.000 mètres.
Avec la création de son écurie vers 1866, Léon-Guillaume Le Roux est donc à ranger parmi les précurseurs. - Vers 1873, il achète un étalon de 18 mois, nommé "Corlay", et l'entraîne à courir au trot, avec la complicité de M. Le Bec, fin spécialiste. Ce cheval va devenir immensément connu par ses victoires et engendrera un grand nombre de poulains qui auront un énorme succès dans les courses.
- En 1875, le 16 août à Quimper, Corlay gagne la 2è course, "au trot". Il termine les 3.000 mètres en 5 minutes 50 secondes, soit un trot de 1 m. 56 s. au km
 .
Voici la liste (partielle) des prix décernés aux concurrents dans la journée du 16 août 1875 :
.
Voici la liste (partielle) des prix décernés aux concurrents dans la journée du 16 août 1875 :
1ère course, au galop, distance 2.000 mètres. Prix de la ville de Quimper, 1.200 fr. divisés en 3 prix. 2 concurrents :
1. Rose-d'Avril, à M. Rudulier, 2 m. 26 s., 700 fr.
2. Clair de Lune, à M. Auffret, 2 m. 29 s., 300 fr.
2è Course, au trot, distance 3.000 m. Prix du Conseil général, 800 fr. divisés en 3 prix. 7 concurrents :
1. Corlay, à M. Le Roux, 5 m. 50 s., 500 fr. (soit 1 m. 56 s. au km)
2. Bric, à M. Gravot, 6 m., 200 fr.
3. Bon'Espoir, à M. Perron, 6 m. 10 s.
4. Kerhuon, à M. Le Roux
5. Biscoas, à M. Huon
3è course, au galop, 2è épreuve de la première course :
1. Rose-d'Avril, 2 m. 30 s.
2. Clair-de-Lune, 2 m. 35 s.
4è course, au trot, deux tours d'hippodrome. Course de chevaux attelés. Prix du chemin de fer d'Orléans et de la ville de Quimper, 800 fr. divisés en 4 prix. 9 concurrents :
1. Bitche, à M. Le Nir, 8 m. 35 s., 350 fr.
2. Asur, à M. Huon, 8 m. 46 s., 200 fr.
3. Mina, à M. Perron, 9 m., 150 fr.
4. Bric, à M. Gravot, 10 m. 25 s. 100 fr.
5. Kerhuon, à M. Le Roux, 10m. 26 s.
6. Quérèoazen, à M. Le Roux, 10 m. 34 s.
7. Moëlan, à M. Cornic, 11 m. 30 s.
5è course, steeple-chase, 3.000 mètres environ et 15 obstacles. Prix de la Société, 600 fr.
Source Le Finistère du 18 août 1875.
Fermer X - En 1875 toujours, à Toulouse, ce poulain, dirigé par M. Le Bec, enleva, en 7 minutes sur 4.000 mètres, le prix des étalons de trois ans. Quels progrès depuis 1860 ! Alors, les meilleurs pouvaient trotter le kilomètre en 2 minutes, Corlay réussissait en 1 minute 45 secondes au km !
- En 1875 encore, Léon-Guillaume Le Roux fonde le concours hippique de Brest.
- En 1876, il est recensé à Brezal, avec un cocher et un autre domestique.
- En lisant la presse ancienne et le résultat des courses, on apprend que Le Roux a eu un certain nombre de poulains qui se sont bien comportés :
- en 1878, à Morlaix : dans la 4è course, son cheval Télescope est 3è, dans une autre course Tulau est 5è
- en 1879, à St-Pol : dans la course au galop, Tire-Lire est 3è, et, par ailleurs, remporte largement le steeple-chase - Le 7 mars 1881, Léon-Guillaume Le Roux, qui sait avoir été nommé vice-consul de France à Manchester, vend son écurie aux enchères. On y trouve
1° Astrolabe, poulain entier, alezan, né en 1878, par Gouvieux et une jument de la Montagne ; 2ème prime au concours de Landerneau. Il a 300 fr. à recevoir pour cette prime.
2° Aurore, pouliche romaine, née en 1878, par Corlay et une jument de la Montagne.
3° Bolero, poulain entier, alezan, né en 1879, par Patrocle et une fille de Gouvieux, primé au concours de St-Thégonnec. Il touchera 260 fr. s'il reste jusqu'au concours de 1881 dans la circonscription de la société.
4° Brierou, poulain entier, bai brun, né en 1879, par Marin et une jument de la Montagne, engagé dans le Derby de Rouen en 1882.
- Il possédait une écurie de trotteurs à Brezal.
- Puis Leon-Guillaume Le Roux se lance dans la diplomatie :
- En 1881, il est Vice-consul à Manchester (Angleterre)
 . C'est là que naîtront ses trois enfants.
. C'est là que naîtront ses trois enfants.
Sa nomination semble susciter des jalousies, si l'on en croit un article paru dans Ar Wirionez du 02/04/1881 : " On lit dans l'Officiel : M. Le Roux, conseiller général du Finistère, est nommé vice-consul de 1ère classe à Manchester. Cette nouvelle nous a causé une surprise que nous ne chercherons pas à dissimuler. Par considération envers la famille des plus honorables à laquelle apppartient M. Le Roux, nous nous abstenons de tout commentaire personnel. Constatons, une fois de plus, que sous la République, les droits acquis au prix de connaissances spéciales et de nombreuses années de services, n'entrent point en ligne de compte avec les titres d'un autre genre qui désignent au choix du gouvernement les candidats aux emplois de toute sorte. Plus d'un vice-consul de 2è classe, blanchi sous le harnais, ambitionnait sans doute, et à bon droit, la brillante situation faite d'emblée, sans le moindre surnumérariat, à M. Léon-Guillaume Le Roux. Nous nous efforcerons charitablement de consoler de notre mieux les électeurs du canton de Sizun, que cette nomination prive de leur mandataire au conseil général. "
Fermer X - En 1894, il est Consul à Hong-Kong (Chine).
- En 1901, il devient Consul général de France.
- En 1881, il est Vice-consul à Manchester (Angleterre)
- Notons aussi que Léon-Guillaume Le Roux :
- s'est engagé volontaire au 4ème Régiment des chasseurs d'Afrique, pour la durée de la guerre 1870-1871, donc du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871.
- il a été membre du Conseil général du Finistère de 1871 à 1883.
- il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 01/08/1901
- Conférence hippique (source journal Ar bobl du 27 mai 1911) : M. Léon Le Roux, consul en retraite, demeurant à Vannes, a fait une intéressante conférence hippique à Landivisiau, à l'occasion du concours de postiers, sur la nécessité pour les éleveurs de remettre en vedette le cheval indigène. M. Le Roux se félicite que le Finistère ait montré l'exemple en décidant la création d'un livre d'origines. Cette conférence, présidée par M. Pouliquen, maire, a produit la meilleure impression.
- Article nécrologique paru dans L'Echo du Finistère du samedi 21 septembre 1912
Mort de M. Léon-Guillaume Le Roux. - Extrait de la Bretagne hippique et Agricole :C'est notre meilleur collaborateur qui s'en va. Nos lecteurs apprécieront, lorsqu'ils sauront que c'est Brelipic et Un Léonard que nous perdons à tout jamais. M. Le Roux a succombé à une maladie de foie qui emporte fatalement, car son grand âge seul (70 ans) n'avait en rien émoussé ses brillantes facultés.
D'une verdeur étonnante malgré ses ans, nous admirions en lui cette énergie qui lui faisait nous dire très sérieusement, tout dernièrement encore : « Vous savez, mes deux chevaux de p. s. que je monte tous les jours ? je vais changer l'un d'eux qui devient trop mou ; je n'ai plus aucun plaisir à le monter ».
Breton aussi actif que vigoureux et bon, M. L.-G. Le Roux avait au plus haut point le culte de sa Bretagne. Il consacra la plus grande partie de sa vie à faire du bien à ses compatriotes, en traitant de main de maître certaines questions économiques à longue échéance. Ne serait-ce que pour son insistance à préconiser la création de nos Stud-Books, il a droit à la reconnaissance éternelle des éleveurs bretons. Les progrès de l'élevage morbihannais, surtout, lui sont dus et bien des débouchés éloignés, ouverts ou qui s'ouvriront pour tous nos produits, sont ou seront le fait de ses démarches, auprès de personnalités étrangères haut placées, que ses anciennes fonctions de Consul Général lui permettaient de pressentir. Non content de payer de sa personne et de sa plume si fertile en enseignements de valeur, nous le vîmes souvent payer de sa bourse des publications destinées à augmenter et à porter plus loin la réputation de notre élevage. Il y a à peine 2 ans, il offrait d'accompagner, à ses frais, au Concours de Buenos-Ayres (République Argentine) les éleveurs bretons désireux d'y exposer des reproducteurs postiers. Sa vigueur, vieille pourtant de 74 ans, ne s'effrayait nullement des fatigues et des tracas d'un aussi long voyage. Il aurait été, là-bas, l'interprète de nos exposants et tout porte à croire que d'importantes ventes auraient découlé de son entremise désintéressée si dévouée. Malheureusement, nos éleveurs eurent le grand tort, à ce moment, de ne pas s'organiser pour effectuer ce déplacement, au bout duquel, certainement, se trouvaient, pour eux, les plus grands profils. L'idée de notre brochure illustrée qui paraîtra bientôt est partie de M. Le Roux et c'est encore à lui que nous devrons de pouvoir l'adresser partout où elle portera sûrement ses fruits.
Comme éleveur, aussi, notre regretté collaborateur et ami a fait également ses preuves : c'est lui, en effet, qui fit naître, éleva, fit courir avec grand succès et vendit aux Haras Nationaux le fameux étalon trotteur Corlay, d'impérissable mémoire. L'argent que ce seul étalon a fait gagner aux éleveurs de la Montagne bretonne, peut être évalué à une fortune.
Nous aurons beau faire à La Bretagne hippique et agricole, nous ne pourrons que continuer l'oeuvre qui nous a été si bien tracée par M. Léon Guillaume Le Roux, Consul Général en retraite, Ancien Conseiller Général, Chevalier de la Légion d'Honneur. En lui adressant ici un dernier adieu, remercions le vivement de tout ce qu'il a fait pour la grandeur de notre élevage et offrons à Madame Le Roux, à son fils et à toute la famille, le plus sincère hommage de nos respectueuses condoléances. En cette si cruelle circonstance puisse, enfin, la grande part de douleur et de vifs regrets que réclame pour elle La Bretagne hippique et agricole, diminuer d'autant celle immense qui leur reste. La Rédaction.
Albert Le Roux, fils de Guillaume et frère de Léon-Guillaume
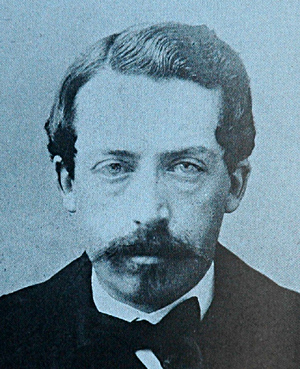 |
|
Parents
- Guillaume LE ROUX, né le 1er janvier 1794 à Landivisiau, décédé le 9 octobre 1868 au Château de Brezal, Plouneventer (à l'âge de 74 ans)
- Clara BAZIL (Marie Gabrielle Clara à l'état-civil), née le 3 octobre 1810 à Port-Launay, décédée le 25 septembre 1891 à Lourdes (à l'âge de 80 ans)
- Mariés le 2 février 1835 à St-Segal
Mariage et enfants
Marié le 18 juin 1866, Morlaix, avec Zoé PUYO, née le 26 décembre 1848, Rennes, décédée le 4 mars 1879, Rue de la Villeneuve, Morlaix, inhumée au cimetière St-Augustin de Morlaix (à 30 ans), dont :
- Marthe LE ROUX, née le 5 avril 1867, Morlaix, décédée le 8 janvier 1882, Rue de la Villeneuve, Morlaix, inhumée au cimetière St-Augustin de Morlaix (à 14 ans).
- Anne Zoé LE ROUX, née le 11 mai 1872, Morlaix, décédée le 19 mars 1887, de fièvre typhoïde, lors d'un voyage en Espagne, inhumée au cimetière St-Augustin de Morlaix (à 14 ans).
Par son mariage avec Zoé Puyo, fille d'Edouard et de Marie Caroline Zoé Homon, Albert Le Roux se trouve apparenté aux familles riches de Morlaix : les Puyo, Homon, Corbière, ... dont Charles Louis Homon, le grand-père de sa femme, qui fut l'un des fondateurs de la Société linière du Finistère en 1845.
Biographie
- 1866 : Négociant à Landerneau. Lors de son mariage, il est dit négociant et demeure à Landerneau. Peut-être prenait-il en main déjà la gestion de la Société linière dont son père était l'un des membres fondateurs. En tout cas, "dès 1868, il succède à son père dans la Société en s'impliquant davantage dans la gérance" (source Yves Blavier).
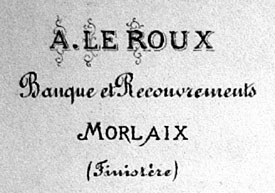 1867 : Banquier à Morlaix
1867 : Banquier à Morlaix - Lors de la naissance de sa première fille, en avril 1867, il est banquier et demeure rue de Villeneuve à Morlaix.
- 1878 : le 12/06/1878, une lettre d'Albert Le Roux, annonce l'entrée d'Edouard Rolland, son cousin, ancien notaire, dans la banque à titre d'intéressé, porteur de procuration générale,
et rappelle que Edouard Puyo, son beau-père, est porteur de procuration générale,
et Madec, son collaborateur depuis l'origine est porteur de procuration spéciale pour les endossements et acquits d'effets de commerce et les reçus des sommes versées à la caisse - 1882 : le 07/07/1882, une lettre d'Albert Le Roux, annonce la cession de sa banque à Messieurs Rolland et Cie, à dater de 14/7/1882.
Le décès de son épouse en 1879 et celui de sa fille aînée en ce début d'année auront-t-ils pesé dans son choix de limiter son activité et de se concentrer sur la gestion de la Société Linière et du domaine de Brezal ?
- 1882 : Brezal
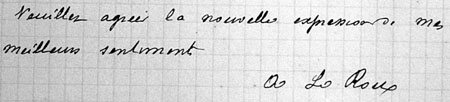 Albert Le Roux est recensé à Brezal en 1886 avec sa fille Anne née en 1872, Augustine Bussonnière, comme institutrice, et 3 domestiques
Albert Le Roux est recensé à Brezal en 1886 avec sa fille Anne née en 1872, Augustine Bussonnière, comme institutrice, et 3 domestiques- Il y poursuit son activité de gérant de la Société linière
- et de propriétaire terrien, s'occupant au début d'une partie des biens pour le compte de sa mère, veuve, à qui son mari a fait, par testament, "donation de la quotité la plus large que puisse permettre la loi". Cette gestion comprend notamment :
- la location des différentes fermes des environs de Brezal, du Frout et de Pont-Christ ...
- et d'autres situées beaucoup plus loin comme certaines dans l'archipel de Molène (Beniguet, Trielen, Balanec)
- la location des moulins : celui de Brezal et ceux du Frout
- la location de la station des haras de Pont-Christ à la commune de Plouneventer
- l'exploitation forestière des bois de Brezal, ... etc - Il est connu pour sa générosité envers les plus pauvres, sa dévotion et son attachement à la religon catholique. Les humbles qui le cotoyaient et qui bénéficiaient de ses attentions l'appelaient avec respect, "an aotrou Rouz". Voir le chapitre dédié à ses actions en ce sens.
- "La question des écoles chrétiennes, à tous les degrés, lui tenait à coeur. Nombre de jeunes gens lui sont redevables de leurs études secondaires, préparatoires au Grand Seminaire ; d'autres lui doivent leur entrée dans maintes carrières libérales : sa générosité était loin d'être exclusive, à condition de trouver des garanties du côté chrétien". (Le Courrier du Finistère du 21/09/1912)
- En 1888, il rejoint la Société Anonyme à Capital Variable pour l'Ecole Chrétienne de Landivisiau (Ecole Saint Joseph) et devient membre du Conseil d'administration. Cette société avait été créee, le 14/12/1882, par des notables landivisiens et des capitaux privés, pour permettre la fondation de l'école et son fonctionnement pour une durée de 15 ans.
Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 17 novembre 1889, il en sera le président. Il prend donc la succession de François Marie Queinnec, ancien notaire, décédé le 22/4/1888. Albert Le Roux restera président du Conseil d'Administration jusqu'à la dissolution de la société au terme prévu.
Non seulement, le châtelain de Brezal était le porteur du plus grand nombre d'actions parmi les actionnaires, mais de plus, pendant ces années, il fit des dons importants pour l'entretien de l'école et le salaire des enseignants (cf comptes-rendus des assemblées générales). - En 1891, il fait don de l'Ouvroir à la commune de Landivisiau
 .
Arrivées à Landivisiau en 1838, les Filles du Saint-Esprit ont tout d'abord tenu une salle d'asile (ancien nom de la maternelle), puis une école libre. Elles ont ensuite dirigé l'ouvroir qui accueillait de jeunes orphelines. En 1866, on y comptait 16 apprenties couturières (Ceci correspond bien à la définition première du mot "ouvroir" : Lieu où l'on se rassemble, dans une communauté de femmes ou dans un couvent, notamment pour effectuer des travaux d'aiguille). L'ouvroir était situé Rue des Capucins. Plus tard, l'établissement a ouvert ses portes à quelques dames pauvres et âgées, l'établissement devenant alors ouvroir-hospice. Fermé en 1959, l'hospice deviendra "pension de famille" et accueillera cinquante-cinq résidentes.
.
Arrivées à Landivisiau en 1838, les Filles du Saint-Esprit ont tout d'abord tenu une salle d'asile (ancien nom de la maternelle), puis une école libre. Elles ont ensuite dirigé l'ouvroir qui accueillait de jeunes orphelines. En 1866, on y comptait 16 apprenties couturières (Ceci correspond bien à la définition première du mot "ouvroir" : Lieu où l'on se rassemble, dans une communauté de femmes ou dans un couvent, notamment pour effectuer des travaux d'aiguille). L'ouvroir était situé Rue des Capucins. Plus tard, l'établissement a ouvert ses portes à quelques dames pauvres et âgées, l'établissement devenant alors ouvroir-hospice. Fermé en 1959, l'hospice deviendra "pension de famille" et accueillera cinquante-cinq résidentes.
En 1891, donc, l'ouvroir existait depuis longtemps déjà. On peut penser que les bâtiments appartenaient à la famille Le Roux et qu'Albert les céda, cette année-là, à la commune. Fermer X - En 1893, il est contacté par les autorités chrétiennes pour défendre la candidature d'Albert de Mun au siège de député de la 2è circonscription Morlaix. Celui-ci n'a aucune attache locale, mais il est un atout indéniable pour défendre la religion catholique à l'assemblée nationale. Albert Le Roux oeuvre donc dans ce sens pour faciliter l'intégration locale d'Albert de Mun, qui sera élu le 21 janvier 1894, face à Claude Caill de Plouzévédé.

Elu à Pontivy depuis 1876, bien que n'ayant pas d'attache en Bretagne, Albert de Mun est battu en 1893. "Ce défenseur de la religion va manquer cruellement à la tribune de la Chambre. Il faut au plus vite qu'il retrouve un siège. Il s'en présente un à pourvoir en Finistère l'année suivante, celui de Morlaix-Landivisiau. M. Le Roux n'a aucune ambition personnelle, aucune arrière-pensée terrestre, et sa fortune est déjà mise au service des bonnes oeuvres. Acceptera-t-il de servir de base arrière à ce grand dessein ?
Il accepte et l'affaire se met en marche. Albert Le Roux ne lésine pas sur les moyens. A l'époque il faut frapper les esprits en leur montrant la grâce qui leur est faite d'avoir à voter pour un grand homme qu'on leur envoie de Paris et qui ne parle même pas le breton. Quand la calèche, qui est allée le chercher à la gare de Landerneau, remonte les derniers 1.500 mètres formant l'avenue montant au château, des locataires de la famille Le Roux et des bénévoles se tiennent tous les trois mètres de chaque côté du chemin avec au bras un chandelier pour en assurer l'éclairage. De grands dîners sont donnés à Brezal, où l'hôte s'efface derrière son illustre visiteur, puisque tout ce qu'il a est mis à sa disposition. Toutes les notabilités du pays sont invitées à venir rencontrer le grand défenseur du catholicisme social. Et l'affaire tourne bien. Albert de Mun va être élu et réélu député du Finistère jusqu'à sa mort en 1914, deux ans après celui que dans sa correspondance il appelle "son cher et excellent ami". Il gardera ses aises à Brezal où il a sa chambre". Vincent Huon de Penanster.
Fermer X - Son caractère généreux et sa foi chrétienne l'amena à se préoccuper des églises proches de Brezal :
- Don pour l'église de Plouneventer : "En 1895, la seconde cloche fut refondue. C'est Albert Le Roux de Brézal qui en fit tous les frais".
- Don pour l'église de Landivisiau : en 1894, il offrit à cette église le gros bourdon
 , l'une des quatre cloches.
Hauteur 1 m. - diamètre 1,10 m. An de N.S. 1894. Eglise de Landivisiau. Saint Thivisiau, patron. Mgr Valleau, évêque. M. Cariou, curé doyen, chanoine homoraire. Albert Le Roux, parain et donateur. A. Queinnec, marraine. Emily, trésorier. "Voix du ciel, console la terre". Amédée Bollée fils, aîné, successeur. Fermer X
, l'une des quatre cloches.
Hauteur 1 m. - diamètre 1,10 m. An de N.S. 1894. Eglise de Landivisiau. Saint Thivisiau, patron. Mgr Valleau, évêque. M. Cariou, curé doyen, chanoine homoraire. Albert Le Roux, parain et donateur. A. Queinnec, marraine. Emily, trésorier. "Voix du ciel, console la terre". Amédée Bollée fils, aîné, successeur. Fermer X - Don pour le monastère de Kerbeneat : le jeudi 30 août 1900 a lieu la bénédiction d'une cloche à Kerbeneat. Le parrain et donateur est Albert Le Roux et la marraine, Mlle Félicie de Rodellec du Portzic.
- Lors de l'effondrement du toit de l'église de Pont-Christ, il mit en sécurité de beau Christ en robe, qui se trouvait dans le transept nord. Ce Christ est actuellement à Kergrist, dans les communs du château appartenant à la famille Huon de Penanster.
- En 1896, il fait ériger le calvaire qui se trouve près du moulin de Brezal
- Il fut président du comité paroissial de Plouneventer.
Portraits : le père et ses filles

Marthe Le Roux (8 ans) par Louis-Marie Baader en 1875.
Albert Le Roux et sa fille Anne."L'oncle Albert, mon parrain, avait épousé Zoé Puyo, et était devenu veuf assez jeune. Il avait deux filles : Marthe et Anne. Je vois d'ici leurs photos à Brezal sous un grand verre bombé, ovale. Il y avait trois médaillons, leur mère et elles deux. Chaque photo entourée de leurs cheveux formant le contour du médaillon. Marthe mourut assez jeune. Il restait Anne, fierté de son père. Elle était vive, intelligente, charmante me disait ma grand-mère. Hélas ! Elle mourut aussi à 15 ans, de fièvre typhoïde, au cours d'un voyage en Espagne." (notes rédigées par Marie, épouse de Pierre Brun du Bois Noir, une des filles de Charles Albert de Penanster, petite fille de Claire Le Roux)
La mort de sa fille Anne en 1887 a bouleversé évidement l'existence d'Albert Le Roux. Il n'a plus ni femme ni enfants. "Je viens d'embrasser un troisième front glacé", explique-t-il. Il envoie un télégramme à son frère lui disant : "Anne morte. Tu seras mon héritier". ... ... Albert met en oeuvre le programme que lui a confié sa fille mourante : tu donneras mon bien aux pauvres. Ce méticuleux organise des distributions. (source vhdp)
- Un grand chrétien (source La Semaine Religieuse de Quimper et de Léon du vendredi 20 septembre 1912)
Samedi dernier, 14 courant, avait lieu dans la chapelle de Brézal en Plouneventer, une première cérémonie funèbre pour M. A. Le Roux, pieusement décédé, le mercredi précédent, vers 9 heures du soir. Sa Grandeur Mgr l'Evêque de Quimper, entouré de MM. les chanoines Peyron, Queinnec, Treussier, curé-archiprêtre de Saint-Pol de Léon, Kerbiriou, curé de Saint-Sauveur de Brest, des Curés de Landivisiau, Ploudiry et d'une cinquantaine de Prêtres, présidait l'office.
M. le comte A. de Mun, l'éminent académicien et ami de M. Le Roux ; les maires de Landivisiau, Plounéventer et un grand nombre d'autres notabilités catholiques du pays avaient tenu à venir donner au vénéré défunt un témoignage de leur profonde sympathie.
Parmi la foule qui remplissait l'immense parc de Brézal, on remarquait surtout les obligés habituels de M. Le Roux, les pauvres des communes voisines.Après la messe célébrée par M. l'abbé Simon, recteur de Plounéventer, et avant de donner lui-même l'absoute, Monseigneur s'adressant aux membres de la famille et aux quelques privilégés qui avaient trouvé place dans l'étroite chapelle, dit, avec son coeur et l'éloquence qu'on lui connaît, la perte immense que causait au diocèse la mort de M. Le Roux :
" Mes Frères,
Je suis venu prier avec vous, et ma prière se fera au nom de tout le diocèse, car je peux le dire pour rendre hommage à la vérité, tout le diocèse doit de la reconnaissance à M. Albert Le Roux. Il ne me pardonnerait pas de lui décerner des éloges qu'il a d'avance répudiés. Il ne m'en voudra pas de vous dire, une fois de plus, que le chrétien mourant n'attend jamais de nous d'autre preuve d'affection ni d'autre secours utile que la prière, et que d'ailleurs notre coeur lui-même chercherait en vain quelque autre consolation à sa propre tristesse.S'il a demandé que la suprême bénédiction de l'Eglise lui fut accordée dans cette chapelle de Brezal où il s'est si longtemps et si souvent entretenu avec son Dieu, c'est qu'il était sûr que, dans ce sanctuaire intime, notre âme suivrait plus facilement le mouvement de la sienne et mettrait plus de ferveur dans son appel suppliant vers le Ciel pour l'ami disparu.
Au mois de novembre 1910, il suivait, à Quimper, les exercices d'une retraite d'Oeuvres. Je m'en effrayais pour sa santé. J'allai le voir. Je lui exprimai mes craintes. Il me répondit bien simplement : " Sacrificium vespertinum. C'est l'heure du sacrifice prochain, qui achèvera la vie." Le mot était emprunté à ce De senectute chrétien de Mgr Baunard, où la Vieillesse est présentée comme la dernière étape d'une ascension qui mène à Jésus-Christ, à travers les détachements qui brisent le coeur et grandissent l'âme.
Je n'ai pas été témoin de la vie de M. Le Roux. La providence ne l'a mis sur ma route qu'à sa dernière étape. Je n'ai pas vu tomber successivement autour de lui la femme chrétienne que Dieu lui fera retrouver, fidèle, dans son éternité, et la fille qui lui fut enlevée dans son printemps pour atteindre au ciel une maturité plus haute et plus prompte. Mais on m'a raconté comment son coeur plein de larmes et plein d'espoir, développant alors, presque sans limite, la famille adoptive qu'il s'était déjà créée, commença, avec une charité méthodique et cordiale, qui se faisait princière aux jours des nécessités graves, à rechercher le moyen d'aider plus sûrement par ses aumônes, et les pauvres qui en étaient dignes, et les oeuvres qui en avaient besoin, et les familles et les enfants, les écoles, les églises, les monastères, les séminaires, si bien que, si l'on convoquait aujourd'hui à ses obsèques, la foule innombrable des travailleurs, des prêtres, des écoliers, des défenseurs de l'Eglise, des hommes d'oeuvre qu'il a obligés, sans oublier les religieux et religieuses que le cloître sépare du monde, on ne trouverait dans ce diocèse aucune cathédrale qui fût capable de contenir cette multitude, quand elle viendrait rappeler à Dieu autour de ce cercueil, que la charité enrichit celui qui la fait et se change pour lui en prière aussi puissante après la mort que pendant la vie, car elle est un sacrifice utile à la terre et glorieux pour le ciel. Sacrificium vespertinum.
Partout et toujours, la source du sacrifice, c'est la foi. Je n'ai trouvé dans aucune âme une foi supérieure à celle qui animait ce chrétien. Dans sa conversation comme dans ses lettres, la pensée maîtresse est celle de Dieu. Pas de calcul de parti. Dans sa vie publique, dans sa vie privée, dans les services rendus, dans les conseils donnés, dans les lectures faites, dans les réflexions communiquées, l'intention était toujours surnaturelle, et je n'ai jamais senti qu'entre la pensée du Pape ou de son Evêque et sa pensée personnelle il y ait eu, à aucun moment, l'ombre d'une contradiction. Il croyait, commme l'Eglise veut que l'on croie. Il aimait, il priait, il communiait, il agissait en tout, dans le même esprit. Le prêtre qui a connu son âme ne me démentirait pas. A mesure que s'accentuait la vieillesse physique, l'approche de Dieu éclairait ce visage grave, et la mort voisine lui faisait trouver dans l'Eucharistie une attraction de plus et comme un prélude de la vie supérieure où l'entraînaient ses dernières souffrances.
Un moment, nous avions espéré que Dieu prolongerait ici-bas son labeur charitable. Humblement sollicié, le pape priait pour le vénéré malade, et quelque espoir entrait dans nos coeurs. Hélas ! les grâces de santé ne vinrent pas. La Providence permit à la mort de faire son oeuvre. Elle ne lui permit pas d'ôter la véritable vie, celle de l'âme. Vita mutatur, non tollitur. De cette vie nouvelle nous sommes certains. De l'état réel où elle met chacun de nous, nous ne savons rien de définitif. Nous ne craignons ici l'Enfer. Mais nous pouvons, même pour les meilleurs et les plus saints, redouter le Purgatoire comme espérer le Paradis, car la vie humaine se déroule dans l'imperfection, et il faut prier pour les âmes qui peuvent avoir à expier encore quelque faiblesse et à mieux apprendre, dans les souffrances de l'autre vie, l'art d'aimer Dieu pleinement dans la contrition parfaite de leurs fautes.
C'est pourquoi nous venons associer nos prières à celles d'une famille en deuil, et solliciter, ou de votre amitié, ou de votre reconnaissance, un long et affectueux souvenir pour notre pieux défunt. Il n'oubliera pas, dans l'état de gloire où votre charité aura contribué à l'introduire plus vite, ceux qu'il a connus et aimés ici-bas et qui peuvent avoir encore besoin de son aide.
Cette parole si autorisée suffit assurément à faire bénir la mémoire de ce grand chrétien. Qu'il soit pourtant permis au témoin habituel d'une vie si édifiante, à celui que pendant des années le cher disparu daigna consulter pour se conformer davantage à la volonté divine en soumettant tous ses actes à l'obéissance, de rappeler ici quelques-unes de ses oeuvres et la source où il puisait l'esprit surnaturel dont il les animait toutes sans exception.
* * *
Né à Landivisiau, où il passa les premières années de sa vie, M. A. Le Roux s'établit de bonne heure à Morlaix, où il laissa dans les hautes situations qu'il occupa la réputation d'un homme intègre et de bons conseils.
A la suite de cruelles épreuves de famille, il quitta Morlaix pour venir résider dans sa paisible propriété de Brézal. C'est là, que pendant une trentaine d'années, il consacrera son activité, ses talents, sa fortune à faire autour de lui le plus de bien possible.
Le propriétaire de Brézal était, de l'avis de tous, la Providence du pays. Dieu seul sait les misères qu'il a soulagées, les infortunes qu'il a relevées, les larmes qu'il a essuyées ! Sa maison était ouverte à tous les malheureux auxquels il donnait sans compter. Il avait pour les gens de son entourage, fermiers ou serviteurs, des attentions vraiment paternelles. "Dieu vous garde !" c'était son salut ordinaire aux personnes de sa maison qu'il rencontrait. Il s'informait de leur santé, et leur procurait, dans la plus large mesure possible, le repos et les soins que réclamait leur état. Si la famille augmentait, une généreuse gratification était faite, et cette gratification au père et à la mère augmentait au fur et à mesure qu'arrivaient de nouveau-nés.
En dehors des aumônes journalières, il y avait, chaque année, vers la mi-septembre, la grande semaine des pauvres. Ces pauvres - au nombre de 500 environ - désignés à l'avance par les pasteurs des paroisses, venaient à Brézal, où il recevaient de M. Le Roux lui-même : la somme de 10 fr., deux pièces d'étoffe au choix pour habit, un objet de piété et quelques bons conseils. Après la distribution, chacun des pauvres s'asseyait à la table du maître pour prendre son repas et s'en retournait heureux.
Mais si M. Le Roux pourvoyait largement aux besoins des corps, les Oeuvres qui atteignaient les âmes et procuraient la gloire de Dieu avaient pourtant ses préférences. C'est ainsi que, depuis de longues années, il avait à sa charge, complètement ou dans une mesure très large, de 20 à 25 grands ou petits séminaristes, il favorisait également et aidait de sa bourse les jeunes gens ou jeunes filles qui se destinaient à la vie religieuse ou à l'enseignement libre. Innombrables sont les Ecoles chrétiennes, les patronages, les Crèches qu'il soutenait de ses largesses.
Parmi ses oeuvres de prédilection, je citerai encore : l'Oeuvre des premières communions, l'Oeuvre des retraites, de la Propagation de la Foi, de la Bonne Presse, de la préservation des orphelins et des orphelines, de Dom Bosco et du Sacré-Coeur, etc. Mais à quelle source de grand chrétien allait-il puiser cette générosité dans les Oeuvres et surtout l'esprit surnaturel qu'il y mettait ? Je le rappellerai en quelques lots. M. Le Roux était un homme de prière et de pénitence.
Levé en été comme en hiver à 4 h. 1/2 du matin, il commençait sa journée par l'exercice du Chemin de la Croix érigé dans sa chambre à coucher. Il se rendait ensuite dans sa chapelle domestique où il avait le privilège de posséder la Sainte Réserve
 .
Là, il prolongeait ses prières et oraisons jusqu'à 6 h 1/2 ou 7 heures. Il entendait la messe sur semaine tous les vendredis, parfois le mercredi, et y faisait la sainte communion. Une de ses grandes privations était de ne pouvoir assister, chaque jour, à la messe et d'y faire la communion. Dès les premiers siècles, le pain consacré lors de la célébration eucharistique fut conservé pour que les mourants et les malades puissent communier, sans oublier d'autres fidèles qui n'avaient pu communier pendant la messe. L'Eucharistie était gardée dignement dans la Sainte Réserve (un placard au début) en dehors de la messe. Le pain consacré pouvait aussi être emporté sur soi pour implorer la protection divine pendant un voyage. L'Eucharistie partagée était enfin le signe de l'unité entre évêques : après avoir communié, un évêque envoyait l'autre partie du pain consacré à un autre évêque. Lorsque ce dernier communiait, il exprimait sa communion avec le premier évêque. Fermer X
.
Là, il prolongeait ses prières et oraisons jusqu'à 6 h 1/2 ou 7 heures. Il entendait la messe sur semaine tous les vendredis, parfois le mercredi, et y faisait la sainte communion. Une de ses grandes privations était de ne pouvoir assister, chaque jour, à la messe et d'y faire la communion. Dès les premiers siècles, le pain consacré lors de la célébration eucharistique fut conservé pour que les mourants et les malades puissent communier, sans oublier d'autres fidèles qui n'avaient pu communier pendant la messe. L'Eucharistie était gardée dignement dans la Sainte Réserve (un placard au début) en dehors de la messe. Le pain consacré pouvait aussi être emporté sur soi pour implorer la protection divine pendant un voyage. L'Eucharistie partagée était enfin le signe de l'unité entre évêques : après avoir communié, un évêque envoyait l'autre partie du pain consacré à un autre évêque. Lorsque ce dernier communiait, il exprimait sa communion avec le premier évêque. Fermer XInutile d'ajouter que dans le courant de la journée, et surtout le soir, M. Le Roux, malgré le travail que lui donnait sa volumineuse correspondance, trouvait encore le temps de prier et de faire des lectures pieuses. L'année liturgique de Dom Guéranger était son livre favori. C'est dire combien il aimait les cérémonies de l'Eglise et combien il était attentif aux directions du Pape, des Evêques. Il avait un véritable culte pour la hiérarchie et voyait Dieu dans le Pape, les Evêques, le prêtre. Aussi il fallait voir avec quelle ardeur il défendait l'Eglise et repoussait les utopies du Modernisme.
M. Le Roux n'était pas seulement un homme de prière, c'était un homme de pénitence. Sa mortification était extrême. Il se contentait de deux modestes repas par jour dont le menu, toujours le même, étonnait tout le monde. Sa vie était celle d'un anachorète : jamais rien pour la sensualité, jamais le moinde soulagement entre les repas, jamais le moinde dessert. Oblat bénédictin il semblait avoir pris à coeur de suivre le régime sévère des moines dont il aimait le voisinage. Aussi souffrit-il beaucoup de leur éloignement. Il disait souvent que, depuis leur départ pour l'exil, il se sentait lui-même exilé et que ce foyer de prières, qu'était le monastère, lui manquait.
Cependant l'heure de la récompense et du repos approchait. La santé de M. Le Roux déclinait sensiblement depuis plusieurs mois. Lui-même ne se faisait aucune illusion et parlait volontiers de sa fin prochaine à laquelle il se préparait par encore plus d'esprit de prière et d'union à Dieu. Ses conversations, depuis quelques semaines surtout, étaient toutes spirituelles. Aux personnes qui lui demandaient de ses nouvelles, il se contentait de répondre : "Priez pour moi, j'ai un extrême besoin de prière".
Enfin l'heure de la délivrance arriva. Le 11 septembre, vers 9 heures du soir, M. A. Le Roux entrait dans son éternité, après avoir reçu la bénédiction du Pape, de son Evêque et tous ses sacrements. Son corps revêtu, selon sa volonté expresse, de l'habit d'oblat bénédictin, repose, en attendant la résurrection, dans le caveau de famille, au cimetière Saint-Martin de Morlaix. Requiescat in pace ! F.L.
N.B. - Un service solennel sera célèbré le mardi 24 septembre, à 10 heures, en l'église paroissiale de Plounéventer, pour le repos de l'âme de M. Albert Le Roux, décédé mercredi, 18 septembre, en sa propriété de Brézal.
NdAC : L'évêque était en 1912, Mgr Duparc : Adolphe Yves-Marie Duparc, né à Lorient le 5 février 1857 et mort à Quimper le 8 mai 1946, fut évêque de Quimper et Léon de 1908 à sa mort.
- Plouneventer-Brezal - Obsèques de M. Albert Le Roux. (Le Courrier du Finistère du 21/09/1912)
Il s'est éteint à 74 ans, pleuré de tout un pays. Aussi ses obsèques furent-elles imposantes. L'Evêque du diocèse, Mgr Duparc, presidait, assiste de MM. les chanoines Peyron et Queinnec. Parmi le clergé, on a reconnu M. Treussier, curé archiprêtre de Saint-Pol de Leon ; Kerbiriou, curé de Saint-Sauveur (Brest) ; Corre, curé de Ploudiry ; Berthou, curé de Landivisiau ; Moënner, principal du collège de Lesneven ; Ollivier, surveillant général de l'école N.-D. de Bon-Secours de Brest ; Mazé, directeur de l'école libre de Landivisiau ; Riou et Pouliquen, professeurs au collège de Saint-Pol, etc.
Le deuil était conduit par M. de Penanster, neveu du défunt, dont le frère Léon n'avait pu arriver à cause de la gravité de son état. Venaient ensuite M. le comte A. de Mun, deputé ; M. le maire de Plouneventer, les maires des communes avoisinantes, entre autres M. Boucher, de Lampaul-Guimiliau et M. Pouliquen, de Landivisiau. Puis un long defilé de peuple de toute condition et de tout âge, accouru pour rendre un dernier hommage au bienfaiteur de toute la région.
Au chant du Miserere, le cortège gravit lentement la colline qui sépare le château de Brezal de la chapelle assise sur un rocher, en plein bois. De cette terrasse, la vue découvre un panorama magnifique. Les habitants des environs se rangent à leurs places habituelles, d'où si souvent, dans le sanctuaire ou alentours, ils ont entendu la Sainte Messe, rempli les obligations de la Portioncule, ou assisté à ces réunions du mois de Marie, que Mlle A. Bussonnière avait réussi à rendre si pieuses et si fréquentées.
A l'isssue de la cérémonie, Monseigneur résume en quelques mots la vie de M. Le Roux.
"Un chrétien avant tout, voilà ce qu'il fut." Oui ; dans l'intimité d'abord ; et, ici, que de choses à dire à la grande édification de tous... Dans la vie publique ensuite, et sur ce point, l'auteur de ces lignes ne se croit pas tenu à la même réserve. Dans les problèmes de libre discussion, M. Le Roux était d'idées très larges ; et à diverses reprises, il s'est refusé avec énergie à blâmer des actes reputés par d'autres répréhensibles. Mais dès que la question religieuse était en jeu, il appliquait immédiatement la formule sentiendum cum Ecclesia. Et le sentiment de l'Eglise, il allait le demander à son Recteur, à son Evêque, au Pape. Jamais là-dessus, il ne connut d'hésitation, ni de difficulté. Un jour, un homme politique vint me demander quelle conduite tiendrait M. Le Roux dans une élection importante.
- Personnellement, répondis-je. Je n'en sais rien. Mais voici ce qu'il fera : il ira consulter ses prêtres, et il se conformera à leur déclaration. C'est ce qui eut lieu ; et il fut des premiers et des plus actifs à travailler pro Ecclesia et Pontifice. Au moment de l'election de M. de Mun, en janvier 1891, alors que d'autres catholiques hésitaient encore sur le parti et le candidat à prendre, lui s'en allait, quoique souffrant, présenter M. de Mun aux réunions électorales de Plouneventer et de Landivisiau.La question des écoles chrétiennes, à tous les degrés, lui tenait à coeur. Nombre de jeunes gens lui sont redevables de leurs études secondaires, préparatoires au Grand Seminaire ; d'autres lui doivent leur entrée dans maintes carrières libérales : sa générosité était loin d'être exclusive, à condition de trouver des garanties du côté chrétien.
Il croyait à l'adaptation possible de nos écoles secondaires privées aux nouveaux programmes d'études. Ce fut une joie pour lui de voir qu'on savait les y utiliser. Et, à chaque examen du baccalauréat, il se faisait un nouveau plaisir de marquer les succès obtenus dans les diverses sections.
Ses derniers jours ont été attristés, peut-être abrégés, par la persécution dirigée contre nos religieuses. Un prétendu délit de ces dernières l'appela, il y a deux mois, au tribunal de Morlaix. Il y prit la parole pour justifier son attitude et la leur. Le président, voyant, son état, redoubla pour lui d'égards. Mais ce surcroit de fatigues eut raison de ses dernières forces : l'issue fatale désormais ne pouvait tarder.
L'inhumation a été faite à Morlaix dans un caveau de famille. Quand le char funèbre traversait Landivisiau, les cloches tintaient le glas : c'était de leur part le salut au cercueil de l'ami fidèle, du bienfaiteur insigne qui avait offert à cette église le gros bourdon. Des deux côtés de la rue s'étalent groupés les habitants, ouvriers en majorité, venus là, avant de reprendre leur travail, dire un De profundis à l'intention de celui qu'ils avaient tous connu et estimé. Un jour, en montant cette même rue, M. Le Roux entendit à son adresse une parole de haine : ce fut pour lui un grand chagrin. Aujourd'hui rien de semblable à craindre : il n'y avait là, cette fois, que des Landivisiens.
Le service religieux à Saint-Martin de Morlaix fut présidé par M. l'abbé Le Bihan, recteur. Au choeur avaient pris place M. Kerlait, cure-archiprêtre ; M. Martin, curé des Carmes ; M. Castel, recteur de Saint-Melaine ; M. Danielou, recteur de N.-D. de Kerbonne ; MM. les aumoniers et les vicaires de la ville ; M. Abgrall, professeur à Bon-Secours ; ainsi que plusieurs autres prêtres. M. l'abbé Simon, recteur de Plouneventer, paroisse du défunt, a donné l'absoute et conduit à sa dernière demeure le bon chrétien que fut M. Albert Le Roux.
A. Cloarec - Quelques notes sur Albert Le Roux dans PAX Chronique de l'abbaye de Kerbeneat

Blason de Kerbeneat
Ta louange jusqu'aux
confins de la terre- En 1954 - n° 17
C'est ... la vie simple des moines de Kerbeneat, qui, dans l'esprit de la Règle de Saint-Benoît, demandent leur subsistance au travail de leurs mains 1. Les activités monastiques sont réglées par la belle cloche 2 de deux cents kilogrammes, bénite le 30 août 1900 en présence du curé de Landivisiau, du recteur et du vicaire de Plounéventer. Elle avait été donnée par M. Le Roux de Brézal, qui n'en était pas à son premier geste de générosité ; il fut avec la famille Rodellec, le bienfaiteur insigne du monastère dont un obituaire le qualifie de "munificentissimus".
M. Le Roux mourut en 1912. Ses obsèques à la chapelle de Brezal furent l'occasion d'un concours de peuple considérable. L'office fut présidé par l'évêque de Quimper ; le comte de Mun, les maires de Landivisiau et de Plounéventer étaient présents. Juste hommage rendu à un homme de bien dont la générosité était proverbiale. Tous les ans, à la mi-septembre, il organisait une sorte de semaine des pauvres : cinq cents (sic !) indigents désignés par les pasteurs des paroisses voisines recevaient une somme de dix francs, deux pièces d'étoffe, un objet de piété, sans compter le repas en commun. Il entretenait plus de vingt séminaristes. Oblat 3 du monastère de Kerbeneat, il menait, sur ses dernières années, une vie toute de prières ; son salut habituel était "Dieu vous garde !" Levé à quatre heures trente tous les matins, il faisait son chemin de croix, passait une heure en oraison à la chapelle. Il fut enseveli avec l'habit d'oblat bénédictin.
1 Non seulement ils cultivaient leur terre, mais en outre, ils avaient créé une fromagerie.
2 Les parrain et marraine était Albert Le Roux et Félicie Rodellec du Portzic. En 1958, la cloche de Kerbeneat a rejoint les deux autres cloches de Landevennec (Pax n°36).
3 Oblat : personne qui s'est agrégée à une communauté religieuse, mais sans prononcer les voeux. - En 1954 - n° 20
Quand les moines furent expulsés de leur monastère en 1903 sur décision des instances gouvernementales, "ils reçurent l'hospitalité chez M. Le Roux à Brezal, où ils demeurèrent tous plusieurs semaines".
Sur ce site, un chapitre est consacré au monastère de Kerbénéat.
- En 1954 - n° 17
Marguerite Ricbourg, "Mme André", médium en 1960
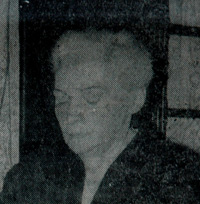 |
|
De 1950 à 1962 au moins, vivait à Pont-Christ un couple de retraités, connus sous le nom de "M. et Mme André". Ils habitaient la maison qui se trouve devant le porche de l'église de Pont-Christ et se nommaient en fait André Gambon et Marguerite Ricbourg.
André s'était fait jardinier et cultivait intégralement le terrain qui se trouvait devant sa maison. Beau travail, superbe potager : on peut le voir sur une carte postale d'époque, entre sa maison au ras du clocher et la ferme au premier plan. Il avait aussi installé, à l'angle nord-ouest du jardin, vers l'Elorn, une volière où l'on pouvait voir des tourterelles, des faisans, mâle et femelle, des poules, ... etc... La volière n'existe pas encore sur la carte postale.
Quant à Marguerite, sa spécificité la plus surprenante nous allons la dévoiler ici : elle était médium. Voici un article paru dans le Télégramme du 30/11/1960, qui commençait la série d'une dizaine d'articles intitulés "licenciés es sciences occultes ou es-fumisterie ?"
Mme André (Pont-Christ) : "Une mère m'a proposé une fortune pour faire disparaître la fiancée de son fils".
"Non, je ne suis pas une 'surfemme'. Pas davantage une sorcière. Je suis même surprise que tant d'hommes aussi instruits, aussi intelligents, viennent me consulter, moi qui n'ai que mon certificat d'études. Mais je me dis que s'ils viennent c'est qu' "on" leur a parlé de moi en bons termes. Alors je suis heureuse."
Mme André a 60 ans. Elle est originaire de la Haute-Vienne. Elle vit dans le cadre ravissant de Pont-Christ, entre Landerneau et Landivisiau depuis 10 ans. Pourquoi a-t-elle choisi la Bretagne ? Parce que la Faculté le lui a ordonné. Au pied d'une rivière tranquille, elle mène une vie saine, la vie des paysans locaux, à l'ombre des ruines de cette chapelle dont on a dit qu'elle avait inspiré un des plus grands succès de Jean Lumière, d'abord, de Tino Rossi ensuite :
"Je sais une église au fond d'un hameau
Dont le fin clocher se mire dans l'eau
Dans l'eau pure d'une rivière..."
Rien ne liait davantage à la Bretagne son mari, un homme robuste, dont le regard et les rares paroles paraissent traduire une grande bonté. Il a suivi sa femme, tout simplement. Lui est d'origine ardennaise et a passé le plus clair de sa vie à Montmartre. Ses intonations, parfois, sont celles que l'on entend lorsqu'on gravit la rue Lepic ou la rue Caulincourt, qui donnent accès à la fameuse "butte". Mais il s'est efforcé de s'intégrer à la vie locale.
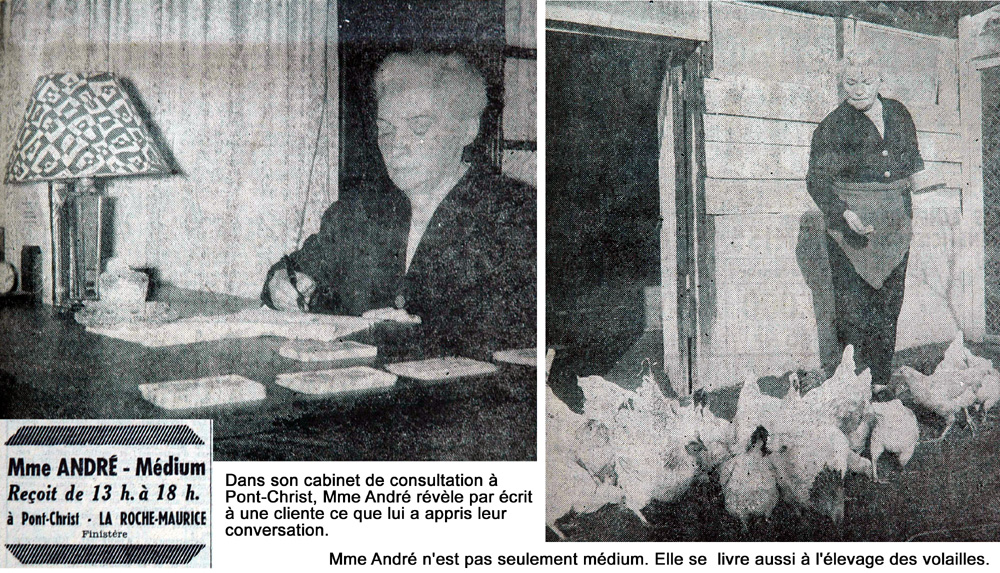
"Comme les fruits et les légumes"
Mme André et son mari sont donc dans la région depuis 1950. Ils pensaient, à leur arrivée, vivre paisiblement le reste de leur âge dans leur charmante maisonnette rustique, où tout respire la quiétude, la sérénité, le délassement. Et puis ils connurent des revers, ce qui arrive à tout le monde. Il fallut travailler. Lui bricola, s'occupa d'élevage. Elle se décida à exploiter ce qu'elle appelle un don.
"Certes, depuis mon installation en Bretagne, dit Mme André, je donnais des consultations, mais uniquement à des amis, comme cela, pour le plaisir. Je ne le fais d'une manière officielle que depuis deux ans.
- Comment ce "don" vous a-t-il été révélé ?
- J'ai toujours été persuadée de posséder un pouvoir particulier. Tenez, depuis mon enfance - il me serait possible de vous le confirmer - j'ai été avertie des morts survenant soit dans ma famille, soit chez des amis. Comment me direz-vous ? Je n'en sais rien. Ce doit être un phénomène nerveux inexplicable. Ce qui est sûr c'est que, lorsqu'un décès se produit chez mes proches, j'éprouve un raidissement de tout le corps, tandis que mon visage devient extrêmement pâle. Dans mon entourage on s'interroge. On croit que je suis souffrante. Mais moi je sais qu'une nouvelle tragique ne tardera pas à me parvenir.
- Est-ce cette seule particularité qui vous a conduite aux sciences occultes ?
- Non, il y a lieu d'y ajouter le somnambulisme et l'astrologie. Les astres ont une grande importance. Nous sommes régis par eux comme le sont, par exemple, les fruits et les légumes. En outre, ils permettent de prévoir les périodes de malchance ou, au contraire, de totale réussite. Il y a, vous le savez, des jours où tout va bien et d'autres où tout va de travers. Il faut y voir l'influence astrale et elle seule".
La Bretonne est autoritaire
Je comprenais mieux à présent pourquoi les ruraux de la région disaient de Mme André qu'elle n'était pas des leurs. Elle s'exprimait différemment, avec plus de recherche, plus de lenteur. En outre, elle portait, aussi bien pour ses consultations que pour ses travaux domestiques, le pantalon, ce qui est peu courant chez les fermières du département. De plus, elle se fardait, discrètement certes, mais incontestablement, ce qui est tout aussi inhabituel chez les paysannes, à l'heure où elles vaquent aux travaux des champs. Mais, même à supposer qu'il y eut à mon égard une légère prévention, due soit à ses origines, soit à sa profession, Mme André n'en déclarait pas moins avec force et toutes les apparences de la sincérité : "Je suis une Bretonne de coeur !"
Elle vouait, me disait-elle, une réelle estime à ses compatriotes de rencontre, mais avait remarqué que la Bretonne était autoritaire, très autoritaire et qu'elle était, tout comme son mari, disons économe de ses deniers. Ce souci de l'épargne conduisait ses clients bretons - enfin certains d'entre eux - à discuter le prix de la consultation, à "chipoter".
Selon les périodes
Je voulus savoir s'il existait, en quelque sorte, une saison pour les consultations ou, au contraire, si elles constituaient un courant permanent.
"Non, fit le médium. Il existe, si vous voulez, une mode. Elle dure plus ou moins longtemps, disparaît, puis revient au premier plan.
- A quoi est-ce dû ?
- Je serais tentée de vous répondre que tout dépend des événements. Pour ce qui me concerne, j'ai une abondante clientèle de commerçants et d'industriels, tous plus ou moins préoccupés par le climat de crise dans le quel nous baignons actuellement. C'est un fait que les affaires sont difficiles. Alors ils viennent me voir, me demander conseil. Ils sont parfois désemparés.
Le démon de 5 à 7
- Vous arrive-t-il de distribuer des recommandations d'ordre sentimental ?
- Je reçois, je dois dire, très peu de jeunes filles. Lorsqu'elles viennent, elles sont épouvantées.
- Pourquoi ?
- Je l'ignore. Mais je répète qu'elles ont peur. Par contre, j'ai fréquemment la visite de "femmes honnêtes mais désoeuvrées". Elles s'ennuient. Un garçon séduisant leur a fait la cour. Elles sont tentées par le démon de midi. Elles hésitent. Moi je leur fais toujours la même réponse : "Le feu, un jour, brûlera vos ailes et vous retomberez moins propre qu'avant. Je m'efforce toujours de conseiller dans le sens de la morale. C'est ainsi que je puis vous affirmer que j'ai réussi à éviter plusieurs divorces qui paraissaient cependant irrémédiables.
- Le pourcentage de femmes dans votre clientèle ?
- 65 à 70 %. Je répète que beaucoup d'entre elles s'ennuient et bâtissent des romans."
Voyance et arithmétique
Mme André, d'autre part, m'explique qu'un certain nombre de jeunes gens venaient la consulter à la demande de leur mère. Ils avaient échoué à leur examen ou, nantis de diplômes, ils hésitaient sur le choix d'une carrière. Alors on venait demander au médium ce qu'il en pensait. C'étaient là des questions d'un type courant, banal. D'autres interventions se révèlaient beaucoup plus insolites. Témoin, celle d'une mère de famille, entre deux âges, qui suppliait : "Mon fils, le plus beau garçon de la terre, le plus intelligent aussi, s'est amouraché d'une fille de peu. Le mariage doit avoir lieu prochainement. Je suis décidée à l'empêcher coûte que coûte et disposée à vous offrir une fortune si vous faites disparaître cette fille. Vous qui êtes médium, ce doit être possible. Dites votre prix. Il sera le mien." Je tiens ici à rassurer les coeurs sensibles et mêmes les autres. Le jeune fille ne fut pas soustraite à la tendresse de son fiancé. Si l'on me passe l'image, la soustraction, un instant envisagée par la mère, se transforma en définitive en addition. Dans quelques mois ils seront trois. Voire quatre, s'ils se présentent des jumeaux.
Textes et photos de Jacques ELIES.
Les immigrés au cours des siècles

On parle beaucoup des migrants aujourd'hui en septembre 2015. L'histoire de Pont-Christ nous a-t-elle laissé des souvenirs de l'immigration passée ? C'est ce que nous allons explorer. ATTENTION : Ceci est une RECHERCHE HISTORIQUE, l'illustration choisie de Saint Houardon franchissant la Manche, sur son auge de pierre, le montre bien. Il n'est donc pas question, ici, de faire quelques commentaires que ce soit sur la situation internationale actuelle, ni même d'en suggérer : ce serait déplacé dans le cadre de cette histoire de Pont-Christ.
Passons rapidement sur les migrations des "Bretons" christianisés d'Outre-Manche, tel Saint Houardon, qui vinrent s'installer en Armorique du IVè au VIIè siècle (plusieurs sont certainement arrivés jusqu'à Pont-Christ) pour nous arrêter sur des événements plus précis, et si possible nominatifs, qui sont survenus plus tard, et même jusqu'au 20è siècle. J'ai, d'ailleurs, gardé le souvenir d'immigrés fort sympathiques installés à Pont-Christ dans les années 1950.
1 - Patrice MORPHY, Irlandais, au 17è siècle
2 - Les papetiers Normands, à partir du 17è jusqu'au 19è siècle
3 - Quelques personnes au 18è siècle : Parisien, Lamballais, Trégorrois, Indien de Pondichéry
4 - Des Espagnols en 1939
5 - Ramón GERONES, Espagnol
6 - Bir RABIAH, Algérien
1 - Patrice MORPHY
De nombreux Irlandais ont fui leur pays au cours du 17è siècle. Pour quelle raison ? "Henri VIII, roi d'Angleterre protestant, se fait proclamer roi d'Irlande en 1541 et commence ainsi "l'anglicisation" du pays. Celle-ci se traduit par l'implantation dans toute l'Irlande de colons anglais et écossais et par la confiscation des terres de ceux qui refusent la soumission à la couronne britannique et à la religion protestante.
La rébellion des Irlandais s'organise. Mais, après plusieurs années de guerre, les Irlandais doivent capituler. Le traité de Limerick, signé en 1691 et censé garantir, entre autres, les libertés religieuses, est rapidement violé par les anglais qui continuent de confisquer de nouvelles terres aux catholiques pour y implanter des colons protestants. À partir de 1695, le parlement britannique vote toute une série de lois réduisant au minimum leurs droits. Ils sont ainsi exclus de la vie politique, de l'armée, de la magistrature, de l'enseignement et ils n'ont plus le droit de pratiquer leur religion, ni de parler leur langue ou bien de jouer leur musique" (cf l'étude de Patricia Dagier sur l'émigration des Irlandais en Bretagne au 17è siècle.
Ces événements successifs sont à l'origine de cet exode, et si de mombreux Irlandais se sont expatriés c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont rejoint la Bretagne, terre d'asile la plus proche, mais aussi l'Anjou, la Normandie et la région parisienne. Ces Irlandais étaient alors qualifiés chez nous d'Hibernois ou d'Irois.
C'est ainsi que nous trouvons en 1695 un Irlandais, nommé Patrice Morphy, domestique de la maison de Brezal.
Il y avait aussi Morphy à Landivisiau (cf deux baptêmes en 1658 et 1659). Par ailleurs, "François Cavanach, fils de Charles et Janne Morfi, né à Landivisiau, devient notaire et procureur à Landivisiau dans les années 1710, alors qu'il n'était encore que domestique en 1704 le jour de son mariage avec Marguerite De La Roche, issue elle aussi d'un couple d'Irlandais".
Mais, revenons à notre Patrice Morphy, il n'eut pas de chance. Voici son acte de sépulture dans l'église de Pont-Christ : "Le 21è du mois d'aoust 1695 mourut Patrice Morphy, Irois de nation, domestique de la maison de Bresall, noié dans l'estang du moulin et enseveli, le 28è, suivant l'ordonnance de monsieur le lieutenant de Landerneau sur la descente dudit corps, par moy soussignant ptre curé dudit Pont-Christ ce même jour en foy de quoy signé françois K/uzore, ptre".
2 - Les papetiers Normands
Les moulins à papier de Bretagne ont été presque tous construits et exploités par des papetiers venus de Normandie. Le moulin à papier de Brezal, qui était situé sur l'Elorn, au lieu-dit La Fonderie aujourd'hui, n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, les papetiers qui l'ont exploité portent des noms bien connus dans les départements de la Manche et du Calvados : de La Broise, Faudet, Barbot, Moulin, Huet, Bonel, Georget, Le Hideux... entre autres. Le premier, Jean de La Broise, était présent à Pont-Christ dès 1688 au moins. Voir le chapitre sur moulin à papier de Brezal.
3 - Quelques personnes au 18è siècle
- Certains surnoms relevés dans les B.M.S. de Pont-Christ laissent deviner des origines extérieures à notre Léon.
- Nicolas MARION, dit "Le Parisien" : décédé au château de Brezal, le dernier jour de juillet 1707.
- Pierre GIRAU, dit "Le Lambalay" : "le 4è jour de mars 1709 mourut, dans la communion de nostre mère la ste église au moulin de Bresal, Pierre Girau dit le Lambalay de la paroisse de Quissoy, évêché de St-Brieuc, qui a esté époux de Marguerite Bretagne".
- Un dénommé, ALLAIN, postillon du marquis de Kersauson en 1736, venait de Tregrom, évéché de Tréguier. On trouvera, sur la page consacrée aux meuniers du moulin de Brezal, l'histoire de sa triste fin, le 9/7/1736.
- Alexandre Marie Jean NEPOMUSAINE : Né vers 1746 à Pondichéry, il a été baptisé le 13 février 1755 à Pont-Christ, "naigre de naissance, âgé d'environ 9 ans habitant dans l'évêché de Leon depuis environ 6 ans, actuellement au château de Bresal en Plouneventer". Son parain fut Alexandre Marie Joseph Barbier de Lescoat, chevalier de l'ordre militaire de Malte, enseigne de vaisseau du roy. On peut supposer que c'est ce dernier, du fait de ses fonctions, qui a fait venir cet enfant à Brezal.
On se rend compte que ces personnes étaient attirées par les seigneurs de Brezal.
4 - Des Espagnols
Février 1939 : De nombreux espagnols fuient leur pays à la suite de la chute de la Seconde République espagnole et de la victoire du général Franco, c'est la "retirada". Le 1er février, 2.000 réfugiés arrivent à Quimper par le train et doivent être répartis dans différentes communes du département. Pont-Christ accueille une famille de trois personnes et deux jeunes filles.
5 - Ramón GERONES
Né en 1904 en Espagne, après avoir habité Kerfaven, il était logé en 1954 chez Marcel et Yvonne Amiry, tenancière du café-restaurant. Etait-il arrivé à Pont-Christ dans le groupe accueilli en février 1939 ? Je ne sais.
Ramón travaillait à la carrière de Kerfaven. Un jour, il reçut, pendant son boulot, une grosse pierre sur la tête. Il nous montra l'intérieur de sa casquette taché de sang.
Ramón était coiffeur à ses heures. C'est lui qui me coupait les cheveux dans la cuisine du passage à niveau 289. J'avais 5 ou 6 ans à l'époque, c'était donc vers 1956/57. Papa lui servait un verre de vin (ou deux ?). Pendant qu'il s'occupait de mes tifs, il avalait une goutte toutes les cinq minutes et il parlait et il parlait ... Durant son discours, il n'arrêtait pas de faire fonctionner sa paire de ciseaux qui coupait en l'air dans le vide, pointée vers le plafond, avec un petit bruit inquiétant. Et périodiquement, il revenait vers ma tête. Son outil amorçait une courbe descendante comme celle des avions qui bombardèrent ou mitraillèrent la ville de Guernica en 1937. C'est là que que je balisais à mort : j'avais peur qu'il ne m'arrache une mèche ou pire, emporté par ses propos, qu'il ne m'enlève un bout d'oreille. Il faut dire qu'à raison d'un coup de ciseaux, de temps en temps, mon calvaire durait une éternité.
6 - Bir RABIAH
Bir était né le 18/5/1918 à Kendira en Algérie, il était manoeuvre aux Ponts et Chaussées, autrement dit cantonnier. Il a habité Pont-Christ de 1954 à 1968 au moins. En 1968, il était logé dans le café-restaurant. Bir était une figure à Pont-Christ et très apprécié de tous.
Sources des informations
ADQ = Archives Départementales du Finistère à Quimper
ADLA = Archives Départementales de Loire-Atlantique
AN = Archives Nationales à Paris
AML = Archives Municipales de Landerneau
- Archives notariales du Finistère (ADQ)
- Justice de paix de Landivisiau (ADQ)
- Minutier central des notaires de Paris (AN ET/XV/... et AN/ET/LXVI/...)
- Archives de Louis Le Guennec (ADQ)
- Base recif du CGF
- Etat-civil reconstitué de Paris (sur internet)
- Echos de la Révolution en Finistère : Ce que fut le déclin du château de Brézal par le chanoine Jean-Marie Gueguen
dans "Le Progrès de Cornouaille" des 1er et 23/6/1957. - ... etc
Pour Sylvain Gabriel Ferrand de Saligny :
- Ventes de biens nationaux (ADQ 1 Q 1209 à 1215)
- Archives en ligne du Cher
- Archives en ligne de l'Oise - Beauvais
- Archives en ligne de l'Essonne
- Les grands notables impériaux - département du Cher - vol. 29
- ... etc
Pour la famille Le Roux :
- Base recif du CGF
- Recensements de Plouneventer et de Landivisiau
- Succession de Guillaume Le Roux à Brezal - Fonds Perret notaire à Lesneven (ADQ 78 J 7)
- Dossiers de clients, Le Roux. Fonds privé de l'étude notariale SCP Cozic-Landuré (AML 9 S 53 et 54)
- Albert Le Roux, banquier à Morlaix - fonds de l'étude Bagot, notaire à Morlaix (ADQ 81 J 50)
- Oblat de Saint Benoît : https://bibliotheque.idbe-bzh.org/data/cle_pax_26_mars_2020/Pax_Chronique_de_l_Abbaye_de_Kerbeneat_1951_nA_8__.pdf
- Justice de paix de Landivisiau du 9/1/1883 : dépôt des actes de la S.A. créée pour la fondation de l'école St-Joseph (ADQ 37 U 4/81)
- Registre des délibérations de la société pour l'École Chrétienne Landivisiau - 1882-1909 (fonds Pellan - ADQ 156 J 124)
- La presse ancienne : L'écho du Finistère, La Semaine Religieuse de Quimper et de Léon, Le Courrier du Finistère, Ar Wirionez, etc...
- La Société linière du Finistère par Yves Blavier
- Les Juloded par Louis Elegoët
- Essai sur la Bretagne hippique : le postier breton, le cheval de trait, le cheval de sang par A. Gast - 1907
- Stud-book vendéen : dictionnaire généalogique des étalons qui ont fait la monte dans la circonscription de 1839 à 1889 par Louis Hamon - Ed. La Roche-sur-Yon, L. Hamon, 1889 (Bibl. diocésaine de Quimper)
- Landivisiau, fille du Léon par Georges-Michel Thomas
- Chroniques du vieux Landivisiau par Georges-Michel Thomas
- Les Huon et les Huon de Penanster par Vincent Huon de Penanster (vhdp) - Oct. 2017
- ... etc...
Pour "Les immigrés au cours des siècles" :
- B.M.S de Pont-Christ
- La presse ancienne
- L'émigration des Irlandais en Bretagne au 17è siècle par Patricia Dagier.
- ... etc...
Pour Marie Jeanne Françoise de Tinténiac :
- Vieilles Maisons, Vieux Papiers - Vol. 1 G Lenotre - 2014 : https://books.google.fr/books?isbn=9791021007543
- Bulletin de la Société académique de Brest 1903-1904 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2076688/f53.image.r=savalette%20de%20langes
On y découvrira plus sur le caractère et la triste vie du gredin qui persécuta Mlle de Tinténiac. - Notice sur l'homme-femme connu sous le nom de mademoiselle Savalette de Langes, par Hérail https://books.google.fr/books?id=piYAAAAAQAAJ
- Fonds Louis Le Guennec : Pont-Christ - Brezal (ADQ 34 J 59)
- ... etc...
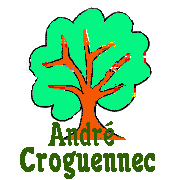 | |
| André J. Croguennec - Page créée le 11/4/2015, mise à jour le 26/10/2023. | |