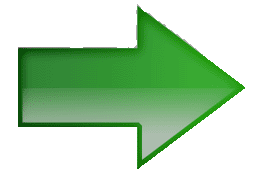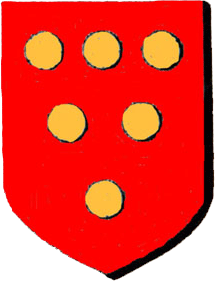 |
Glossaire illustré |  |

Ce glossaire nous permet d'expliquer des termes peu courants et parfois peu connus que nous rencontrons dans la description de notre patrimoine, mais il a aussi l'avantage de pouvoir dresser une liste illustrée de notre richesse patrimoniale locale.
Glossaire de l'architecture
| Ambon | Chacune des deux petites tribunes (ou lutrins) placées latéralement à la clôture du choeur, utilisées pour les lectures du rituel de la messe et pour la prédication. A La Roche, il n'y a plus qu'un seul ambon. |
| Arc en accolade |  Courbes qui couronnent les linteaux des portes et des fenêtres. Courbes qui couronnent les linteaux des portes et des fenêtres.
Un bel exemple est celui du moulin de Brezal, ici à droite.
X
Vandalisme : voilà ce qu'il reste à l'emplacement de l'arcature du chevet de l'église qui a été dérobée. Et ce n'est, hélas, pas la seule trace de vandalisme en ce lieu.

X
Vandalisme : voilà ce qu'il reste à l'emplacement de l'arcature du chevet de l'église qui a été dérobée. Et ce n'est, hélas, pas la seule trace de vandalisme en ce lieu.

Il y en avait un aussi au chevet de l'église de Pont-Christ, voir le dessin de Félix Benoist Dans l'église de La Roche, nous avons un autre exemple : la porte d'entrée de la sacristie. |
| Arches : - Plein cintre - Anse de panier - Plein cintre surbaissé |  Les arches des ponts ou d'autres constructions peuvent avoir des formes différentes. Le schéma ci-contre montre la superposition de deux formes : "plein cintre" (un demi-cercle parfait) et "anse de panier". Les arches des ponts ou d'autres constructions peuvent avoir des formes différentes. Le schéma ci-contre montre la superposition de deux formes : "plein cintre" (un demi-cercle parfait) et "anse de panier". Les arches du pont de Pont-Christ sont clairement des arches "plein cintre". Mais qu'en est-il de celles du pont de La Roche sur l'Elorn ? "Plein cintre" ou "anse de panier" ou "plein cintre surbaissé" ? Les écrits, que j'ai pu rencontrer sur ce sujet, sont contradictoires, mais la démonstration, ci-jointe, clarifie le sujet. |
| Balustre |  Petit pilier assemblé avec d'autres pour former un appui (balustrade) ou une clôture. Petit pilier assemblé avec d'autres pour former un appui (balustrade) ou une clôture.La photo montre celle qui existait à Pont-Christ, pour délimiter l'emplacement du choeur, et qui a été déplacée dans l'église de La Roche. On peut en voir aussi, en tant que clôture, dans le jubé de cette même église. |
| Barlotières | Barres métalliques scellées dans le remplage soutenant les panneaux du vitrail. "Les baies de l'église de Pont-Christ sont actuellement, vides de vitraux, cependant on peut y relever les empruntes des barlotières, ou ferrures, qui maintenaient les panneaux de vitraux" (Jean-Pierre Le Bihan). |
| Bas-relief | Ouvrage de sculpture en une matière quelconque qui forme une faible saillie sur le fond auquel il appartient. Le moyen-relief est celui dont la bosse est un peu plus haute. Le haut-relief, celui dont les figures sont presque détachées du fond. Dans le jubé de La Roche, la galerie du côté du choeur est en bas relief, celle du côté de la nef est en haut-relief ou ronde bosse. |
| Blochet |  Pièce de bois apparente dépassant de la sablière et du mur. Pièce de bois apparente dépassant de la sablière et du mur. Beaucoup de motifs sculptés de l'église de La Roche sont érotiques, voire pornographiques. Mais pas tous cependant... On trouvera d'autres blochets plus classiques ICI. |
| Calvaire |  Un calvaire est un monument qui représente le Christ crucifié. On estime habituellement que pour mériter l’appellation de "calvaire", la croix du Christ (ou crucifix) doit être entourée par d’autres personnages, par exemple : la Vierge, l’apôtre saint Jean, Marie-Madeleine, les larrons...
Un calvaire est un monument qui représente le Christ crucifié. On estime habituellement que pour mériter l’appellation de "calvaire", la croix du Christ (ou crucifix) doit être entourée par d’autres personnages, par exemple : la Vierge, l’apôtre saint Jean, Marie-Madeleine, les larrons...1 - Fût 2 - Crucifix 3 - Fleurons 4 - Titulus portant l’inscription INRI (Jésus de Nazareth Roi des Juifs) 5 - Les cavaliers sont des soldats romains présents au Calvaire. La tradition a donné le nom de Longin à celui qui transperça de sa lance le côté du Christ et Stéphaton à celui qui lui donna à boire à l’aide d’une éponge piquée au bout de sa lance. 6 - Croisillons. Traverses horizontales aux extrémités desquelles des consoles supportent des statues souvent géminées (deux saints ou saintes adossés, taillés dans le même bloc de pierre). 7 - Écu. Les armes qui y sont représentées sont celles du donateur ou d’une famille prééminente du lieu. 8 - Vierge au pied de la croix. 9 - Saint Jean l’évangéliste au pied de la croix. 10 - Pietà ou Vierge de pitié tenant le corps mort du Christ. 11 - Nœud ou chapiteau. 12 - Écots. Ils évoqueraient les épidémies de peste à l’époque de la construction des calvaires. 13 - Bon Larron. Dans l’évangile apocryphe de Nicodème (IVe s.) il est appelé Gesmas. Représenté à la droite du Christ, il a le visage apaisé et est parfois accompagné d’un ange qui porte son âme au Ciel. 14 - Mauvais Larron, encore appelé Dysmas. Il est représenté à la gauche du Christ, le visage grimaçant, tirant la langue et parfois accompagné d’un démon. 15 - Marie-Madeleine (ou Madeleine) pleure au pied de la croix. Elle est généralement représentée avec son attribut : un vase de parfum ou vase à nard. 16 - Socles des croix. Ils sont souvent chanfreinés (les arêtes sont coupées). 17 - Mace. 18 - Emmarchement. Les marches sont également appelées "degrés". (source APEVE : texte et schéma) |
| Cartouche |  Un cartouche est un ornement sculpté décorant la façade d'un bâtiment, constitué d'un encadrement bordant une surface affichant l'année de construction de l'édifice, son nom, une devise, une épitaphe, des armoiries ou un motif ornemental. C'est aussi parfois, un ornement figurant une table bordée d'enroulements et de motifs variés. Un cartouche est un ornement sculpté décorant la façade d'un bâtiment, constitué d'un encadrement bordant une surface affichant l'année de construction de l'édifice, son nom, une devise, une épitaphe, des armoiries ou un motif ornemental. C'est aussi parfois, un ornement figurant une table bordée d'enroulements et de motifs variés.
Exemple : dans le fronton du pignon sud de l'ossuaire de La Roche. |
| Chaperon | Dans un pont, couronnement d'un avant-bec ou d'un arrière-bec destiné à le protéger des eaux pluviales. A propos du pont de La Roche, Serge Montens, dans Les plus beaux ponts de France Ed. Bonneton, 2001, écrit ceci : "Ce pont en maçonnerie sur l'Elorn comporte 3 arches en plein cintre et des becs triangulaires chaperonnés." On peut voir ICI que les chaperons sont triangulaires et pyramidaux. |
| Claire-voie | Clôture formée de barreaux espacés. Comme la partie du jubé de La Roche, située entre le soubassement plein et la tribune. |
| Concile de Trente | Le concile de Trente est le dix-neuvième concile oecuménique reconnu par l'Église catholique. Il se tint à Trente dans les alpes, aujourd'hui en Italie. Convoqué par le pape Paul III le 22 mai1 1542, en réponse aux demandes formulées par Martin Luther et Jean Calvin dans le cadre de la Réforme protestante, il débute le 13 décembre 1545 et se termine le 4 décembre 1563. Le pape lui avait donné pour objectif de revigorer l'Église catholique en la réformant, et clarifier la doctrine chrétienne, définir les dogmes face aux idées protestantes, renforcer le pouvoir spirituel du pape. |
| Côté de l'épître Côté de l'évangile | Dans les célébrations des basiliques, des cathédrales, des collégiales et des monastères, un sous-diacre proclamait l’épître, en se plaçant dans le choeur, du côté Sud, qui est à droite lorsque l’autel est à l’Est et la nef à l’Ouest. Un diacre proclamait l’évangile dans le choeur, du côté Nord. Même dans les messes dites “basses” et les messes sans assemblée, le prêtre à l’autel se déplaçait à droite pour lire l’épître et à gauche pour lire l’évangile. De là proviennent, dans les anciens livres et catéchismes, les expressions “côté épître” et “côté évangile”, pour désigner respectivement le côté droit et le côté gauche dans les églises. |
| Crédence |  Sorte de niche pratiquée dans la muraille voisine de l'autel dont la base, à hauteur d'appui, sert à poser les objets immédiatement nécessaires à la célébration de la messe, comme les burettes, destinés à contenir le vin et l’eau de la messe. Sorte de niche pratiquée dans la muraille voisine de l'autel dont la base, à hauteur d'appui, sert à poser les objets immédiatement nécessaires à la célébration de la messe, comme les burettes, destinés à contenir le vin et l’eau de la messe. Crédence à Pont-Christ A l'époque romane, elles étaient munies de piscines à l'usage de l'ablution des mains du prêtre, un trou percé dans la pierre inférieure emmenait l'eau à l'extérieur. Elles sont sans piscine à partir du XIIIè siècle l'usage de l'ablution des doigts ayant lieu à l'autel. Une tablette horizontale en pierre les sépare en deux dans le sens de la hauteur. Elles ont une profondeur de 30 à 40 centimètres. Les piscines gothiques sont souvent géminées et, à leur sommet, garnies d'arcades trilobées, des gables à crochets les décorent souvent. Les crédences ont été généralement bouchées au XVIIè siècle lorsqu'on garnit les sanctuaires de boiseries. Elles furent alors remplacées par des meubles (Console) qui empruntèrent ce même nom de crédence. - Quelques crédences gothiques, disposées à plusieurs compartiments étagés, servaient en outre à renfermer les vases sacrés ; elles ferment à clefs ; telles sont celles de la Sainte-Chapelle à Paris. Ce sont les crédences-sacrarium. |
| Crochet | Un crochet, appelé aussi crosse végétale ou plus simplement crosse, est un ornement saillant en pierre sculptée, que l'on trouve fréquemment sur sur les rampants des frontons, les frises, les corniches, les pinacles... Voir deux exemples à la rubrique fleuron. On en voir aussi sur les rampants du moulin de Brezal, ainsi que sur ses arcs en accolade. |
| Cuir | Entourage d'un cartouche rappelant un morceau de cuir découpé et contourné en volute. Un exemple sur le soubassement du jubé à droite, côté choeur. "Un putto embelli d'une cravate de feuillage dans un cuir découpé ..." (Yannick Pelletier). |
| Culot Cul-de-lampe | 
La photo montre un support de statue sur un pilier de l'église de Pont-Christ. Autre exemple à Pont-Christ. |
| Echalier |  Pierre dressée que l'on doit enjamber pour entrer dans un enclos paroissial et qui servait à empêcher les animaux d'y pénétrer. Pierre dressée que l'on doit enjamber pour entrer dans un enclos paroissial et qui servait à empêcher les animaux d'y pénétrer.A Pont-Christ, seule l'entrée de gauche, ci-contre, a conservé son échalier. L'entrée de droite, de l'autre côté du montant en pierre que l'on voit ici, n'a plus d'échalier. En a-t-elle eu ? Sur des vieilles cartes postales, on y voit une barrière en bois. Telle qu'elle est aujourd'hui, elle a donc permis le passage des processions lors de pardon religieux. |
| Ecoinçon |  Ouvrage de menuiserie ou de maçonnerie formant l'encoignure de l'embrasure d'une baie. Il désigne aussi l'espace compris entre deux arcs ou entre un arc et une délimitation rectangulaire. Ouvrage de menuiserie ou de maçonnerie formant l'encoignure de l'embrasure d'une baie. Il désigne aussi l'espace compris entre deux arcs ou entre un arc et une délimitation rectangulaire.Exemple : Vitraux à la Roche-Maurice. |
| Enclos | Ensemble architectural composé de l'église, de l'ossuaire, du calvaire et du cimetière. Voir ce chapitre pour plus de précisions. |
| Engoulant | Un engoulant ou rageur est en architecture une extrémité sculptée en forme de gueule. Il s’agit d'une tête d’animal réel ou imaginaire sculptée sur les poutres de charpente au niveau de la sablière, de l’entrait ou des poinçons mais aussi des colonnes ou des gouttières. Souvent, les engoulants représentent des têtes de dragons mais il peut s’agir de crocodiles, serpents, goules ou autres bestiaires représentant le mal. Voir un exemple à La Roche. |
| Entrait | L'entrait, terme de charpente, est un élément de la ferme. C'est une pièce de bois horizontale qui sert à réunir les arbalétriers, dont elle maintient l'écartement. L'arbalétrier est une pièce posée obliquement supportant les pannes. Les deux arbalétriers forment un triangle avec l'entrait (qui constitue la base du triangle). Voir le schéma. Dans l'église de La Roche, les deux extrémités des entraits semblent avalés ou tenus par des gueules de dragons qu'on appellent des engoulants. |
| Fleuron |   Un fleuron est un ornement isolé, fait généralement d'un motif floral sculpté (fleur, feuille) étagé et stylisé dans tous les styles d'architecture. Il désigne plus particulièrement un motif d'ornementation décorant les sommets (gâble, pignon) dans les monuments de style gothique. Un fleuron est un ornement isolé, fait généralement d'un motif floral sculpté (fleur, feuille) étagé et stylisé dans tous les styles d'architecture. Il désigne plus particulièrement un motif d'ornementation décorant les sommets (gâble, pignon) dans les monuments de style gothique.
On trouve de jolis fleurons qui couronnent les pignons de l'église de Pont-Christ, ainsi que le pignon nord de l'ossuaire de La Roche : 1 - le pignon du transept nord de l'église en ruines de Pont-Christ2 - le pignon nord de l'ossuaire. Au moulin de Brezal, les fleurons sont collés au pignon ouest : au sommet des arcatures (voir plus haut) et contre la "souche" de la cheminée, au-dessus du toit. |
| Gâble |  Fronton couronnant un mur de façade ; pignon triangulaire surmontant une fenêtre ou une porte, dont les deux côtés obliques, appelés rampants, peuvent être décorés de motifs divers. Fronton couronnant un mur de façade ; pignon triangulaire surmontant une fenêtre ou une porte, dont les deux côtés obliques, appelés rampants, peuvent être décorés de motifs divers.Ici une fenêtre du moulin de Brezal, avec son gâble au-dessus, orné d'un homme accroupi (à gauche) et d'un chien (à droite). |
| Gargouille |  Gouttière saillante en forme de canon ou d'animal fantastique qui rejette les eaux de pluie loin des murs. Gouttière saillante en forme de canon ou d'animal fantastique qui rejette les eaux de pluie loin des murs.
Le clocher de La Roche a des gargouilles en forme d'animal fantastique aux quatre coins de la première galerie et en forme de canon aux quatre coins de la galerie supérieure.
Mais ces gargouilles ont une caractéristique bien particulière : les bâtisseurs du clocher en 1589 ont oublié de creuser la pierre pour ménager un canal d'évacuation des eaux de pluie ; ces gargouilles ne remplissent donc pas leur rôle. C'est ce qu'a constaté l'architecte Rivoalen, intervenu en 1869 pour la consolidation du clocher. Il a "remarqué que les gargouilles ou animaux chimériques n'étaient pas forées, c'est-à-dire que ces animaux étaient sans gorge ; il propose donc de suppléer à ce dernier défaut par huit tuyaux en plomb faisant saillie de 0,30 m. en dehors des maçonneries, afin de débarrasser les galeries des eaux pluviales qui, à l'aide d'une légère pente dans le nouveau dallage, se répartiraient entre ces 8 tuyaux. Un diamètre intérieur de 0,035 suffirait". On aperçoit encore ces tuyaux sur les photos. |
| Godronné |  Orné d'un godron, motif creux ou saillant ayant la forme d'un oeuf très allongé.
Orné d'un godron, motif creux ou saillant ayant la forme d'un oeuf très allongé.Sur la photo, la vasque des fonts baptismaux de Pont-Christ, déplacée devant l'église de La Roche. Dans le jubé, à La Roche, les colonnettes de la claire-voie ainsi que celles séparant les panneaux décoratifs des soubassements et de la galerie sont décorées de godrons et de cannelures. |
| Grisaille | Peintures exécutées en camaïeu gris. Genre de vitraux composés d'ornements légers sur un fond clair. |
| Grotesques | On donne le nom de grotesques à ces petites figures fantaisistes, satyriques ou grivoises qu'il n'est pas rare de trouver encore dans les peintures et surtout les sculptures des églises. On ne peut, de nos jours,
admirer ces ouvrages extravagants dont certains ne peuvent que provoquer le scandale. Mais, enfin, ils sont là, c'est un fait, et cette constatation jette un jour curieux sur les moeurs et l'état d'esprit qui existait lorsqu'on les fit. Une grande
liberté était laissée aux artistes qui, s'ils laissaient parfois aller leur imagination à certains écarts, rachetaient ces dérèglements accidentels par quantité d'oeuvres où la plus sincère émotion s'alliait à la plus profonde et vraie piété ; une
large tolérance acceptait le tout. Les imagiers étaient un peu considérés comme des privilégiés marqués du don céleste, et ce qui vient du ciel il faut l'accepter tel quel : le soleil qui fait mûrir les blés met aussi parfois le feu aux meules. Il convient de conserver avec soin même les plus licencieuses de ces oeuvres ; il faut se rappeler qu'elles ont été produites au moment sain et vigoureux où la foi n'avait pas encore subi les atteintes du schisme, et qu'on ne commença à les proscrire ou à les mutiler que lorsque la Réforme eut jeté son ferment d'hypocrite momerie. (L'art sacré : revue mensuelle illustrée de l'art chrétien, 1902 - AEQ en ligne) |
| Jubé |  On appelle jubé une galerie portée par une clôture monumentale, placée dans une église à la séparation de la nef et du choeur et formant à cet endroit une tribune à laquelle on accède par un escalier qui peut être enfermé dans le creux d'un pilier. On appelle jubé une galerie portée par une clôture monumentale, placée dans une église à la séparation de la nef et du choeur et formant à cet endroit une tribune à laquelle on accède par un escalier qui peut être enfermé dans le creux d'un pilier.
Avant que l'on ne construisît des jubés, la coutume était que l'on édifiât à droite et à gauche du choeur une tribune appelée ambon d'où se faisait la lecture de l'Epître et de l'Evangile, les communications importantes aux fidèles, telles que les sermons, de même qu'on y chantait les leçons des offices de Matines et celle du commencement des Complies. Ces leçons étaient précédées d'une formule par laquelle le lecteur demandait la bénédiction de l'officiant : "jube, domine, benedicere", c'est-à-dire, veuillez, maître, me bénir. Du premier mot de ce versicule en langue latine, est venu le nom donné à cette tribune tranversale qui, remplaçant les ambons, en conserve les fonctions. Le jubé comprend trois éléments principaux : Texte extrait de l'ouvrage de Yannick Pelletier Les jubés de Bretagne. |
| Macle |   Losange évidé dans les armoiries. Certains auteurs rapproche cette figure d’une maille de cuirasse, d’autres d’une boucle de baudrier ou ceinture sans ardillon. Losange évidé dans les armoiries. Certains auteurs rapproche cette figure d’une maille de cuirasse, d’autres d’une boucle de baudrier ou ceinture sans ardillon.Des macles sont présentes sur l'écu des Rohan : De gueules, à neuf macles d'or. Devises : 1° à plus 1; 2° Roi ne puis, Prince ne daigne, Rohan suis. On les voit ici dans un culot de la voûte centrale et sur les piédroits du portail sud de l'église de La Roche. Rappelons aussi celles que l'on trouve sur la maîtresse vitre. 1 La devise : « A plus » « Certains pensent qu’elle est tronquée », explique Josselin de Rohan. Elle peut avoir deux sens : soit elle signifie « sans égal », ou alors « peut mieux faire ! ». La première a la préférence du 14e duc du nom. |
| Meneau | Traverse horizontale ou verticale délimitant les baies d'une fenêtre. C'est un élément du remplage. |
| Pietà | Une pietà — ou Vierge de Pitié — est une représentation de Marie tenant le corps de son Fils mort après sa descente de la croix. Ce thème religieux et artistique, né en Allemagne au début du XIVe siècle, s’est répandu dans toute l’Europe les siècles suivants. La plupart des églises et chapelles bretonnes montrent une pietà, parfois plusieurs, sur le calvaire ou dans l’église. Lorsque Marie et le Christ sont entourés par d’autres personnages (Jean, Marie-Madeleine, les saintes femmes...), cet ensemble est habituellement nommé "déploration du Christ" ou "déploration collective" (définition APEVE). Voir la Pietà dans l'ossuaire de La Roche. |
| Pilastre |  Sur une paroi, élément vertical de soutien ou de décor, ayant l'aspect d'une colonne plate de section rectangulaire. Sur une paroi, élément vertical de soutien ou de décor, ayant l'aspect d'une colonne plate de section rectangulaire. Ici, les pilastres de l'étage supérieur de l'ossuaire de La Roche. |
| Pinacle |  Amortissement ou couronnement qui a la forme d'un petit clocher.
Amortissement ou couronnement qui a la forme d'un petit clocher. Dans l'architecture gothique le pinacle est un ouvrage en plomb ou en pierre, de forme pyramidale ou conique (forme de clocheton plus ou moins ouvragé), souvent ajouré et orné de fleurons, servant de couronnement à un contrefort, un pilier, un pignon, un fronton, un gable. Décoratif, il contribue aussi à la stabilité structurelle générale. En architecture, un amortissement est un élément décoratif placé au sommet d'une élévation (pinacle, gable, lanternon, pyramidon, épi de faîtage de toit) pour marquer l'achèvement de l'axe vertical de la composition architecturale. Exemple dans le clocher de La Roche-Maurice, ci-contre. |
| Putto, putti (pluriel) |

L'ancien autel a aussi ses "putti", en voici l'un des deux. 
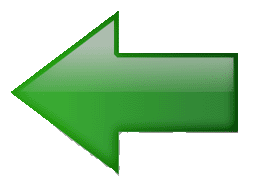
On en voit un également sur le soubassement du jubé à droite, côté choeur. "Un putto embelli d'une cravate de feuillage dans un cuir découpé ..." (Yannick Pelletier).

A l'origine, un putto est un enfant nu dans les représentations artistiques. C'est notamment un terme de l'ornementation architecturale italienne qui désigne sur une façade la statue d'un nourrisson joufflu et moqueur. Il s'agit presque toujours d'un garçon. Souvent, il se voit doté d'ailes et ressemble à un angelot. Les images qu'on vient de voir sont donc des représentations stylisées. Par contre, il y a d'autres petits angelots pendus au plancher de la galerie du jubé de l'église Saint Yves, qui sont plus conformes à l'idée d'origine. Ils sont huit du côté de la nef. 







|
| Remplage |  Les baies les plus grandes ont été divisées par un assemblage de pierre appelé "remplage". Ce procédé s'est développé dès l'architecture gothique qui a engendré des ouvertures de plus grandes tailles. On distingue généralement la partie haute du remplage : le réseau ; et la partie basse où sont alignés les meneaux et les lancettes. Les divisions obtenues par le remplage sont appelées « jours » ou « ajours ».
|
| Sablière | Pièce de bois, très souvent sculptée de motifs admirables, reposant sur un lit de sable, et servant de réceptable aux pieds de charpente. Voir ICI quelques exemples dans l'église de La Roche. A quelques endroits, ces sablières sont ornées de blochets. L'église de Pont-Christ avait aussi ses sablières, ornées d'inscriptions. |
| Soufflet |  Le soufflet est un motif décoratif utilisé en architecture du XIVè au XVIè siècle en ajour dans le réseau des fenêtres et dans les balustrades, et aussi en bas-relief sur les boiseries et sur les murs extérieurs. Le soufflet est un motif décoratif utilisé en architecture du XIVè au XVIè siècle en ajour dans le réseau des fenêtres et dans les balustrades, et aussi en bas-relief sur les boiseries et sur les murs extérieurs. Ajour de forme symétrique évoquant celle d'un soufflet de foyer ou d'un coeur. C'est une figure aux contours symétriques contrairement à la mouchette à laquelle il est souvent associé. Mouchette : ajour formé d'une courbe et d'une contre-courbe, en forme de flamme. Réseau : partie supérieure d'un vitrail appelée aussi tympan. Lancettes : ouvertures verticales dans la partie inférieure d'un vitrail. Les lancettes sont séparées par des meneaux verticaux. Leur partie supérieure, ou tête de lancette, est formée d'arcs de cercle selon des figures diverses : en plein cintre, en ogive, en trilobe, ... Voir le réseau des armoiries de la maîtresse vitre de La Roche-Maurice, qui est constitué de soufflets, de mouchettes et d'écoinçons. |
| Trève | La trève est un quartier périphérique de paroisse qui a été érigé en paroisse, dite parfois paroisse-fillette ou succursale, dépendante de la paroisse-mère. "Chaque trève était administrée par un curé trévien que le recteur de l'église matrice choisissait et faisait approuver par l'évêque. La dépendance de l'église tréviale à l'égard de la paroisse-mère s'exprimait notamment par le fait que les trèviens devaient participer aux dépenses de la paroisse et qu'ils étaient tenus de faire, une ou deux fois l'an, une procession en l'église paroissiale, en reconnaissance de la prééminence de celle-ci" (Louis Elegoët). "L'érection en trève ne s'est pas faite, en général, avant le XVIè siècle. Les trèves n'existaient qu'en Bretagne, et surtout dans la moitié occidentale. Le diocèse de Cornouaille comportait 176 paroisses et 90 trèves ; celui de Tréguier, 101 paroisses et 30 trèves ; celui de Léon, 87 paroisses et 33 trèves. Une même paroisse pouvait avoir plusieurs trèves. De Ploudiry dépendaient ainsi La Martyre, La Roche-Maurice, Loc-Eguiner, Pencran, Pont-Christ et St-Julien de Landerneau. Certaines, comme Landivisiau, étaient devenues bien plus riches et plus peuplées que leur paroisse mère. La Révolution a supprimé les petites trèves et transformé les autres en paroisses autonomes" (Jean Rohou). |
| Tympan | Espace uni ou sculpté, circonscrit par un ou plusieurs arcs. Voir le tympan dans le portail-sud de l'église de La Roche. |
| Transept | Nef transversale qui coupe la nef principale d'une église pour lui conférer une forme de croix. Souvent cette forme correspondant à la croix latine la plus typique des croix, celle qui pour les chrétiens représente la Crucifixion de Jésus. Elle possède deux bras perpendiculaires dont celui transversal est plus court par rapport au longitudinal. A Pont-Christ, cette croix est en forme de Tau (lettre grecque), elle est privée de son bras supérieur. A La Roche, l'église n'a pas de transept. |
| Vitrail, maîtresse vitre | Maîtresse vitre : vitrail du chevet qui éclaire le maître-autel. |
Les arches du pont de La Roche sur l'Elorn


"plein cintre" (un demi-cercle parfait) et "anse de panier".
Cliquer ici pour superposer le schéma sur une arche
- Un plein cintre n'a qu'un seul rayon, l’arc est un demi-cercle et les parties verticales sont dans le prolongement de ce demi cercle : ainsi le rayon est égal à la moitié de la largeur.
- Un arc surbaissé régulier est composé d’un seul rayon et il y a une coupe entre l’arc et les parties verticales.
- L’anse de panier est une forme composée de plusieurs rayons, 3 le plus souvent, et les parties verticales sont dans le prolongement de la partie cintrée.
Pour des précisions sur le pont de La Roche, voir ICI et LA.
Glossaire de la meunerie
Voir ICI, le glossaire et les schémas établis à l'occasion de l'étude du moulin de Brezal.
Source des informations
- Autres chapitres du site "Pont-Christ Brezal"
- https://fr.wiktionary.org/wiki/putti
- Le blog de Jean-Yves Cordier https://www.lavieb-aile.com/2020/12/le-jube-de-l-eglise-saint-yves-de-la-roche-maurice-29.html
J'ai publié dans ce chapitre de nombreuses vignettes qui sont des extraits, rognés pour cadrer avec mes sujets, des photos de Jean-Yves Cordier.
On ne louera jamais assez son blog tant pour ses photos grand format que pour ses textes. Merci Jean-Yves Cordier. - Les jubés de Bretagne par Yannick Pelletier, éd. Ouest-France, juin 1986.
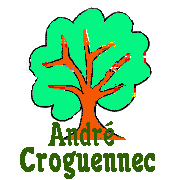 | |
| André J. Croguennec - Page créée le 13/7/2022, mise à jour le 17/3/2023. | |