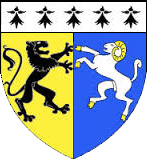 |
Yan' Dargent - 1 (1824-1899) |  |
Voir aussi :
- Le bicentenaire de sa naissance- Les artistes que Pont-Christ a inspirés
- Littérature diverse
- Yan' Dargent dans la grotte de l'ermite
- Félix Jobbé-Duval, un maître de Y' D.
- Le portrait de la comtesse de Rodellec
- A - Introduction
- B - Quelques oeuvres diverses
- La Légende de Saint Kadock
- Saint Houardon
- L'été.
- La mort de Salaün
- Les lavandières de la nuit
- C - Peintures murales de la cathédrale de Quimper
- D - Autres oeuvres - diaporama << Mise à jour 13/1/26
- E - Articles de presse
- F - Liste non exhaustive de ses oeuvres
- G - Portraits du peintre (iconographie et texte) < Màj 5/6/25
- H - Sources
A - Introduction

Né à Saint-Servais, tout près de Pont-Christ, d'une mère bretonne et d'un père lorrain, Yan' Dargent (1824-1899), Jean Edouard DARGENT à l'état-civil ![]() , réalisa une production artistique très variée :
, réalisa une production artistique très variée :
- illustrateur comme Gustave Doré, son concurrent
- peintre paysagiste
- peintre de scènes mystiques (Sainte Famille, Saints, légendes bretonnes, ...)
- réalisateur des fresques de la cathédrale de Quimper
- chemin de croix de l'église de Saint-Houardon à Landerneau
- concepteur de vitraux, notamment ceux de l'église de Plounéventer... etc...
Il a été promu "Chevalier de la Légion d'honneur" le 8 février 1877 ![]() .
.
Résumé des services pour lesquels Mr Yan' Dargent a été promu par le Maréchal de Mac Mahon
au grade de Chevalier de la Légion d'honneur :
- 47 grands volumes ilustrés
- Collaboration à toutes les bonnes publications illustrées
- Différents tableaux dans les différents musées de France
- Tableau religieux de St Houardon à l'église de Landerneau
- 6 grandes fresques, chapelle mortuaire de St-Servais Finistère
- 12 apôtres et 2 anges, fresques, et 4 sujets, fresques, chapelle St Joseph à Morlaix, Finistère
- 2 grands tableaux, fresques, église de Ploudalmezeau, Finistère (Purgatoire et descente de croix)
- décoration de la Cathédrale de Quimper, dont suit le détail :
- 2 chapelles donnant sur le transept : Ste Anne, St Pierre
- 6 chapelles à 2 sujets chacune
- chapelles de gauche : St Frederich, St Roch, St Corentin(source Base de
données Léonore)
- chapelles de droite : St Joseph, St Paul, St Jean-Baptiste.
Un musée lui est consacré à Saint-Servais et de nombreuses oeuvres peuvent être admirées dans le Finistère et en Bretagne.
Ses oeuvres qui ont pour sujet Pont-Christ et Brezal sont présentées dans le chapitre "Les artistes que Pont-Christ a inspirés". On trouvera ici, plus bas, d'autres oeuvres sur des sujets différents, mais toujours aussi belles.
Yan' Dargent a été photographié par l'abbé Habasque dans la grotte de l'ermite à Brezal vers 1890.
Qui était Yan Dargent ? C'était le petit-fils de Pierre Robée, figure bien connue à l'époque à Brezal et à Saint-Servais. Voici quelques notes sur sa famille bretonne.
Marié le 11 janvier 1824, St-Servais, avec Marguerite Perrine Clémentine ROBEE, née le 30 juillet 1803, Brest, décédée le 15 juin 1826, Keryven, St-Servais (à 22 ans), dont
- Jean Edouard DARGENT, né le 15 octobre 1824, Keryven, St-Servais, décédé le 19 novembre 1899, Paris, enterré à St-Servais
(à 75 ans), artiste-peintre.
Relation avec Aimée Louise Eulalie CRIGNOU, décédée en 1861, dont- Ernest DARGENT, né en 1849, Paris, décédé le 30 juin 1908, Paris (à 59 ans), artiste-peintre.
B - Quelques oeuvres
La Légende de saint Kadock

Yan' Dargent (1824-1899) - La Légende de saint Kadock, vers 1880
Plaque de terre cuite émaillée, 14,5 x 28,5 cm - Musée des beaux-arts de Quimper © Musée des beaux-arts de Quimper
Cette rarissime plaque émaillée éclaire d'un jour nouveau la carrière et les créations de Yan' Dargent, artiste bien connu à Quimper. Illustrant le monde merveilleux et légendaire de la venue des évangélisateurs gallois, écossais ou irlandais en Bretagne, Yan' Dargent décrit avec un sens du naturel inné l'invraisemblable traversée qu'effectue saint Cado (ou saint Kadock), installé dans son auge de pierre poussé par deux anges joyeusement accaparés par leur tâche. La finesse du dessin est magnifiée ici par l'usage d'un camaïeu bleu sombre parfaitement maîtrisé. Cette composition aux petits accents à la William Blake reprend, mais en sens inversé, le grand tableau du Miracle de Saint Houardon (tableau qui suit) conservé dans l'église Saint-Houardon de Landerneau. Cette dernière oeuvre date de 1859. Ce sujet, qui devait plaire à l'artiste, est traité plus tard en abordant la légende de saint Kadock, au début des années 1860. Une gravure, publiée dans l'Illustration des dames et des demoiselles du 19 juin 1864, en garde le souvenir.
Quant à cette plaque, les opinions divergent au sujet de l'atelier qui l'aurait vu naître. Le catalogue de l'étude de Brest évoque la maison HB à l'époque de la direction de Mme Malherbe-Béru, veuve de La Hubaudière. Bernard Verlingue, directeur du musée de la Céramique de Quimper, évoque lui, plutôt une création en collaboration avec le peintre Michel Bouquet au sein des ateliers de Keremma. Dans tous les cas, la datation s'oriente autour des années 1880.
Saint-Houardon traversant la Manche

Saint Houardon traversant la Manche - Eglise de Saint Houardon à Landerneau ![]()
L'été


L'été (source 1864-illustration-1112_Page_12)
La mort de Salaün

La mort de Salaün - Eglise de Saint Servais - Photo A. Croguennec
Salaün ar Foll est considéré comme simple d'esprit par ses contemporains, mendiant son pain de ferme en ferme en répétant inlassablement « Ave Maria, itroun gwerc'hez Maria (Oh! madame Vierge Marie!) ». Il vit dans une clairière de la forêt près de Lesneven. Il est appelé "Le fou du bois" (Foll ar c'hoad), car selon la légende, il habite dans le creux d'un arbre, dans la forêt. Il passe toutes ses journées à mendier, après avoir assisté à la messe du matin. "Salaün ar Foll" meurt dans l'indifférence en 1358. Peu après, on découvre sur sa tombe un lys sur lequel est écrit en lettres d'or : "Ave Maria". En ouvrant sa tombe, on constate que le lys prend racine dans sa bouche. Le « miracle » attire rapidement les foules. On bâtit une chapelle basilique Notre-Dame du Folgoët au lieu désormais appelé Le Folgoët, qui sera érigée en collégiale par le duc Jean V en 1423.
Lire la superbe pièce de théâtre, en vers et en breton, bien sûr, écrite par Tangi Malmanche : "Buhez Salaün, lesanvet ar foll".
Les lavandières de la nuit

Les lavandières de la nuit (Musée des Beaux-Arts de Quimper)
"Il y a, dit-il,un véritable sentiment fantastique dans Les lavandières de la nuit de M. Yan' Dargent. On connaît cette légende bretonne des laveuses-spectres qui savonnent des linceuls avec des clairs de lune sur la pierre des lavoirs et prient le passant égaré de les aider à tordre leur linge. C'est par ces nuits où des brumes blanches flottent au-dessus des prairies et des saulaies qu'on entend le bruit de leurs battoirs couper la note plaintive de la rainette dans le vaste silence des campagnes. L'artiste a représenté sur une toile de forme oblongue les lavandières de la nuit à la poursuite d'un pauvre paysan breton à qui la peur donne des ailes malgré ses grègues embarassantes et ses lourds sabots. Mais l'haleine va bientot
Et ce sont ces quelques lignes qui suffisent pour attirer le visiteur et ainsi changer la vie de Yan' Dargent. Voici l'enfant de Saint-Servais en passe d'être célèbre, non seulement à Paris, mais dans la France entière. Son tableau est reproduit dans la presse, en particulier dans L'illustration de juillet 1861. (Jean Berthou).
et lire la légende dans la version d'Emile Souvestre.
Les vapeurs de la nuit

Les vapeurs de la nuit (Musée de St-Servais et musée de Lyon)

Un des panneaux de la fresque dans l'ossuaire de St-Servais - Photo A. Croguennec.
Cette peinture murale en quatre parties fut découverte il y a une vingtaine d'années sur le grand mur de l'ossuaire. C'était à l'occasion de l'enlèvement du lambris qui avait besoin de réparation. Les chefs-d'oeuvre sont parfois découverts par hasard.

Dahut a provoqué la submersion de la ville d'Ys. Gradlon, son père, a bien essayé de la sauver en l'emportant sur son cheval, mais il a dû l'abandonner dans les flots. Pour Yan' Dargent, la princesse ne succombera pas, la voilà qui resplendit sur les eaux.


La comtesse Rodellec du Portzic
(Musée de St-Servais)
<< Idylle bretonne, vers 1864. Huile sur toile, 84 x 58 cm.
(Collection particulière. Visible à St-Servais)
La scène bucolique, aux couleurs claires, se déroule
sous une frondaison somptueuse.
C - Peintures murales de la cathédrale de Quimper
| 1. Le père Maunoir obtient miraculeusement le don de la langue bretonne 2. Le ravissement de Saint Corentin 3. La conversation extatique de Saint Corentin et Saint Primel 4.Saint Roch guérissant les pestiférés 5. Saint Roch nourri miraculeusement par le chien du seigneur Gothard 6. Jésus-Christ donnant les clés à Saint Pierre 7. Le repentir de Saint Pierre 8. Saint Frédéric fait des remontrances au roi Louis Le Débonnaire 9. Saint Frédéric martyrisé 10. Prêche du vénérable Dom Michel Le Nobletz |
11. Conversion de Saint Paul 12. Saint Paul devant l'aréopage 13. Baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ 14. La prédication de Saint Jean-Baptiste 15. La fuite en Egypte 16. La mort de Saint Joseph 17. Education de la Sainte Vierge 18. Visite de Sainte Anne à la Sainte Famille à Bethléem 19. La nativité 20. L'adoration des mages |
Dans les années 1870, les chapelles de la cathédrale de Quimper reçoivent vingt fresques romantiques représentant des scènes de la vie des saints. A la demande de l'évêque, Yan' Dargent réalise plusieurs centaines d'études préparatoires avant de peindre, à la cire et à l'huile sur enduit sec, son "grand poème de la Légende bretonne". Cette oeuvre majeure, emblématique d'un âge d'or de la peinture religieuse en France, lui vaut gloire nationale et de nombreuses commandes pour le diocèse avant de tomber dans l'oubli ; elle sera redécouverte à la fin du XXè siècle.
Dix-huit pans de mur, en arc brisé, de 6 m de haut sur 2,25 m à 2,85 m de large sont peints, dans les huit chapelles du collatéral du choeur, le déambulatoire et la nef, composant vingt scènes différentes, auxquelles s'ajoutent pendentifs, impostes et retombées de voûtes.
| Mur de la sacristie (1878 - 1879) |

Le père Maunoir obtient miraculeusement le don de la langue bretonne.
L'inscription au bas du tableau explicite le sujet, difficile à rendre en peinture. Le père Julien Maunoir (1606-1683), professeur au collège des Jésuites de Quimper et originaire de haute Bretagne, reçoit en la chapelle de Ti-Mamm-Doue (située dans la campagne de Kerfeunteun, aux portes de Quimper) le don de la langue bretonne, afin de pouvoir se consacrer à ses missions d'évangélisation en basse Bretagne.
Un ange lui apparaît, qui touche ses lèvres de la main droite, tandis que de la gauche il semble lui indiquer les pays à évangéliser.
Derrière la verrière se profile le calvaire de La Trinité, situé dans l'enclos de l'église paroissiale de Kerfeunteun.
| Chapelle Saint Corentin (1871 - 1872) |

Le ravissement de Saint-Corentin, détail. La composition et le choix des couleurs rappellent L'assomption de la Vierge par Nicolas Poussin (Louvre), artiste admiré par Yan' Dargent. [...] Le développement dynamique en hauteur, l'utilisation judicieuse de l'ogive, les mouvements des bras et des ailes d'anges, les regards tournés vers le ciel portent le fidèle vers l'au-delà où trônent les chérubins. Le peintre fait preuve ici d'une parfaite science de la composition et du coloris, d'une excellente maîtrise de la lumière. Les gris, les bleus argentés, d'une douceur évanescente, sont en harmonie avec le rouges et les ors des robes du saint et des anges. Le concierge de l'évêché, Corentin Kervel, sert de modèle pour son saint patron. |

La conversation extatique de Saint Corentin et Saint Primel. La scène, empruntée à la Vie des saints d'Albert Le Grand, représente le premier évêque de Quimper s'entretenant des choses célestes avec saint Primel en son ermitage de la forêt de Névet. Au premier plan, à gauche, figure la source que Corentin a fait jaillir avec son bâton pour épargner à son maître vieillissant la corvée d'eau. Voir ICI. Une douce lumière baigne la scéne, empreinte de la foi naïve du disciple, d'un certain archaïsme. Une petit oiseau chante les louanges du Seigneur perché sur une corde au milieu de la scène. Au fond, dans une lumière bleutée, apparaissent la baie de Douarnenez et les falaises de la presqu'île de Crozon. |
| Chapelle Saint Roch (1871 - 1872) |

Saint Roch guérissant les pestiférés Cet épisode de la vie du saint a été souvent représenté. Saint Roch est vêtu ici de l'habit du tiers ordre franciscain. Il élève son crucifix vers le ciel pour implorer la miséricorde divine. L'artiste fait preuve d'une bonne science de la composition et use de raccourcis brillants. |

Saint Roch nourri miraculeusement par le chien du seigneur Gothard, détail. Voir aussi ICI. Après avoir contracté la peste à Plaisance, saint Roch, chassé par les habitants de la ville, se retire dans une forêt proche. Le chien du seigneur Gothard le ravitaille d'un pain dérobé à son maître. L'artiste choisit de représenter l'instant où Gothard découvre le mystère de la disparition quotidienne de son animal. En écho, un médaillon du vitrail de la chapelle donne une version proche de la scène. La chaumière du saint, pauvre cabane de branchages, apparaît dans un paysage splendide. Yan' Dargent s'est inspiré du site de Brezal, près de Saint-Servais où il a passé son enfance, pour peindre ce paysage. Au fond est représenté à cheval le seigneur Gothard qui observe la scène. L'artiste se révèle dans ce tableau un excellent animalier (le chien, notamment, a été l'objet de nombreuses études d'après nature). Le saint, en extase, reproduit les traits de Victor Courant, l'aide du peintre à la cathédrale, comme l'atteste un portrait conservé chez ses descendants. |
| Chapelle Saint Pierre (1872) |

Le repentir de Saint Pierre
Dans le tympan, saint Pierre, replié sur lui-même, pleure son triple reniement. Au lointain, le Christ apparaît dans un halo de lumière.

N. S. Jésus-Christ donnant les clés à Saint Pierre
Les coloris, où dominent les ors et les rouges, ont été volontairement haussés par l'artiste pour lutter contre le faible éclairage diffusé par le vitrail de la chapelle.
Mgr Sergent, au visage rajeuni, est représenté de face appuyé sur un bâton, sous les traits de saint Thomas.
C'est en 1870, un an avant sa mort, que Mgr Sergent, évêque de Quimper et de Léon, avait confié à Yan' Dargent le décor de huit chapelles de la cathédrale. Le projet sera poursuivi par son successeur Mgr Nouvel.
Voir l'étude de Yan' Dargent pour la remise des clés :
- premier personnage : les mains sous les bras du Christ ![]()
- et deuxième personnage : au-dessus de la tête de saint Pierre ![]()
| Chapelle Saint Frédéric (1876) |

Saint Frédéric fait des remontrances au roi Louis Le Débonnaire Frédéric, évêque d'Utrecht, reproche à Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne, son mariage incestueux avec Judith de Bavière et réprouve la conduite dissolue de son épouse. |

Saint Frédéric martyrisé Saint Frédéric est assassiné après avoir célébré la messe dans sa cathédrale, sur l'ordre de l'impératrice Judith. On pourra s'émouvoir devant la mort si pathétique de ce saint, assassiné sur les marches de l'autel et priant, au moment d'expirer, pour ses deux bourreaux, dont l'un guette dans le fond du tableau, tandis que l'autre s'enfuit au dernier plan. |
| Mur du collatéral sud (1878 - 1879) |

Prêche du vénérable Dom Michel Le Nobletz
Michel Le Nobletz (1577-1652) est représenté ici lors d'une de ses missions. Il présente à l'assemblée un crâne destiné à frapper les esprits.
Dans la foule des fidèles, en costume de Quimper, plusieurs portraits, dont ceux de Marie-Catherine Cornic et de sa soeur, de la ferme de Kernazet en Kerfeunteun, qui guidaient les pèlerins à Ti-Mamm-Doue. Le serviteur de l'artiste à Saint-Pol-de-Léon, François Le Bris, prête ses traits au desservant qui tient le crucifix.
Le clocher à dôme est celui de l'église de Plabennec.
| Chapelle Saint Paul (1876) |

La Conversion de Saint Paul Le Christ ressuscité apparaît à saint Paul sur le chemin de Damas. Le halo qui l'entoure éclaire cette scène crépusculaire. A noter, outre la belle étude du cheval, au bas de la peinture, les armoiries de la famille de Calan qui a participé au financement du décor de la chapelle. |

Saint Paul devant l'aréopage Saint Paul prêche sa foi devant le Sénat de la ville d'Athène. Deux portraits ont été identifiés, ceux des chanoines Chesnel, vicaire général honoraire de Mgr Sergent, à gauche en manteau violet, et de La Lande de Calan, du chapitre de la cathédrale, au centre, la tête coiffée d'une calotte. L'Aréopage est le lieu (nom d'une colline d'Athènes) et l'assemblée où saint Paul a prononcé un discours célèbre relaté dans les Actes des Apôtres, dont voici un extrait : |
| Chapelle Saint Jean-Baptiste (1875) |

Le Baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ Particularité iconographique, Yan' Dargent a choisi de présenter le précurseur agenouillé sur un rocher devant le Christ. |

La prédication de Saint Jean-Baptiste La scène baigne dans une lumière crépusculaire qu'affectionne l'artiste. Dans le lointain, le Christ apparaît dans un halo, préfiguration de l'Ecce Agnus Dei. |
| Chapelle Saint Joseph (1873) |
| Chapelle Sainte Anne (1873) |

L'Education de la Sainte Vierge
Dans le tympan, Sainte Anne fait ici pendant au saint Pierre du repentir, de l'autre côté du choeur : même utilisation de l'espace, même qualité de lumière et de ton.
Nous avions à Brezal une représentation de cette scène mais d'un autre style, dont je ne connais pas l'auteur, malheureusement.

Sainte Anne visite la Sainte Famille à Bethléem
L'Enfant Jésus, assis sur les genoux de la Vierge, tend les bras vers sainte Anne. En arrière plan, dans une trouée de lumière, saint Joseph contemple la scène avec attendrissement. Des colombes, perchées sur les poutres du logis, apportent une note de fraîcheur et de sérénité à la scène où dominent les rouges et les bruns.
| Chapelle des Trois-Gouttes-de-Sang (1881) |

La nativité La lumière qui rayonne de l'Enfant Jésus éclaire les visages de la Vierge et des anges par le bas, donnant un effet fantastique à la scène. |

L'adoration des mages Scène proche de la précédente par la composition et le rendu. |
D - Diaporama - Autres oeuvres de Yan' Dargent
| Photo n° | | |
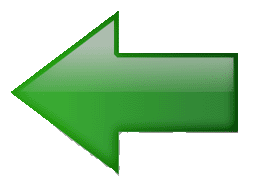 |
Avance manuelle |
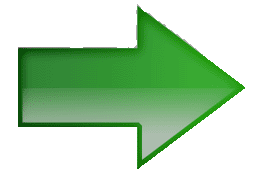 |
Autres oeuvres :
- portraits (1 à 5) 1
- paysages (6 à 9)
- scènes rurales (10 à 15)
- scènes religieuses (16 à 20)
- scènes mystiques (21)
- allégories (22)
- illustrations (26 à 29)
- vitraux (30 à 39) 2
- faïence (40)
- à Pleyber-Christ (41, 42)
- à St-Houardon (43 à 56) 3
- L. Despinoy (57, 58)
- Pâtre sur les rochers à
à Plouneour (59, 60)
- Madeleine pénitente (61)
- Orig. bénédictines (62, 63)
- L'onction à Béthanie (64)
- fresques à St-Joseph de
Morlaix (65 à 75)
- La Divine Comédie,
Paolo et Francesca (76)
- autres oeuvres (77 à 86)
- dessins (87 à 98)
- La Croix (99 et 100)
- Vie des Saints (101, 102)
- Vierge au Rosaire (103) New
1 Voir aussi le portrait de Dom Anselme Nouvel de La Flèche, évêque de Quimper et de Léon
2 On trouve des vitraux
dessinés par Yan' Dargent
à St-Servais, à Plouneventer,
à Botsorhel, à Ploubezre.

E - Articles de presse
Exposition au salon de Peinture de Troyes (L'Armoricain du 26/10/1847)

C'est alors, entre 1848 et 1850, qu'il créa son oeuvre, intitulée « Le progrès en marche ». Ce tableau contraste avec les autres oeuvres de l'artiste, notamment du point de vue de sa clarté. En cela, il se démarque de toute l'oeuvre du peintre, mais aussi par son caractère, classique dans sa composition. La toile, présente au musée de St-Servais, richement encadrée à la feuille d'or, mesure 99 par 72 cm.
La toile est présentée ici par Emilie Déthinne (Photo Le Télégramme du 30/7/2009).
Bénédiction de neuf tableaux à St-Houardon (Semaine Religieuse du 10/4/1891)
Dimanche dernier, avait lieu, à Saint-Houardon, la bénédiction de neuf magnifiques tableaux placés au-dessus des arcades du choeur. Ces tableaux, don de M. Yan' Dargent et témoignage de son beau talent, produisent un admirable effet. ![]()
Commentaires sur les tableaux de Yan' Dargent (Journal L'Univers du 15 juillet 1891)
Page 1 - Cliquer sur le petit livre vert
![]() Page 2 - Cliquer sur ...
Page 2 - Cliquer sur ...
![]() Page 3 - Cliquer sur ...
Page 3 - Cliquer sur ...
![]() Page 4 - Cliquer sur ...
Page 4 - Cliquer sur ...
![]()




Le début de l'article traduit une certaine condescendance envers ce qui se fait ailleurs que dans la capitale. Nous en avons l'habitude.
Mais ensuite l'auteur en vient à des commentaires beaucoup plus sérieux, et bien sûr plus valorisants pour l'oeuvre de notre artiste.
Bénédiction de deux nouveaux tableaux à Landerneau (Semaine Religieuse du 14/10/1892)
Il nous semble qu'un peu plus d'un an s'est écoulé depuis que Monseigneur Lamarche bénissait dans l'église de Saint-Houardon, sept tableaux où M. Yan' Dargent a représenté le sauveur dans sa gloire, entouré des anges, des apôtres, des évangélistes et des docteurs. La Semaine Religieuse parla de cette grande oeuvre, et peu après le journal l'Univers publia un article très remarqué où se trouve la note vraie sur le travail de l'artiste breton.
Les habitants de Landerneau n'ont pas cru avoir fait assez en donnant un tel embellissement au choeur de leur église ; M. Fleury, qui depuis douze ans s'est vu confier le soin de diriger cette paroisse, n'a point reculé devant une telle entreprise, et le résultat obtenu par lui, dit assez qu'il n'avait pas trop présumé de la générosité de ses fidèles. La décoration de la nef est commencée ; elle s'achèvera.
Le tableau du côté de l'Epître représente le choeur des martyrs :
Saint Etienne ouvre la marche, portant d'une main un encensoir, et de l'autre une des pierres instruments de son supplice.
A côté de lui, et un peu en avant, bien que sur l'arrière-plan, figure le diacre saint Laurent sur son gril. Cette représentation d'un saint dans le supplice même, ne cadre pas précisément avec le caractère général d'une oeuvre qui a pour but de représenter le ciel avec les saints dans la gloire.
Après saint Etienne, vient saint Eleuthère, diacre de saint Denys et son compagnon dans le martyre ; puis saint Vincent, diacre de Saragosse ; comme patron des vignerons, il porte une grappe de raisins ; à ses pieds est un loup qu'attaque vigoureusement un corbeau. Après le supplice de cet illustre martyr, son corps étant resté exposé à la rapacité des loups, un corbeau défendit contre les fauves ces restes précieux.
A la suite de ce groupe des quatre diacres martyrs, vient saint Denys l'Aréopagite, d'abord évêque d'Athènes, puis de Paris ; il porte sa tête entre ses mains, et cette représentation a un grand air de noblesse.
A côté de saint Denys, se voit saint Irénée, évêque de Lyon, formé à l'école de saint Polycarpe, qui lui-même avait été disciple de l'apôtre saint Jean. Viennent ensuite les Enfants Nantais. Saint Donatien montre le ciel à son frère Rogatien et le console en lui disant que le martyre lui tiendra lieu de baptême.
La tête de saint Théodore apparaît derrière le groupe des deux jeunes martyrs bretons. Inutile de rappeler que saint Théodore était soldat.
Saint Pancrace, vêtu de la robe des jeunes romains est à côté de saint Sébastien ; le soldat appuie la main sur l'épaule de son ami. On sait quelle intimité le cardinal Wiseman a prêtée à ces deux martyrs dans son admirable livre sur "l'Eglise des Catacombes".
Saint Maurice porte sa riche armure de chef de la légion Thébaine.
Saint Cadoc, évêque de Cambrie, puis solitaire dans un îlot du Morbihan, enfin immolé à l'autel par les Saxons idolâtres après son retour dans sa patrie, est représenté ici jouant de la harpe, car il était barde et cultivait également la poésie et la musique. Saint Cadoc était patron des guerriers de Bretagne et c'est lui que les trente Bretons de Beaumanoir invoquaient en marchant sur les trente Anglais de Bembrough.
Voici maintenant un groupe admirable ; le prince breton saint Miliau et son fils saint Mélar. Le père regarde avec tendresse l'enfant dont il presse la main mutilée ; celui-ci est rayonnant de grâce et d'innocence. Tout est parfait dans son attitude comme dans les détails et les nuances de son costume.
A Landerneau on ne pouvait omettre dans le groupe des martyrs le grand primat d'Angleterre, saint Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry. Il était le patron d'une des trois paroisses de la ville ; son église est toujours debout et sert de succursale à Saint-Houardon. Saint Thomas tient en main l'un des trois glaives qui furent les instruments de son martyre.
Le personnage qui suit saint Thomas est encore un saint local. Saint Salomon, roi de Bretagne, a été assasiné à l'endroit qui, en souvenir de cet événement, s'appelle encore La Martyre.
Derrière saint Salomon est une figure à peine indiquée ; saint Bieuzy, disciple de saint Gildas, mis à mort près de Baud, dans le Diocèse de Vannes.
Du côté de l'Evangile apparaît le choeur des Vierges martyres.
[de droite à gauche]
D'abord marche sainte Thècle qui, la première de son sexe, a répandu son sang pour Jésus-Christ. Un lion lui lèche les pieds.
Sainte Philomène, l'amie céleste du bon curé d'Ars, présente les deux flèches dont elle a été transpercée.
Sainte Agnès est reconnaissable à l'agneau qui se tient à ses pieds.
Sainte Cécile, agenouillée, joue d'un instrument de forme archaïque.
Sainte Agathe et sainte Lucie, les deux vierges siciliennes, forme un seul groupe ; la première offre à Dieu, sur un plat, ses chairs mutilées.
Sainte Apolline présente les tenailles qui servirent à lui arracher toutes les dents. On sait que cette illustre martyre était d'un âge très avancé quand elle fut condamnée au supplice.
Les trois personnages qui suivent forment un groupe d'une particulière importance qui occupe le centre du tableau. C'est d'abord sainte Catherine d'Alexandrie, puis Jeanne d'Arc, et enfin sainte Marguerite. La Pucelle écoute les voix de ses deux saintes dont la première tient un glaive, dont la seconde élève une croix et foule aux pieds le dragon. Jeanne d'Arc n'étant pas honorée [en 1892] du culte des Saints ne porte ni nimbe ni auréole.
Derrière sainte Marguerite est sainte Blandine portant une cruche ; la jeune martyre de Lyon était esclave, et c'est pourquoi elle est représentée dans les fonctions de la domesticité.
Sainte Barbe a près d'elle une tour percée de trois fenêtres, souvenir de la prison où elle fut enfermée par son père avant que celui-ci ne lui donnât de sa propre main le coup de la mort.
Derrière sainte Barbe, est sainte Eulalie, dont on n'aperçoit que le visage.
Aux pieds de sainte Ursule, princesse de Grande-Bretagne, sont deux de ses compagnes vierges et martyres comme elle ; sainte Evette et sainte Thumette.
Madame Victoire de Saint-Luc, religieuse à la Retraite, guillotinée à Paris, pour avoir peint et distribué des images de sacré-Coeur, clot la série des Vierges martyres. Comme Jeanne d'Arc elle a été représentée sans auréole. Afin de se conformer aux désirs de la sainte Eglise, il eut été préférable que ces deux personnes fussent représentées à genoux.
Une autre critique qui n'enlève rien à la valeur artistique de l'oeuvre : les martyrs auraient dû occuper le côté de l'Evangile, et les Vierges et martyres le côté de l'Epître. Si M. Yan' Dargent a saisi cet ordre, c'est pour se conformer à ce qu'a fait Flandrin dans ses fresques de saint Vincent-de-Paul. Nous regrettons cependant cette inversion.
* * *
F - Liste non exhaustive de ses oeuvres

Autoportrait, réalisé à partir d'une photographie
ancienne (Musée de St-Servais)
- Le Retour, Les Baigneuses (1851);
- Au bord de la mer (1852);
- Les Dénicheurs d'aigles, le Chariot (1853);
- Derniers rayons (1855) ;
- Les Bords de la mer à Lokirech,
Sauvetage à Guisseny (1857); - Saint Houardon, patron de Landerneau (1859);
- Les Lavandières de la nuit,
Ballade bretonne (1861); - Les Vapeurs de la Nuit,
Un Soir dans la lande (1863); - La Vache récalcitrante (1864);
- La mort du Barde (1864)
- Mort du dernier barde breton (1865);
- Souvenir d'enfance,
le Menhir (1866); - La Roche Maurice,
Kloarek en vacances (1868); - Le Petit Poucet (1869);
- Le retour des champs (1870)
- L'Intempérance et le Travail (1870);
- Madeleine pénitente (1870) ;
- Le Charron de Laouic (1872);
- Le Puits de Santa ;
Le Sentier aux ramiers à Brézal, dans le Finistère ;
L'Education de la sainte Vierge et Sainte Anne visite la sainte famille à Bethléem, pour la cathédrate de Quimper (1873); - Saint Roch dans la solitude ; et Korn boud, aux environs de Saint-Pol de Léon,
La Mort de saint Joseph et la Fuite en Egypte, ces deux dernières toiles pour la cathédrale de Quimper (1874); - Sentier près de Telgruc,
Conversation extatique de saint Corentin et de saint Primel,
Falaise à Goullien (1875); - Baptême de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
Prédication de saint Jean-Baptiste, pour la cathédrale de Quimper (1875); - Saint Benoît et sainte Scholastique (1875) ;
- Les Bords du Scor-an-Sac'h,
Falaise à Morgat,
et pour la cathédrale de Quimper la Conversion de saint Paul et saint Paul devant l'Aréopage (1876) ; - La légende du Folgoat, Crépuscule dans les landes de Plouneventer (1895) ;
- An anaoun, ombre des marais, le Dolmen en Saint-Servais (1896) ;
- Six fusains : 1. Falaise au Toulinguet, 2. Groupe de moutards sur la falaise de Morgat, 3. Petite grotte au Toulinguet, 4. Pêche, 5. Anse de St-Jean à St-Pol-de-Léon, 6. Contrebandiers au clair de lune (1896) ;
- Sous les vieux saules de Penn-ar-Stank en Ploudiry (1897)
- L'Escadre du Nord à l'horizon de Goulven, le Grèves de Dinan (1898) ;
- ... et des dessins pour des vitraux, des peintures murales (notamment dans la cathédrale de Quimper)
et surtout de nombreux dessins sur bois pour les publications illustrées.
G - Portraits du peintre




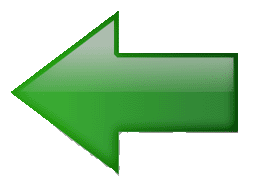 Photographie sur plaque de verre découverte dans le fonds d'atelier de J.L. Nicolas par Florie Dupont LVDA.
Photographie sur plaque de verre découverte dans le fonds d'atelier de J.L. Nicolas par Florie Dupont LVDA. Est-ce Yan' Dargent sans ses lunettes ?
Ou Jean-Louis Nicolas lui-même ?









Portrait de Yan' Dargent
C'était un petit homme châtain d'une quarantaine d'années, aux traits accentués et fins, quoiqu'un peu rustiques. Les cheveux assez longs flottaient sur son col ; sa barbe peu fournie, peu soignée, laissée à elle-même, comme un pré mur où la faux n'a pas passé, semblait alléger comme une brume, sa physionomie mobile qu'animaient ses yeux gris, pleins d'ardeur contenue.
Le plus grand plaisir qu'on pouvait lui faire était de lui dire qu'il avait le type breton, aussi mon père n'y manquait pas, car c'était vrai.
Alors, cet Armoricain de race, se redressant et se frappant la poitrine de son poing serré, s'écriait : "Et le coeur donc ! "
Source Cahiers de l'Iroise 6è année n° 2 avril-juin 1959, d'après
Les maisons que j'ai connues. Nos amis artistes ![]() par Virginie Demont-Breton (artiste-peintre 1859-1935),
par Virginie Demont-Breton (artiste-peintre 1859-1935),
fille de Jules Breton (peintre, Pardon de Notre-Dame de Kergoat 1890), épouse de d'Adrien Demont (peintre).
Lire le texte intégral en cliquant sur le petit livre vert.
Les maisons que j'ai connues. Nos amis artistes
IX - Yan Dargent. - Quimper-Corentin p. 71
Quand nous prenions le matin la voiture publique de Penanroz qui faisait le service entre Douarnenez et Quimper, c'était généralement pour aller voir notre ami Yan Dargent.
Nous allions le surprendre dans la cathédrale où il était en train de peindre, sur la muraille même, des fresques, représentant des scènes de la vie de saint Corentin, de saint Pierre, de saint Roch, de sainte Anne, de saint Jean-Baptiste, une fuite en Egypte, etc.
En nous apercevant du haut de son échafaudage, Yan Dargent tout joyeux écartait les échelles et les escabeaux qui nous eussent caché une partie de sa fresque et descendait pour se joindre à nous. C'était un petit homme châtain d'une quarantaine d'années, aux traits accentués et fins, quoique un peu rustiques. Ses cheveux assez longs flottaient sur son col ; sa barbe peu fournie, peu soignée, laissée à elle-meme comme un pré mûr où la faux n'a pas passé, semblait alléger, comme une brume, sa physionomie mobile qu'animaient ses yeux gris, pleins d'ardeur contenue.
Le plus grand plaisir qu'on pouvait lui faire était de lui dire qu'il avait bien le type breton, aussi mon père n'y manquait pas, car c'était vrai.
Alors cet Armoricain de race, se redressant et se frappant la poitrine de son poing serré, s'écriait : - Et le coeur donc :
De tous les saints dont il illustrait la mémoire, son préféré était saint Corentin, car celui-là était un vrai saint breton ayant donné son nom à sa ville de Quimper et à sa cathédrale. Heureux d'avoir l'avis de mon père sur son travail, Yan Dargent nous menait d'une fresque à l'autre et nous expliquait les sujets. Les unes étaient presque terminées, d'autres étaient à l'état d'ébauche ou de crayonnage.
Ma mère adorait les légendes et l'écoutait avec intérêt.
L'histoire de saint Corentin, très peu connue, a un certain rapport avec celle du prophète Elie, en ce sens que la Providence lui évita l'ennui d'avoir à songer au vulgaire soin de sa nourriture : avant de devenir le premier évêque de Cornouaille, en 486, il vivait en ermite près d'une fontaine située au pied du mont Frugy et mangeait tous les jours un petit poisson qui, aquatique Phénix, renaissait sans cesse... de ses arêtes.
Je me rappelle surtout une composition où saint Corentin debout, les bras levés, prêche au milieu d'un groupe de Bretons attentifs.
Le peintre nous montrait aussi ses projets encore à l'état d'esquisses. L'une de ces dernières me causa une émotion terrifiante : un saint décapité (saint Denis peut-être) se tenait tout droit entouré de personnages prosternés. Ce n'était pas une apparition, car le saint était tout aussi précis et existant que ceux qui l'honoraient, en sorte que sa mutilation m'appparut comme une chose brutalement horrible, et je mis mes deux mains sur mes yeux.
Mon père partagea mon impression, car il dit à son ami :
- Votre arrangement est bon, mais, croyez-moi, évitez ce beafteck saignant entre les deux épaules. Mettez une tête de Lumière, la tête morale, immatérielle, la tête de l'âme de votre supplicié pour terminer le personnage, l'horreur disparaîtra et l'émotion n'en sera que plus puissante, étant plus idéale.
- Ah ! que vous avez raison ! s'exclama Yan, qui tout de suite avait compris.
Mon impression si violente avait son pendant dans mon souvenir : ce corps sans tête me rappelait toute une série de têtes sans corps que j'avais vues dans une petite église de je ne sais plus quel village breton : accrochées à la vieille muraille suintante et verdie, il y avait là une quinzaine au moins de boîtes vitrées ayant la forme de petites chapelles surmontées d'une petite croix et contenant (horreur !) des têtes qui avaient vécu, des têtes décharnées, aux yeux creux, où, sur les fronts parcheminés, jaunis, restaient encore collées de longues mèches de cheveux, des têtes désséchées, grimaçantes et figées, et l'on pouvait lire en dessous : Ceci est le chef d'Yvon, d'Alain ou d'Hervé, avec le nom de famille et la date du décès. Cette vision m'avait souvent hantée depuis et elle m'apparaissait, en ce moment, avec une acuité spéciale ; aussi éprouvai-je un soulagement lorsque je vis le peintre saisir un morceau de pastel jaune et, après quelques secondes de recueillement, le menton dans la main, esquisser rapidement la tête lumineuse en lui sonnant le geste levé de l'inspiration.
- Ah ! que ce sera mieux ! dit-il.
Je ne sais pas si cette composition fut mise à exécution.
Mon père, qui aimait à connaître les antécédents des artistes, lui demanda :
- Quels furent vos tout premiers débuts ?
- J'ai commencé par être employé de chemin de fer.
- Ah ! vraiment ? mais votre goût pour l'Art n'a pas tardé à vous aiguiller vers une autre voie qui n'était pas ferrée ?
- Ce n'était pas une voie ferrée, c'est vrai, mais, au départ, elle a été un peu dure quand même.
- Sans doute votre famille vous criait : "Gare ! mais vous n'avez pas déraillé !
- Non ! j'ai dit : "Bonsoir la compagnie". Ma première station a été à l'atelier de Jobbé-Duval et, comme j'avais une grande facilité pour la composition d'idée, j'étais toujours en tête pour les concours d'esquisses. Mon maître m'encouragea, j'eu de braves camarades, j'étais sauvé. J'ai été bercé avec les vieilles légendes bretonnes, elles m'ont charmé et elles m'ont fait peur. Je crois que cela a contribué à me meubler l'imagination. Ce grand travail que j'exécute en ce moment ne m'est pas payé cher, mais il me permet de séjourner dans mon pays, sur ma terre natale, sous mon ciel d'Armorique. Vous savez, je suis né à Saint-Servais, tout près de Landerneau, sans doute par une nuit de lune, cette lune qui, tout le monde le sait, est plus grande que partout ailleurs. Pour moi, les sous qui me viennent de ma vieille Bretagne me valent les louis d'or de Paris, comme le disque de la lune qui éclaire la danse des korrigans et des fées lanvandières me vaut celui du soleil le plus éclatant de toute autre province.
Aussi, à toute occasion, j'accours vers mes clochers ajourés, comme un petit enfant accourt vers sa mère, quand elle l'appelle.
- Et vous êtes à Paris, pourtant ?
- Il le faut bien ! c'est Paris qui nous consacre, qui nous baptise peintres, qui légitime nos toquades, qui nous donne la confirmation de nos mérites, en un mot qui nous auréole.
Vous le savez bien aussi, vous, mon cher ! Si j'étais toujours resté dans mon ignorante province, je n'y aurais aucun prestige.
Tenez, dernièrement un ancien camarade me dit :
" - Eh ! mon bon petit Yan, si tu étais resté à la compagnie, tout de même, tu serais peut-être maintenant un excellent chef de gare !"
" Je répondis : " C'est vrai !" et je lui passai un journal contenant un article sur mon envoi au Salon et, à ce propos, sur mes illustrations d'ouvrages connus. Mon cher ! il a été tellement épaté qu'il a promené le journal dans tous les cafés de Landerneau pour y proclamer mes mérites. Depuis il m'appelle toujours : "Mon bon petit Yan", mais on sent qu'il est fier de pouvoir se permettre ce sans façon. Ah ! le prestige du nom imprimé ! Il n'y a que cela pour faire du bruit dans Landerneau ! On ne me serait pas reconnaissant de n'avoir pas quitté mon clocher et on me sait gré de ne pas l'oublier et d'y revenir."
Je me rappelle aussi une visite qu'il nous fit à l'hôtel où nous étions descendus et qui était situé sur la place au milieu de laquelle s'élève, sur son socle massif en granit poli, la statue de bronze du savant illustre : Laennec.
Ce jour-là, Yan Dargent nous présenta sa femme. Je la revois causant doucement, la tête appuyée sur le marbre blanc de la cheminée de notre chambre, dans une sorte d'abandon très souple, rappelant le galbe gracieux des muses d'Ary Scheffer ou Jean Gigoux. Cet air penché et rêveur semblerait affecté aujourd'hui où toute élégance de ligne et de forme s'appelle : "vieux jeu", où les jeunes filles sont des garçons manqués au lieu d'être des jeunes filles réussies. Cette attitude était naturelle cependant et s'harmonisait avec les cheveux en bandeaux bien lissés sur les tempes, que je remarquai parce que, déjà alors, cette coiffure n'était plus tout à fait de mode. Elle me fit songer, en plus jeune et plus jolie, à Mme George Sand, qu'Eugène Lambert, le peintre de chats, nous avait présentée un jour dans le grand hall de la sculpture du Salon, mais ses cheveux étaient plus noirs et moins ondulés.
J'ai appris depuis qu'elle était la fille du peintre Mathieu, directeur de la France illustrée, et qu'elle avait composé un grand nombre de romances que Yan Dargent avait ornées de dessins, ce qui ne m'étonna pas, car ce don de composition musicale répondait bien à l'expression rêveuse de son visage.
Ils vivaient donc dans une belle union morale. Ils formaient l'un de ces ménages pour lesquels Cupidon n'ayant plus besoin de ses flèches, puisqu'il a touché le but du premier coup, mêle dans son carquois le pinceau, le crayon, la plume et la flûte de Pan, comme on eût dit à cette époque symbolique. Ce bonheur dura une vingtaine d'années. Ils s'étaient mariés en 1866, elle mourut en 1885.
Yan Dargent avait commencé par faire des tableaux et des illustrations inspirés par la fantasmagorie des vieux contes d'Armorique. Il mêlait le paysan réaliste aux apparitions surnaturelles. Il donna des figures humaines grimaçantes à des arbres, à des rochers, il groupa les fées et les gnomes avec des personnages réels. Les lavandières blanches entraînant dans leur ronde diabolique un pauvre ivrogne titubant, le Barde mort où l'on voyait passer dans le fond la Fortune suivie d'un cortège de peintres et de poètes firent sensation au Salon. Son tempérament de dessinateur fécond et touffu, quoique bien personnel, avait quelque rapport avec celui de Gustave Doré. Il entrevoyait les sujets dramatiques et étranges comme seul peut le faire un enfant d'une vieille terre, qui depuis le berceau jusqu'à l'adolescence a cru à ce que la légende a de fantastique. Plus tard, dans ses sujets religieux, il adoucit sa manière et mon père disait : - Yan devient trop sage.
La dernière fois qu'il nous fut donné de lui serrer la main ce fut au Salon, vers la fin du siècle dernier. Il exposait un tableautin : "La Chanson de Lauïk". Devenu veuf et triste et vieillissant, il errait là comme dépaysé, mise négligée, barbe entremêlée, habits râpés. On sentait que sa douce Muse n'était plus là pour lui faire son noeud de cravate. Ses vieux amis disaient de lui :
- Ce pauvre Yan Dargent, il a l'air d'en manquer.
Ce n'était pas vrai, car il possédait en Bretagne une belle et vaste propriété. Il avait vécu de son art et son art lui avait suffi. Tout le reste lui semblait superflu. Comme saint Corentin, il s'était contenté du petit poisson quotidien, sans en demander plus.
Il mourrut en 1899, et cet événement, coïncidant avec la mort d'un siècle, passa presque inaperçu. Mais, deux ou trois ans plus tard, toute la presse parisienne exhuma ce nom jadis célèbre de Yan Dargent, à propos d'une chose qui causa un véritable scandale dans le monde des arts :
Toujours fidèle aux traditions anciennes de son pays, même les plus barbares, le peintre avait inscrit dans ses dernières volontés que sa tête serait détachée de son corps et placée dans une boîte vitrée en forme de petite chapelle, avec cette inscription : "Ceci est le chef de Yan Dargent de Saint-Servais". Son fils respectueux de cette volonté dernière, l'avait fait exécuter à Landerneau, pour offrir cette relique à l'église de son pays natal.
Cette opération macabre avait donné lieu à une scène horrible. La pauvre tête était si solidement chevillée au corps qu'il avait fallu agir avec une véritable brutalité pour parvenir à l'en détacher, et les journalistes criaient : "Coutume digne des sauvages ! Insulte à la mort ! Sacrilège, sacrilège !".
En lisant ces affreux détails, je revis dans mon souvenir la cathédrale de Quimper et le corps sans tête de saint Denis, la petite église bretonne et les têtes sans corps en ex-voto, et, jetant le journal, je mis alors mes mains sur mes yeux et je m'efforçai de me représenter sur ce pauvre corps mutilé la tête d'artiste, la tête enthousiaste, la tête qui s'illuminait d'une flamme si pure d'amour filial, lorque Yan disait en se frappant la poitine :
- C'est le coeur surtout qui est breton !
H - Sources
- Musée des beaux-arts de Quimper
- Musée de Saint-Servais
- Eglise et ossuaire de Saint-Servais
- Eglise Saint-Houardon de Landerneau
- Cathédrale de Quimper
- L'illustration journal universel
- Yan' Dargent, héraut de la Basse-Bretagne par Jean Berthou
- La grâce d'une cathédrale sous la direction de Mgr Le Vert, évêque de Quimper.
- La Procession des saints de l’église Saint-Houardon de Landerneau par Axelle Marin. Anciennement responsable du service art, patrimoine, archives de la Ville de Landerneau - Bulletin de la Société Archéologique du Finistère - 2022
- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4580202q/f5.item.r=brezal
- L'illustration et les illustrateurs par Emile Bayard
- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9930097/f49.item.r=nos%20amis%20artistes# page 71
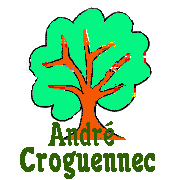 | |
| André J. Croguennec - Page créée le 16/12/2017, mise à jour le 13/1/2026. | |

